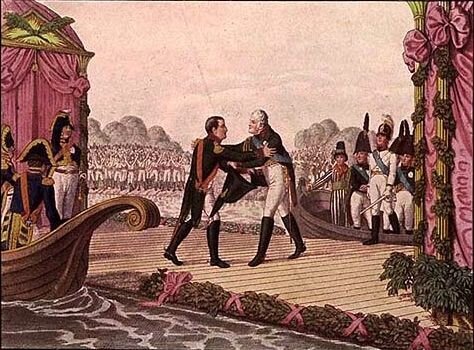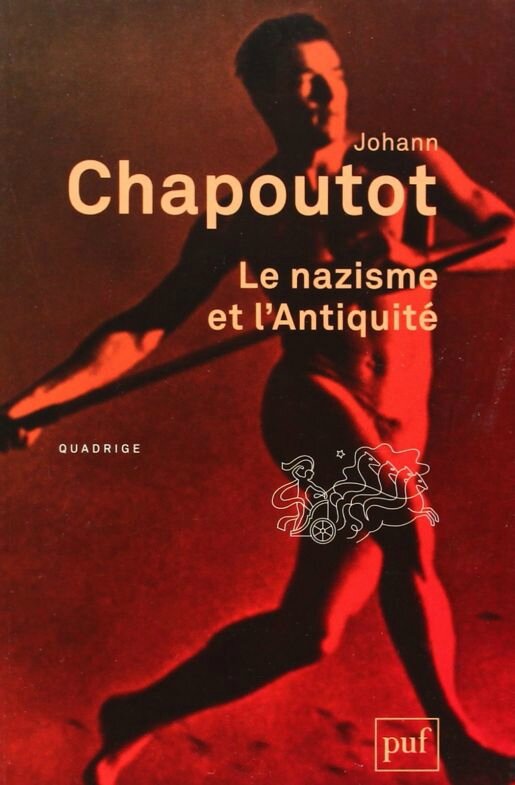« Vous comptez, notamment de par votre engagement en politique, parmi les jeunes qui entendent œuvrer activement à l’amélioration des conditions de vie et de coexistence collectives au sein de la Cité. À l’heure où des voix s’élèvent pour réclamer qu’un débat véritable se tienne quant aux termes de la structuration et de l’organisation du régime républicain français, je souhaite vous inviter, entre autres jeunes politiques de tous bords, à expliciter dans un texte de synthèse l’état actuel de votre réflexion personnelle, au-delà de toute considération partisane, s’agissant de la manière dont, dans un souci conjugué de sincérité démocratique et d’efficacité de la chose publique, la République pourrait être rénovée - voire, selon les sensibilités, refondée.
Parmi les thématiques que vous pourriez aborder, cette liste n’étant pas exhaustive et pouvant être élargie à votre discrétion : les modalités d’élection des représentants de la Nation et des territoires; l’articulation des rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif; l’articulation des rapports entre le gouvernement, qui procède du Parlement, et la présidence de la République, dont le mode de sélection peut être discuté, au sein de l’exécutif; l’articulation des rapports entre l’État central et les collectivités décentralisées; l’articulation, enfin, à définir entre les notions de "démocratie représentative" et de "démocratie participative"...
Des questions multiples, fondamentales, auxquelles peuvent se greffer celles relatives au calendrier électoral et aux limitations des mandats ; aux interventions des citoyens, des médias et de l’argent dans le processus politique. En trois mots comme en cent, les "règles du jeu". Je laisse volontairement de côté la question communautaire européenne, considérant qu’elle est fonction de la volonté nationale telle qu’exprimée d’après les règles démocratiques dont il est question ici. »
Cette idée-ci, voilà longtemps que j’avais envie de la mettre sur pied. La question des institutions et, plus généralement, celle touchant au fait démocratique, m’ont toujours beaucoup intéressé. Coutumier de l’exercice qui me permet régulièrement, avec bonheur, d’offrir des espaces d’expression à des jeunes engagés en politique, c’est tout naturellement que j’ai souhaité appliquer ce concept, ce format désormais traditionnel des articles « à plusieurs voix » à cette thématique-là. Dès la mi-août, j’ai transmis à plusieurs jeunes femmes et hommes engagés au sein de chacune des grandes « familles » politiques qui comptent (EELV, PCF, DLF et MRC compris, je le précise au passage) la proposition reproduite dans le premier paragraphe de cette introduction. Je remercie celle et ceux qui, parmi ces jeunes, sont allés au bout de l’exercice. Et suis ravi de la richesse que la variété, la qualité de leurs interventions - positionnées ici d’après un ordre chronologique - confèrent à cet article. Quelques éléments en vue de débats véritables ; je l’espère en tout cas. Une exclusivité Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.
UNE EXCLUSIVITÉ PAROLES D’ACTU
Institutions et vie démocratique
Réflexions sur les « règles du Jeu »

Illustration : Assemblée nationale
La République telle qu’on la connaît a mis, depuis l’époque révolutionnaire, beaucoup de temps à se développer et n’a acquis de réelle stabilité qu’à la faveur de l’avènement de la Vè République, en 1958. La France a pendant longtemps été embourbée dans un système parlementariste (Ière République avant le Consulat, IIIè puis IVè République) qui a provoqué de l’instabilité politique et des crises multiples : les gouvernements étaient, pour certains, contraints de démissionner au bout de quelques semaines seulement, faute de majorité d’appui au Parlement.
Le Général de Gaulle, qui avait pour la France l’objectif de restaurer l’autorité de son État, a expliqué ses intentions dans son discours de Bayeux de 1946 : le Premier ministre ne doit plus procéder du Parlement ; il convient qu’il soit nommé directement par le président de la République. En proposant plusieurs mécanismes de rationalisation des institutions, il permet ainsi de sortir du régime parlementaire à proprement parler, celui-ci ayant fait montre de ses (nombreux) travers. C’est ce qui sera mis en place à partir de 1958, avec la Vè République.
Il faudra donc attendre 1958 et le retour du Général de Gaulle aux affaires pour que les principes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et ceux de la séparation des pouvoirs, pour que la reconnaissance du chef de l’État en tant que « capitaine » et l’introduction d’outils de démocratie directe - couplés avec ceux propres à la démocratie représentative - soient mis en œuvre de concert. On a l’impression de retrouver ici ce qu’il nous manque aujourd’hui, finalement.
Nos dirigeants actuels ont les clefs en main pour éviter de se retrouver sous le joug des critiques, et pourtant, ils n’en font rien, par peur de perdre leur place. Dans un premier temps, le référendum, outil qui n’est plus utilisé depuis dix ans en France, doit être réhabilité, puisque son utilisation est prévue par la Constitution. Le Président et le Parlement ne doivent plus avoir peur du peuple, surtout s’ils veulent continuer à obtenir ses suffrages...
Le chef de l’État doit avoir l’autorité qui lui est conférée par son statut mais aussi le rôle qui est le sien dans les institutions de la République : il doit indiquer les grandes orientations, guider la politique menée par le gouvernement, bref, donner le cap. C’est aussi ce qui manque cruellement à l’heure actuelle, où l’on a plutôt l’impression que les Français sont oubliés, et que le gouvernement est sourd alors même que les manifestations se font de plus en plus entendre.
D’un point de vue organique, l’État est affaibli : au départ unitaire et centralisé, l’État français devient de plus en plus décentralisé et communautaire. Il n’y a, de ce fait, plus de réelle autorité : les affaires ont tendance à transiter d’une collectivité à une autre, et cela en ralentit considérablement le traitement. Ce phénomène s’est vu généralisé par les réformes de décentralisation qui ont eu lieu dans et depuis les années 80. Il aurait plutôt fallu faire, à mon sens, davantage de réformes de déconcentration. Je crois que le problème du mille-feuille administratif pourrait être résolu en supprimant des échelons intermédiaires, tels que les communautés de communes ou les régions. De cette manière, les affaires publiques n’auraient plus à transiter qu’entre les communes, les départements et l’État. On simplifiera l’organigramme et la coopération sera en tous domaines préférée aux logiques d’intégration, peu démocratiques.
Le scrutin majoritaire, qui n’a d’intérêt que pour la constitution d’une majorité pour le pouvoir exécutif, montre ses limites en ne reconnaissant pas des voix minoritaires mais pourtant souvent importantes. En France, pour plusieurs élections, et notamment les régionales, qui approchent, c’est un mode de scrutin mixte qui est mis en place : toutes les listes recueillant plus de 10% des voix sont représentées, et la liste qui arrive en tête au second tour obtient une prime majoritaire. Si l’on adapte et modifie ce principe pour les élections nationales, et en particulier pour les législatives, - dont le mode de scrutin n’est pas fixé dans le marbre constitutionnel et peut de ce fait être modifié - on peut composer une assemblée élue avec une dose importante de proportionnelle. On peut considérer que le fait majoritaire est viable dès lors que la prime majoritaire est de 20 ou 25% pour la liste qui arrive en tête. Ainsi, on pourrait établir à 75 ou 80% la dose de proportionnelle pour les législatives, et assurer ainsi la représentation de la plupart des mouvements politiques, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Le fait majoritaire serait préservé, la stabilité de la République également.
Le calendrier électoral, en vertu duquel le Président est élu quasiment au même moment que les députés, donne l’impression qu’au niveau national, les Français choisissent leurs représentants une fois tous les cinq ans, sans jamais voir de leur part de signe de responsabilité politique. Cela va dans le sens de Rousseau quand il disait qu’une fois ses représentants élus, le peuple est dépouillé de sa souveraineté.
La question de la limitation du nombre de mandats, directement liée à la précédente, n’est véritablement utile que s’il existe une réelle contestation populaire des représentants du peuple. Si un élu est efficace, peu de gens soutiendront la limitation du nombre de mandats. Si un président élu ne revient jamais devant le peuple durant son mandat, par un référendum par exemple, alors le peuple sera plus prompt à demander une limitation du nombre de mandats. Si un président remet en cause son mandat plus souvent, comme le faisait le Général de Gaulle lorsqu’il organisait un référendum en y associant sa propre responsabilité politique, alors son action suscitera la confiance auprès du peuple. La volonté de limiter le nombre de mandats vient de l’absence de confiance qui règne aujourd’hui entre le pouvoir et le peuple. Elle ne trouve sa justification, à mon sens, que dans le cas où les élus ne remplissent manifestement pas correctement leur fonction.
Cette confiance qui devrait exister entre les élus et le peuple est d’une certaine manière organisée par la constitution de la Vè République, qui mêle démocratie représentative et démocratie directe. Seulement, les outils de démocratie directe sont oubliés car non obligatoires ; les élus se reposent sur la démocratie représentative. Il s’agit donc ici d’un dévoiement de l’esprit de notre république, puisque, d’une démocratie semi-directe, nous sommes passés à une démocratie purement représentative. La situation politique en France rejoint de plus en plus les conclusions qu’émettait Rousseau : le peuple a l’impression d’avoir perdu sa souveraineté.
Cette impression se retrouve s’agissant de l’Union européenne. Sur ce sujet, De Gaulle, qui a un temps pratiqué la politique de la chaise vide, consistant à refuser un développement excessif de la construction européenne, a toujours considéré que ledit développement nuisait à l’indépendance de la France. Si Maastricht est passé de justesse en 1992, le résultat du référendum de 2005 s’est avéré clairement négatif, nouvelle preuve que les Français veulent préserver l’indépendance de leur pays. Et pour cause, plus personne en France ne veut être dirigé par un gouvernement non élu !
La construction européenne apparaît en fait comme un brutal retour en arrière sur le terrain de la politique. Alors que nous avons mis des années à établir une république stable, voilà que les élites de Bruxelles veulent contrôler notre budget, notre monnaie, et même nos lois : la France est punie d’une lourde amende si elle ne respecte pas les décisions de la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’obligeant alors à modifier ses lois en conséquence !
L’Union européenne, d’ailleurs, ne respecte même pas la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, reconnue constitutionnellement par la France. Son article 3, notamment, précise que « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation » et que « nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».
Tous ces points tendent à un même résultat : au final, le peuple n’a plus confiance en ses élus, et il le leur fait savoir comme il le peut. Avec, chaque jour davantage, le sentiment que ces élus constituent une « élite » totalement coupée de ses préoccupations, et dont la fin serait de tirer, aux dépens du peuple, les bénéfices sociaux et financiers afférents à ces fonctions qu’ils monopolisent. Ce qui entraîne un mécontentement populaire légitime et qui va croissant. Ce mécontentement, qui nourrit une véritable crise de la citoyenneté, exige de profondes modifications institutionnelles et une véritable refondation de la République sur ses principes de 1958 et de 1962.

« Restaurons l’autorité de l’État »
par Arnaud de Rigné, le 25 août 2015
- - - - -
Avant d’exprimer ma vision personnelle de la République et du système idéal pour la France - et non pas celle du mouvement politique dans lequel je milite -, je vais établir un état des lieux (nécessaire) de certains fondamentaux :
« Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » (C. de Gaulle). Un rappel sur l’identité et ses évidences : la France, depuis quinze siècles, repose sur une essence délicate et rare : le métissage des peuples blancs européens, la fusion avec la religion chrétienne et la continuité de l’héritage grec et romain. Je ne dis pas que nous sommes restés inchangés de Clovis à Saint-Louis en terminant par de Gaulle, ce serait une erreur. Je parle des fondamentaux qui structurent une civilisation. Nos trois piliers : essence charnelle, spirituelle et culturelle.
Ce ne sont pas cinquante ans d’immigration, d’américanisation, de castration et de diabolisation de ces évidences, qui feront oublier aux héritiers de la France, nos racines. Non, en aucun cas !
Concernant la République française, qui naquit de la Révolution de 1789, des miasmes des politiques libérales de Turgot aux entreprises de conquête du pouvoir de la nouvelle bourgeoisie mobilière – nourrissant une haine de l’ancien régime catholique, alors dirigé par le clergé et la noblesse – je préciserai que malgré toutes les ardeurs laïcistes et anticléricales, les seules lettres de noblesse, la seule force d’incarnation qui a nourri la République, viennent précisément de la France et de son essence chrétienne – triste ironie !
Je réduirai donc la République à ce qu’elle est, et doit être aujourd’hui : un simple régime au service de la France, et non comme cela est le cas depuis trop longtemps, une France au service de la République.
Le modèle que je présente ci-dessous est une réflexion, une vue de l’esprit - comme tous les modèles, à l’origine. Utopique, irréalisable, peu importe ! L’intérêt est la réflexion qui peut en découler. L’esquisse de cette idée d’institution se nommant « Nation Française » - Nation, pour insérer dans le marbre, ce principe national, que toutes les forces de l’établissement tentent aujourd’hui de dissiper. C’est un rappel de soi, et cela en découlera, dans sa constitution et sa loi. Commençons.

Schéma. Source : D. Berton.
Le Premier Citoyen :
Comparable au Président de la Vème République, il incarne le pouvoir exécutif, et en assume les prérogatives dans sa globalité. Le gouvernement n’est que son prolongement. Il est élu par le suffrage universel uninominal à un tour. Il nomme 1/3 des sénateurs pour 5 ans, sans possibilité de les révoquer. Droit de véto, utilisable une seule fois par an, sur toute motion du Sénat.
Le Roi :
Il est une figure symbolique, représentant l’image de la France à l’international, supplantant l’exécutif sur ce point. Il est roi par primogéniture de sang royal. Il incarne l’essence de la France et est le garant de l’identité de la France et des vertus chrétiennes. Il nomme 1/3 des sénateurs pour 5 ans, sans possibilité de les révoquer. Droit de véto, utilisable une seule fois par an, sur toute motion du Sénat.
Le Sénat :
Les sénateurs discutent, étudient et votent les lois et les budgets : ils incarnent le pouvoir législatif ; une commission annexe de sénateurs jugent de la constitutionnalité des lois. La nouveauté réside dans le mode de désignation des sénateurs, ce que je nomme la règle des trois tiers : 1/3 élus par les électeurs (scrutin uninominal à 1 tour), 1/3 nommés par le Premier Citoyen, 1/3 nommés par le Roi.
La politique et l’argent :
Toutes les indemnités des élus, du Premier Citoyen aux Conseillers des assemblées (sauf municipalités), seront établies d’après le salaire moyen en France (2 874 euros brut pour 2012 par exemple) ; chaque année l’indemnité sera adaptée selon l’évolution – je précise que l’indemnité est en brut du salaire moyen, non en net. Les indemnités des élus municipaux ne peuvent pas dépasser le salaire moyen national. Les mandats et les indemnités peuvent se cumuler, mais ne peuvent dépasser le salaire moyen national.
Il est vital, pour amener une nouvelle génération d’hommes politiques, d’enlever les appâts de l’avarice qui ornent le fronton du monde politique.
Trinité nationale du territoire :
La République française avait à son origine pour triptyque : commune, département, État ; nous aurons pour notre part, un triptyque semblable, mais plus adaptée aux nécessités géographiques et culturelles plutôt que politiques et administratives. Notre trinité sera : commune, Assemblée provinciale, Nation. Les structures intermédiaires, telles que les agglomérations, ayant pour conséquence la concentration urbaine, la centralisation des domaines de compétences, la désertification rurale, etc., sont à réduire ou à annihiler. Une coordination des communes et une coordination des provinces doivent subsister, mais uniquement d’ordre administrative et technique ; pas d’élus.
Défendre la nation, c’est défendre ses ramifications à toutes les échelles. Défendre une ramification locale allant contre le principe même de la nation, c’est se suicider. Le régionalisme promu par l’Union européenne en est un exemple.
Je ne développerai pas plus avant, voulant rester dans l’esquisse. Des systèmes de renversement, etc. seraient à développer…

« Un modèle différent pour la Nation française »
par David Berton, le 26 août 2015
- - - - -
Il y a quelques semaines, Libération publiait une étude d’une agence de Publicis, soulignant la volonté de ‘‘coup d’État citoyen’’ de notre classe moyenne, rejetant une vie politique ternie par les scandales, le manque de transparence et de résultats, et le storytelling à outrance. Le 11 janvier 2015, des millions de Français - musulmans, juifs, catholiques, laïques, blacks, blancs, beurs... - défilaient ensemble pour rappeler les valeurs qui font le socle de notre République. Certains parlèrent de marche citoyenne, d’autres de manifestation, et beaucoup eurent des difficultés à qualifier ce qui était en train de se passer. Jérôme Fourquet et Alain Mergier, de la Fondation Jaurès, ont dans un ouvrage récent évoqué les épisodes de janvier 2015 comme un catalyseur, amplifiant deux processus : la volonté de soulèvement populaire, qui prend ses racines dans notre histoire nationale, ainsi que l’écart entre la France silencieuse, que beaucoup ont eu pour dessein d’invoquer ces derniers mois, et la France qui se réveille et s’exprime dans la rue. Cette forme d’ébullition populaire pourrait faire écho à d’autres situations, dans d’autres pays européens où extrêmes de tous bords avancent pour prendre le pouvoir - s’ils ne l’ont déjà conquis. Le peuple crie pour se faire entendre, partout sur notre vieux continent, et les politiques s’écartent, de peur de recevoir un quelconque retour de bâton. Et ces cris ne sont que l’écho d’un problème bien ancré dans notre système politique depuis des dizaines d’années : cette triple crise démocratique dont on essaie de taire l’existence.
Une crise démocratique à l’échelon national, de prime abord, avec une difficulté des politiques à porter les convictions des citoyens qu’ils représentent, et un manque de pédagogie consternant. Peu de députés vont aujourd’hui sur le terrain pour expliquer ce qu’il se passe en Assemblée, pour justifier leurs idées et prises de position, de peur de ne pas être réélus. Sans parler des sénateurs, qui ont pour beaucoup et depuis bien longtemps oublié le sens de la mission républicaine qui leur a été confiée : le Sénat est devenu désuet, incapable de représenter les intérêts territoriaux, et enclin souvent aux intérêts purement partisans. Le Gouvernement de Manuel Valls ne porte que peu d’ambitions sur le long-terme pour notre pays, et chaque ministre, quand il a du poids politiquement parlant, s’attelle à faire des réformes qui pour la plupart sont mal ficelées, sans ligne politique claire ou, au contraire, jouant sur des clivages qui ne refondent en rien le domaine qu’il est censé porter. Emmanuel Macron, qui a pour fil directeur le déverrouillage des vieux dogmes économiques français, s’est heurté aux rouages technocratiques et corporatistes qui ont fait de sa première loi un projet certes ambitieux, mais affaibli par de nombreux intérêts particuliers qui n’ont en rien rendu service à l’intérêt général.
Ces blocages, on ne le dit pas assez, viennent non seulement de clivages archaïques, mais aussi d’une élite technocrate formée pour maintenir des blocages qui ne nous permettent pas de participer pleinement au challenge de la globalisation. Ces ‘‘verrouilleurs’’ prennent la place du peuple, censé être souverain, dans la construction de nos lois. Depuis quand n’avons nous pas eu de consultation citoyenne d’envergure, alors que des sujets cruciaux font notre actualité ? On pense à l’afflux de réfugiés vers notre vieux continent, par exemple. On en vient ici à un autre échelon qui connaît une crise démocratique sans précédent.
La chose européenne, incomprise depuis plus de dix ans, ne peut avancer tant que le dessein européen n’est pas expliqué, valorisé et repensé. Et il doit l’être par le peuple européen, pour le peuple européen. Le président de la République évoquait récemment l’idée d’un gouvernement et d’un Parlement de la zone euro, une réflexion qui n’est en rien nouvelle. Qu’il ose, comme d’autres chefs d’État européens, demander au peuple son avis ! Les différentes études d’opinion montrent que les Français, comme d’autres nations européennes, y sont pleinement favorables. L’Union Européenne du début de XXIe siècle doit être démocratique ou ne sera plus sous peu. Elle peut être ainsi fédérale, si ce projet est porté par le peuple, et pensé par nos politiques et intellectuels, qui sont là pour jouer ce rôle. Quel Victor Hugo ou Aristide Briand du XXIe osera parler à nouveau d’États-Unis d’Europe ? Oser, toujours ce mot. Encore. Parce qu’oser n’est plus le maître mot de notre vie politique. Même les Démocrates, s’ils ne sont pas jeunes et optimistes, ont perdu cette rhétorique.
A l’échelon local, enfin, ceux qui veulent oser n’ont plus les moyens de le faire. La baisse des dotations des collectivités territoriales est une des plus graves erreurs de ce quinquennat, tout bonnement parce que la vie politique locale est, de nos jours, la moins décrédibilisée et la plus audible de toutes. Les investissements sont devenus trop coûteux pour être engagés si les dépenses locales ne sont pas au préalable maîtrisées. Un nombre conséquent de municipalités utilise cette baisse comme argumentaire pour justifier de leurs inactions. C’est le cas à Grenoble, pour ne citer qu’une grande ville. Pourtant, pour faire face à cette décision de diminution des dotations, qui a permis de désigner un nouveau bouc émissaire, certaines majorités se sont montrées innovantes en ‘‘faisant mieux avec moins’’, comme le fait François Bayrou sur le territoire palois. Et il n’est pas le seul.
Alors, face à cette crise, que répondre ? Sursaut démocratique.
Les règles du jeu doivent changer, avec une grande réflexion sur ce que doit être le nouveau pacte républicain, à toutes les strates. Et si la classe politique actuelle est incapable de porter cet idéal, - cette France moderne, entrant pleinement dans la globalisation pour maintenir son rang tout en créant une proximité nouvelle entre citoyens et vie politique, par le biais d’une démocratie représentative nouvelle - ce sera aux jeunes, de tous bords républicains et de toutes conditions, de le porter.
Osons parler d’une Sixième République où des règles éthiques soient mises en place, avec un fonctionnement institutionnel plus contemporain, ainsi qu’une sanctuarisation des principes qui ont marqué notre histoire nationale. Il faut, de prime abord, revoir notre organisation. Démolissons le Sénat pour le transformer en Chambre des Territoires, avec des représentants élus par le peuple pour défendre des intérêts purement locaux face aux propositions de loi qui sont soumises. Réhabilitons l’Assemblée nationale en lui redonnant son influence d’antan, inspiré du modèle outre-Rhin, avec des représentants moins importants numériquement, tout comme dans la seconde Chambre, mais représentatifs de l’ensemble des courants de pensée politique, par le biais de l’instauration du scrutin proportionnel, via le système dit de ‘‘deux voix par électeur’’.
Faisons du Premier ministre le personnage central de la vie politique nationale, avec un chef de l’État garant des institutions, et des intérêts de la nation à l’étranger. Pour une démocratie plus parlementaire, tout en restant stable. Mettons en place une justice indépendante, aux mains d’une Cour Suprême neutre, sur le modèle étatsunien. Rendons régulier l’usage du référendum, sur des sujets centraux mais qui n’aient pas vocation à diviser la France en deux ; si l’usage en est fréquent, le vote n’est plus, ou bien moins, une occasion de sanction à l’égard du Gouvernement. Attaquons-nous au cumul des mandats en interdisant la pratique de plus de deux mandats électifs, et seulement un si l’élu est maire d’une ville de plus de 50 000 habitants, ou membre voire à la tête de l’exécutif d’une grande collectivité. Sans oublier la fin d’un cumul dans le temps à outrance, avec l’interdiction de renouveler un mandat parlementaire une deuxième fois, et une troisième fois pour les mandats locaux (région, communes). Le politologue Nicolas Matyjasik soulignait récemment, dans une tribune pour le Huffington Post, la nécessité de l’évaluation des politiques publiques par et pour les citoyens, via la création d’agences citoyennes indépendantes : osons non seulement la consultation préalable, à la manière des conférences des parties sur le thème de l’écologie, pour les réformes d’ampleur, mais aussi la généralisation de ce principe d’évaluation pour tendre vers l’amélioration constante. Enfin, enterrons les ors de l’État pour que les représentants du peuple soient des représentants du peuple, et non des monarques républicains.
Supprimons les départements pour laisser place à des régions fortes, ouvertes sur le monde, compétitives et proches des citoyens. Des référendums régionaux seraient possibles, un représentant régional serait désigné pour chaque département par la majorité élue, et des maisons de la Région seraient mises en place partout où cela serait nécessaire, comme intermédiaires entre l’élu et le citoyen. Maintenons les communautés de communes dans leurs prérogatives actuelles, tout en réfléchissant à de nouvelles compétences, de façon à ce que les deux échelons soient complémentaires. Rationalisons les moyens des collectivités territoriales pour qu’elles soient plus efficaces et plus lisibles, tout en favorisant la fusion de nombreuses communes, pour qu’il n’y ait plus, à terme, de villes comptant moins de 2000 habitants. Augmentons les dotations vers les collectivités territoriales pour les sanctuariser par la suite. Redonnons à l’expression ‘‘démocratie locale’’ son véritable sens, avec la généralisation des forums citoyens dans chaque ville, et selon la superficie, dans chaque quartier, ainsi que la possibilité de référendums locaux non pas consultatifs mais décisionnaires.
De cette manière, nous pourrons inspirer et porter un nouveau modèle européen, fédéral, libre et démocratique, muni d’un président de l’Union européenne, avec un gouvernement élu par le peuple, et un Parlement européen qui ne sera plus seulement à l’aune de directives vues par le peuple comme un lot de blocages, mais porteur de plans divers ambitieux et financièrement conséquents. Rendons là aussi possible la consultation populaire européenne lorsque des pétitions atteignent un certain nombre de voix, venant d’un certain nombre de pays de l’UE. Il en irait de même pour la strate française, lorsqu’une pétition atteindrait plus de 500 000 signatures. Ben Rattray, fondateur de Change.org, a d’ailleurs eu des mots justes à ce sujet : ‘‘Ce sont les petites choses qui font changer le monde’’.
Ces idées, bien évidemment non exhaustives, pourraient redonner à la France sa crédibilité en matière de démocratie, d’humanisme et de liberté. Les Français en sont capables et n’attendent même que ça : une révolution citoyenne pacifique pour tourner une page de notre histoire et laisser place à la France et l’Europe du XXIe siècle. Aux jeunes de porter ce sursaut, et de construire cette nouvelle République !

« Pour une VIe République de la jeunesse ! »
par Loïc Terrenes, le 30 août 2015
- - - - -
On ne le dit pas assez mais la France a la chance d’avoir des institutions solides, une culture démocratique ancrée et un processus législatif qui fonctionne. Il est peut-être simpliste de le rappeler mais les réelles démocraties sont encore minoritaires dans le monde (quand ce n’est pas tout bonnement le chaos, comme en Libye ou en Syrie). Qu’on pense aux pays d’Afrique, où la quasi-totalité des régimes sont des dictatures militaires ou familiales, à l’Asie, où règnent partis uniques et corruption, à l’Amérique centrale, avec des institutions gangrenées par les cartels... l’Europe et singulièrement la France peuvent s’enorgueillir d’une stabilité démocratique depuis des décennies.
Cela étant dit, on ne peut se reposer sur l’outil de comparaison pour affirmer que, la situation étant pire ailleurs, elle n’est pas chez nous perfectible. La démocratie n’est pas une chose installée, c’est un idéal à poursuivre, vers lequel on doit tendre. Et tant qu’en France il existera des affaires de corruption, de fraude (Jérôme Cahuzac...), d’abus de biens publics (Agnès Saal...) et de tricheries électorales, on ne pourra pas s’étendre sur nos acquis et dire que le travail est terminé. Améliorer les institutions et les conditions d’organisation de la chose publique reste un combat de tous les jours.
On pourra se satisfaire du fait qu’il ne s’agit que d’épiphénomènes, que la majorité de la classe politique reste dévouée au bien-être des citoyens lambda et que les « affaires » ne concernent heureusement que quelques élus ou hauts fonctionnaires. Ce serait oublier que le diable se cache dans les détails. Pour voir (un peu) de l’intérieur comment les choses fonctionnent, pour entendre les vantardises des uns et les coups de manche des autres, il faut reconnaître qu’il demeure chez nos représentants une culture de la « chose due » qui en invite beaucoup à profiter du système, au moins par petites touches. Des banquets dans les ministères sans lien avec le portefeuille du ministre, des voitures de fonction ou une protection rapprochée pour des personnes qui pourraient tout autant bien prendre le métro (comme en Scandinavie), des notes de restaurant et de déplacement sans réel lien avec l’objet de leur mandat... Ça peut paraître peu de chose, mais à la longue ça fait beaucoup.
Premier point, il faut donc rompre avec les privilèges. Pas forcement refaire une « nuit du 4 août », mais réduire drastiquement tout ce qui bénéficie aux élus plus par tradition que nécessité. Trajets gratuits pour la famille, frais de représentation, chauffeurs pour de simples adjoints, ristournes sur des voyages pas vraiment professionnels, etc.
Second point, il faut faire promouvoir le mérite sur les accointances personnelles. Pourquoi ne pas s’inspirer des États-Unis où les ministres et dirigeants d’institutions publiques doivent passer une audition devant le Sénat, exposer leur projet et faire état de leur expérience ? On pourrait imaginer une commission bipartisane qui ne serait pas suspecte de règlements de comptes politiques et qui permettrait d’en finir avec ces nominations faites dans les couloirs feutrés des salons dorés pour récompenser untel et promouvoir les amis. De la même façon, il faudrait, comme le proposa Dominique de Villepin par le passé, inscrire dans le marbre une dizaine de portefeuilles ministériels inamovibles, ce qui permettrait d’empêcher la création de portefeuilles uniquement dévolus à caser les membres de chaque courant du parti au pouvoir (« Ministère délégué au Développement », « Ministère délégué à la Réussite éducative ») et regrouper les secrétariats d’État (Personnes âgées, Réforme administrative...) dans des directions de ministères. Et tant qu’à faire, attendre des personnalités nommées qu’elles connaissent à fond leur dossier (un universitaire à l’Éducation nationale, un président de syndicat agricole à l’Agriculture, un économiste à Bercy...) plutôt que voir à chaque valse de remaniements des titulaires qui découvrent leur poste le jour même et des apparatchiks nommés parce qu’ils hantent depuis des années les couloirs des partis, parfois sans études, en tout cas en ayant rarement, voire jamais, eu d’expérience professionnelle hors ce cadre.
Troisième point, il faut garantir la totale indépendance des médias. Non pas souhaiter que les journalistes deviennent des hyènes enragées face à des ministres obligés de démissionner car simplement soupçonnés, mais laisser à la presse la liberté de mener les enquêtes qu’elle veut, accéder aux documents et pouvoir être autre chose que des porte-parole à la déontologie douteuse, comme ces grands pontes de l’audiovisuel qui se font payer des fortunes pour animer des séminaires d’entreprise avant de dîner tous frais payés dans les palais de la République avec un membre du gouvernement dont il aura ciré les pompes dans un édito. Le journalisme, c’est « tremper la plume dans la plaie » disait Albert Londres. Ce n’est pas l’honneur de la France de voir des articles web modifiés à la suite d’appels de pression ou de journaux empêchés de sortie à la suite d’un coup de fil de ministre.
Quatrième et dernier point, assurer la pérennité de nos institutions tout en les transformant. Je ne suis pas favorable au délire de VIe République, juste exalté pour le plaisir de changer de chiffre. La France a une histoire, des habitudes politiques, et je ne pense pas qu’il serait faisable de greffer un système parlementaire à la danoise (quand bien même on peut s’en inspirer). Le retour des jeux de pouvoir façon IVe République, des micro-partis sans base électorale représentés au Parlement, l’impossibilité d’avoir une large majorité... tout cela participerait plus à la déstabilisation qu’autre chose. Mais introduire une dose de proportionnelle, instaurer des primaires locales (facilement faisable avec Internet) pour désigner les candidats au lieu de voir des parachutés imposés, faire en sorte qu’un certain seuil de vote blanc oblige à recommencer l’élection, limiter les mandats dans le temps, rajeunir, féminiser et diversifier les origines de la classe politique, alléger la procédure des référendums populaires, réduire le poids et l’influence néfaste de certains lobbys (qui osent encore aujourd’hui donner des places de concert à des députés pour qu’ils soutiennent des projets de loi), éjecter définitivement de la vie politique les élus condamnés pour faute grave, etc... tout cela concourrait à assainir le processus.
Je reste un optimiste. Sans croire à un fumeux « sens de l’Histoire », je reste convaincu qu’année après année, par petits pas plus que par esprit révolutionnaire, la vie politique française est moins sale. Les années 80 et leurs valises de billets, les journalistes qui se font dicter leurs textes, les petites peines pour les magouilleurs, tout cela se réduit et tend à disparaître. Internet, le développement des associations anti-corruption et la transparence participent à créer un environnement plus sain. Gageons que nos représentons continueront à aller en ce sens et comprendront qu’aujourd’hui plus qu’hier, les comportements inacceptables ne sont plus de l’ordre du détail, et que s’ils veulent être réélus, ils ont un devoir d’exemplarité, et pas seulement sur leurs prospectus électoraux.
« Vers un assainissement de notre démocratie »
par Arthur Choiseul, le 9 septembre 2015
- - - - -
Refonder la République. Mais d’abord... pourquoi ?
Après tout, notre exécutif ne semble pas outre mesure entravé dans son action : les lois sont toujours votées – au grès parfois de quelques comédies médiatiques, mais en général, toujours votées – et nous ne connaissons pas ces phases d’instabilité gouvernementale à répétition qui caractérisait la fin de la IVe République. Au fond, la mécanique de la Ve République, renforcée par le quinquennat, semble assez bien remplir son office premier : celui de privilégier l’action d’une majorité – fusse-t-elle juste moins minoritaire que les autres – plutôt que la paralysie des institutions.
Oui mais voilà, il y a tout de même quelques symptômes qui ne trompent pas :
1. Même s’il y a déjà eu par le passé des taux d’abstention importants, on ne peut nier une tendance générale à l’augmentation de celui-ci depuis les années 90, et plus fortement encore depuis les années 2000.
2. Les électeurs sont, dans un même temps, plus nombreux à se détourner des partis qui gouvernent habituellement la France et ses échelons territoriaux, au profit de formations souvent plus extrémistes.
3. Enfin, et c’est finalement le pire de nos échecs : bien que nos majorités et nos oppositions donnent toujours l’impression d’être en mouvement, bien que les débats, les lois et les mesures se succèdent, la France est toujours incapable de se réformer sur autre chose que des détails. Au fond, à l’« esprit de la Ve République » qui préférait l’action à la paralysie, nous sommes en droit maintenant de demander : « à quoi sert l’action, si c’est celle de piétiner sur place ? »
Quand communiquer vaut mieux que répondre
Mais la cause de ce double constat de désaffection citoyenne et d’impuissance politique est-elle seulement institutionnelle ? Notre manière de faire de la politique, ou d’en parler n’est-elle pas également en cause ? Se contenter de changer les règles du jeu changerait-il le résultat final ?
À une époque où la multiplication et l’intensification des canaux d’information a imposé la communication comme nécessité d’existence politique, et les diverses côtes de popularité comme principale boussole, montrer que l’on s’attache à résoudre un problème semble être devenu plus important que de le résoudre effectivement, et répondre vite semble valoir mieux que répondre juste.
Il arrive même que la mesure ou la décision politique elle-même soit vidée de toute autre fonction que celle de « communiquer », de montrer que l’on agit. Mais au final, une fois la frénésie de l’actualité passée, qu’en reste-t-il ? La montagne accouche trop souvent d’une souris. Comment, dans ces conditions, imaginer que l’action politique soit encore perçue comme ayant l’ambition de répondre durablement – et pertinemment – aux problématiques posées ?
Un déficit de légitimité
Pour autant, la mise en cause des pratiques politiciennes et médiatiques dans le bilan de l’impuissance républicaine ne doivent pas occulter un autre aspect du problème : celui du déficit de légitimité à la tête de l’État ! Au fond :
- Le Président de la République, élu au suffrage universel direct, n’est jamais que le plus apprécié des deux candidats ayant obtenu les meilleurs scores au premier tour. Mais aucun n’a jamais obtenu plus d’un tiers des suffrages au premier tour ! (sur les 40 dernières années)
- La composition finale de l’Assemblée nationale, désormais élue juste après le Président de la République, ne reflète pas plus la disparité des opinions exprimées au premier tour dans l’ensemble des circonscriptions de France : elle ne sert qu’à asseoir suffisamment largement la majorité du parti présidentiel, balayant même la nécessité de composer des coalitions.
- Comment imaginer alors que le Gouvernement, issu de la majorité à l’Assemblée, ne soit pas inféodé à l’autorité du Président de la République nouvellement élu ou réélu, alors même que l’esprit de nos institutions instaure un « Président arbitre » et un Premier ministre menant la politique gouvernementale ?
- Le Sénat, enfin, n’est pas mieux loti en termes de représentation des opinions citoyennes, avec un mode de scrutin complexe qui ne favorise que l’émergence de quelques « grosses écuries ».
Au final, le parti gouvernemental est dispensé d’avoir à composer, discuter, négocier, avec des partenaires : il peut faire passer sans trop de mal la quasi-totalité de sa politique sans vrais risques de blocage. Il perd ainsi l’occasion de se remettre parfois en cause, et de réfléchir à l’efficacité et au bien-fondé de son action, en général comme dans les détails. Mais surtout, il perd également la légitimité nécessaire à réformer en profondeur la nation, parce qu’il ne représente jamais qu’au plus un tiers de l’opinion citoyenne, et ne peut jamais se prévaloir que de ce tiers face aux deux autres.
Ceci dit, quelles solutions ?
1° Encourager l’exigence citoyenne
Nous devons prendre conscience que nous avons changé d’ère en termes de communication politique et institutionnelle, à l’échelle mondiale, depuis quelques dizaines d’années. Il serait illusoire voire nocif d’imaginer changer par la loi la pertinence de la communication politique et de sa diffusion médiatique.
C’est au peuple, finalement, de choisir s’il souhaite être exigeant, et privilégier ceux qui répondent juste à ceux qui répondent vite ou fort. En la matière, le seul pouvoir qu’il nous est offert d’exercer, élus, militants, acteurs de la vie associative on institutionnelle, vecteurs d’opinion, c’est celui d’encourager nos concitoyens à être exigeants.
2° Lutter pour la transparence et contre le mélange des intérêts
Qu’il s’agisse du pouvoir politique (législatif, exécutif, territorial), du pouvoir judiciaire, du pouvoir médiatique, ou du pouvoir économique, il est impératif de lutter contre le mélange des intérêts de tous ordres (commerciaux, personnels, corporatistes, partisans…). C’est une chose aisée à dire, et bien plus délicate à mettre en œuvre efficacement sans tomber dans l’abus. Aucune tribune ne permettrait de répondre précisément à un problème aussi épineux, sur ce sujet, nous avons besoin d’un vrai débat citoyen, large, et long si nécessaire.
Deux pistes toutefois :
Une plus grande transparence concernant le train de vie des élus permettrait certainement de mettre un terme à certains fantasmes du « tous profiteurs » d’un côté, et de lutter également de l’autre contre la corruption. Dans une République où le lien de confiance entre citoyens et élus est de plus en plus fragile, peut-être faut-il en passer par là, « montrer patte blanche » ?
Un meilleur cloisonnement – ou tout du moins contrôle – entre les responsabilités électives et les pouvoirs de nomination dans les hautes fonctions administratives, judiciaires, ou dans l’audiovisuelle publique – pour ne citer que ces 3 pouvoirs – permettraient certainement de lutter contre les innombrables tentatives de « verrouillages » partisans que l’on observe un peu à tous les échelons de la République.
3° Fonder une VIe République
Nous devrons un jour résoudre l’équation apparemment impossible qui consiste à permettre l’action et la stabilité gouvernementale tout en respectant dans les proportions, la diversité des opinions citoyennes.
Le bicaméralisme (le fait que le parlement soit constitué de deux assemblées, aujourd’hui Assemblée nationale et Sénat) nous offre peut-être une voie… mais pas un bicaméralisme où, comme c’est le cas aujourd’hui, l’une des chambres ne soit qu’un doublon de la seconde !
Notre gouvernement n’a besoin que d’une chambre, en vérité, pour élaborer sa politique « quotidienne », pourquoi ne pas refondre la seconde chambre pour que, via une élection à la proportionnelle intégrale (et avec un nombre restreint de sièges, pour plus de lisibilité, pourquoi pas 100 tout rond ?) cette dernière devienne le reflet le plus fidèle possible de la diversité des opinions citoyennes. À cette seconde chambre reviendrait alors les pouvoirs de décisions sur des points plus profonds ou structurels de notre organisation républicaine et de notre législation. (On constate d’ailleurs qu’une telle distinction entre différents niveaux de décisions existe déjà sous la Ve République, via notamment la distinction entre la gouvernance par décrets et la gouvernance par la loi)
On pourrait enfin imaginer confier à cette seconde chambre un plus grand pouvoir de regard ou de décision quant aux nominations et révocations aux postes clés de l’administration, de la justice, et autres organismes d’État… un moyen aussi de lutter contre le népotisme.
4° Clarifier, simplifier, alléger l’organisation territoriale et étatique
Ce n’est pas une question aussi prioritaire que les trois points précédents. Toutefois, elle devra un jour vraiment être traitée. Nos réformes successives des collectivités territoriales n’ont fait qu’empiler de nouvelles structures, gonfler les dépenses, générer des doublons… à tel point que certains de nos concitoyens n’y voient plus là – à tort ou à raison – que des « structures pour caser les copains ».
Déplorable en terme d’image, d’efficacité, de déséquilibre des comptes publics – que l’on renfloue aujourd’hui grâce à des dettes dont nos enfants paieront demain le prix – le « mille-feuille français » n’a jamais vraiment été allégé, bien au contraire. La grande gabegie doit cesser !
Conclusion
Réécrire les « règles du jeu » ne suffira pas à réconcilier la politique française avec les citoyens, nous avons également besoin d’exigence, l’exigence des citoyens vis-à-vis de leurs représentants et de la couverture médiatique, exigence des élus et des médias vis-à-vis d’eux-mêmes, exigence, enfin, des militants vis-à-vis des cadres de leurs partis.
Le premier pouvoir du peuple, en démocratie, est certainement celui de choisir ces représentants – ses dirigeants – mais si le peuple venait à négliger ce pouvoir qui est le sien, c’est le fonctionnement même de la démocratie qui serait remis en cause, et avec elle, la liberté qu’elle garantit et l’égalité qu’elle promeut.

« Soyons exigeants... soyez exigeants ! »
par Christophe Vasquez, le 11 septembre 2015
- - - - -
Trop peu connaissent l’épisode historique qui faillit mener à la fusion des gouvernements britannique et français, et de leurs empires coloniaux, en 1940. Il fallait des esprits visionnaires et audacieux comme Churchill et De Gaulle, pénétrés de l’amour profondde leur patrie autant que conscients des soubresauts du monde, pour concevoir et mettre en œuvre un tel projet. Face à un péril immense et un basculement inévitable, choisir de se fondre pour évoluer et persister sous une forme nouvelle, ou risquer l’anéantissement.
Là est le cœur du débat sur les institutions, la démocratie, la société. Nous sommes dans une période de fluctuations comparable à 1940 et non pas à 1958. Ne tombons pas dans l’écueil facile et futile d’une discussion mécaniste, proposant telle réforme électorale ou révision des échelons institutionnels, telle nouvelle République, telle méthode pour remobiliser les citoyens, telle autre pour renouveler la classe politique. Ce serait être bien crédule que de considérer un traitement par feuille ou par branche quand c’est l’arbre en son entier qu’il faut soigner.
Les institutions ne sont pas ahistoriques. Elles sont, au contraire, intrinsèquement liées à une époque, aux aspirations d’une population, à l’état des savoirs. Par conséquent, elles sont changeantes et mortelles. C’est un conservatisme malsain de souhaiter leur immuabilité, au risque de les vider de leur essence fondamentale – fournir une organisation des rapports humains adaptée aux exigences du moment – et d’entraîner leur inadaptation, leur dessiccation. Pire, si ces institutions sont démocratiques, c’est livrer la démocratie inopérante et la souveraineté populaire abandonnée à quelque tyran malin.
Le constat est souvent partagé – notamment en France (voir l’ouvrage de Pierre Rosanvallon) – que l’organisation politique de notre société est dépassée, caduque. Il ne semble pas aventureux d’affirmer que la République française est un temple sacré qui n’a plus ni fondations ni colonnades, de rares sectateurs pour beaucoup de mécréants, mais qui demeure par le confort de l’habitude.
Pourtant personne ne veut pointer et nommer la cause véritable. On ne peut comprendre l’état actuel de nos institutions et penser les institutions à venir sans prendre en compte la mort de l’État-nation, sans observer les trépidations puissantes qui agitent le monde ni expliciter les défis qui s’imposent à nous.
Aborder la mort de l’État-nation, c’est s’attendre à des cris d’orfraie convenus. L’État-nation est érigé en idole. Il a les beaux atours postiches d’un modèle structurant et indépassable de nos sociétés, bien qu’il n’ait émergé que deux siècles plus tôt. La civilisation l’a précédé et nous parions que le chaos ne suivra pas sa disparition. L’État-nation est la congruence opportune de deux éléments : l’État, en tant qu’entité politique qui régente l’organisation de la société et l’exercice courant de la souveraineté ; et la nation, ce groupement qui unit les individus entre eux et les particularise par rapport à d’autres groupes d’individus.
Le succès de l’État-nation au XXème siècle est incontestable, il devient la forme dominante et quasi-exclusive, grâce à un mouvement centripète qui accompagne l’explosion des empires et légitime les revendications nationalistes. Cette parcellisation du monde a lieu avec l’assentiment des États-Unis et de l’Occident. Évidemment, toutes les revendications nationalistes ne sont pas satisfaites, le processus connaît des ratés et des États multinationaux se maintiennent. La victoire n’est pas absolue mais la tendance est nette.
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’État-nation est toujours là mais il décline. Considérons ses parties pour juger de l’ensemble, en nous restreignant au cas de la France. La nation, tout d’abord. Toutes les analyses et toutes les définitions pour qualifier la “nation française” actuelle sont battues en brèche car les constituants objectifs et subjectifs disparaissent les uns après les autres. La religion, l’armée, l’école, la famille, l’histoire, la culture, la langue... tous ces éléments qui favorisent et entretiennent le lien sociétal – et participent donc au maintien de la nation – se trouvent affaiblis, dilués, abandonnés. L’on pourrait détailler longuement et individuellement ces éléments mais chacun saisit aisément les enjeux qu’ils sous-tendent et les polémiques qui surgissent à leur propos.
Dès lors, peut-il encore y avoir une nation lorsque les liens qui permettent de faire société et de se singulariser sont à ce point distendus ? La nation n’a plus de sens, à l’heure où les frontières physiques sont abolies, où les rapports humains sont redéfinis par la communication et le numérique. Pour preuve, le renouveau des régionalismes sans revendication d’indépendance ou du “communautarisme”, qui ne doivent pas nécessairement être perçus comme des menaces (voir les travaux de Michel Maffessoli).
La dimension nationale n’est plus pertinente car chaque individu se sent singulier, s'attache à des communautés (linguistique, ethnique, culturelle…) qui ne sont pas confondues avec la communauté nationale. D’ailleurs, ce sentiment national n’est pas inné, il ne peut exister que s’il est stimulé, et les stimuli sont rares dans la France d’aujourd’hui. À tout le moins, le lien national se réanime lors de certaines occasions, où l’émotion sert de vecteur à la cohésion (commémoration mémorielle ou attentat, définition d’un ennemi commun…). Il faut voir aussi en cela un symptôme de l’impuissance croissante de l’État, qui ne mobilise plus sa nation en dehors de ces circonstances exceptionnelles.
L’État (et en particulier l’État démocratique, par nature limité et contrôlé dans l’usage de ses moyens d’action, à l’inverse de l’État autoritaire) devient impotent face à un monde qui invente des règles permettant de se passer de lui. On ne peut ignorer que l’économie prime désormais sur le politique.
Il serait d’ailleurs intéressant d’observer le grignotage des fonds privés et mécénats sur les missions régaliennes de l’État, dans des domaines aussi divers que la recherche, la culture, l’éducation, etc. C’est un autre sujet. Quoi qu’il en soit, les véritables leviers sont économiques. La croissance, le chômage, sont des maux que le pouvoir politique ne peut endiguer seul. Le marché n’a pas de frontière, pas de visage, guère de limites et peu d’unicité, puisque les règles du capitalisme ne sont pas unifiées au niveau mondial.
L’État s’endette, s’échine à atténuer les variations économiques qui ont un impact sur la population, sans succès. L’ultime levier encore entre ses mains – qui lui permet de réaffirmer sa force et son utilité – c’est l’impératif de sécurité, primordiale pour la population autant que pour la stabilité économique. De ce point de vue, le terrorisme se révèle une calamité aux atouts opportuns, puisque l’existence de l’État est confortée et justifiée s’il se mobilise pour la protection des citoyens et des biens. Le résultat est néanmoins mitigé. C’est que même en ce domaine, l’État est faible. Le crime est mondialisé, ses sources de financement aussi, et aucune politique mondiale efficace ne vient gêner ce système.
Ainsi, le meilleur indice – et le plus terrible – de la mort de l’État-nation est peut-être la naissance de Daech. Il est par nature transnational voire international, fondant sa cohésion sur une certaine vison extrémiste de la religion musulmane. Il n’a pas d’État à proprement parler, fixe ses propres règles, défie l’équilibre mondial des frontières et des puissances, attaque tout pays sans déclaration de guerre et par “des intermédiaires” grâce à l’endoctrinement, se rétribue sur le pétrole ou le trafic d’œuvres d’art. Il n’a que faire du bien-être de sa population et de son développement. Cette entité obscurantiste est animée par le double objectif de conquérir et convertir.
Le succès de cette entreprise de terreur vient de sa “liberté”, n’étant pas restreint par un carcan et des normes inadaptés. Le péril est grand que nos États-nations ne puissent plus faire illusion longtemps et que leur déclin entraîne des régressions qui nous plongeraient dans une ère de troubles. Ce n’est certainement pas le souhait des populations. Il est donc temps de prendre acte du changement mondial.
Notre monde est traversé de courants puissants, parfois antagonistes, qui transforment irrémédiablement l’organisation des sociétés humaines. Ne sous-estimons pas la force et le triomphe de l’idée, du virtuel, sur le réel. Cela induit la création, la coexistence et bientôt la concurrence, avec un autre univers. Internet en est l’illustration la plus simple, l’individu s’y dépasse, se réinvente, les États n’y ont quasiment aucune autorité, c’est un monde illimité, instantané, aujourd’hui livré à lui-même. Et l’individu qui y pénètre est également livré à lui-même. Il doit juger les informations qu’il reçoit sans toujours en discerner la réalité, il peut enfreindre les lois de son pays en achetant drogues, armes, prestations sexuelles…
Dans un registre moins grave, la mise en réseau de tous les individus offre un potentiel de partage jamais égalé : partage de sa voiture, de sa maison, de ses compétences… Chacun a quelque chose à offrir et recherche quelque chose. Cette économie du partage, économie participative, cette “ubérisation” diront certains, redéfinit la réalité et remet en cause, par exemple, l’existence de certaines professions organisées. Certains (tel Jeremy Rifkin) vont mêmes jusqu’à théoriser l’effondrement du système industriel et la mutation du salariat. L’économie fait face à son propre bouleversement et c’est une formidable occasion pour les citoyens de se ressaisir du pouvoir perdu par le politique.
Cet autre monde, virtuel et immatériel, influence donc de manière croissante le monde physique. Le progrès technologique a pulvérisé les cadres de pensée et l’horizon des possibles est béant. Puisque l’idée devient reine, tout est réalisable, au service du plus grand bien comme des plus grandes folies. On le voit avec les inquiétudes naissantes autour de l’impression 3D, du transhumanisme, de l’intelligence artificielle. Chacun va pouvoir concevoir et obtenir ce dont il a envie, sous la forme et au moment souhaité. Le triomphe de l’idée est aussi le triomphe de l’égoïsme.
La déconstruction de l’homme ancien est à l’œuvre avec la perte de nos illusions : la fin de la perspective d’un développement infini, la fin probable du prétexte d’existence par le travail au gré des avancées technologiques… un citoyen nouveau naît, s’invente, une autre vie en quelque sorte. Sous cet angle, l’inquiétude de certains scientifiques (menés par l’astrophysicien Stephen Hawking) vis-à-vis d’une intelligence artificielle qui supplanterait l’homme, n’est pas une idiotie. Si l’on dépossède l’homme de toute utilité et de tout intérêt de vivre, si l’humanité curieuse, ambitieuse, inventive est éternellement battue par la supériorité de la machine et tombe sous son joug comme une proie, quel avenir obscur !
Dès lors, pour ce nouveau citoyen et cette nouvelle société, tout ne peut pas être acceptable, il faut établir des règles. Qui alors pour imposer une règle ? On l’aura compris, la structuration des mondes physiques et virtuels est distincte, et les schémas du réel ne peuvent être appliqués au virtuel ni réunir ces deux mondes. L’État, et plus encore l’État-nation, ne nous semble plus apte pour régenter cela.
Il faut maintenant raisonner à l’échelon supra-étatique, ce que la grande majorité des pays a commencé à faire depuis plusieurs décennies, avec des niveaux d’intégration très divers (Union européenne, ASEAN, Union africaine…). L’avenir est au regroupement et plus à l'éparpillement, à la création de nouveaux empires continentaux. Le mouvement est enclenché mais le défi est ailleurs. Les citoyens soucieux de préserver les acquis démocratiques devraient s’engager pour un fédéralisme mondial, un universalisme qui créerait des institutions mondiales réellement détentrice d’un pouvoir. En somme, un “giga-État” capable de fixer des principes planétaires.
Un “giga-État” capable d’unifier et de réguler le fonctionnement de l’économie capitaliste, de combattre la criminalité et le terrorisme, de protéger les libertés et les Droits de l’Homme, de reprendre le contrôle du monde virtuel, de définir universellement les règles que l’humanité s’impose à elle-même face à l'emballement technologique. Les institutions mondiales, comme l’ONU, nées après de grands traumatismes, sont une esquisse et une base qu’il faut améliorer et amplifier. Nous avons renoncé, depuis la seconde moitié du XXème siècle, à poursuivre véritablement cet élan universaliste.
Aux problèmes du monde actuel, il est indispensable d’apporter une réponse politique. Il ne faut pas avoir peur de la mort de l’État-nation, de la vieille société mais il faut l’accompagner, préparer la transition vers quelque chose de plus haut, de différent. Se fondre et se regrouper pour évoluer, sinon disparaître. Il ne faut pas céder au fatalisme et à l’obscurantisme, ne pas abdiquer devant la barbarie des réactionnaires et l’enthousiasme incontrôlé des progressistes.
Une voie médiane est envisageable, souhaitable. Nos sociétés plurielles, dont la cohérence et la cohésion ne sont assurées, doivent s'accepter et se dépasser. Les individus ne peuvent plus être catégorisés ni les États limités par des frontières. Il faut raisonner en termes d’humanité et plus de nationalité, d’universalité et plus de territorialité parcellaire. La contiguïté des sociétés n’existe plus, elles s’interpénètrent, s’influencent d’une manière décuplée, sont étroitement liées par la technologie. Telle catastrophe du bout du monde mobilise chez nous et telle nouveauté à la mode ici traversera demain les océans.
La recherche d’une nouvelle forme d’universalité fraternelle non uniformisatrice, voilà le vrai défi, l’unique défi du XXIème siècle. Cela doit se faire par étapes car, nonobstant la mise en réseau de l’humanité, certaines barrières mentales résistent face à l’impensé de la globalité. Sans doute la naissance d’une Europe fédérale, où les États abandonnent définitivement leurs pouvoirs, est un premier palier à atteindre, si l’on reste sur la construction déjà entamée et qui se fonde sur des critères historico-géographiques. L’on pourrait imaginer une toute autre intégration, fondée par exemple sur la francophonie, avec la création d’une entité supranationale fédéraliste mêlant la France, la Belgique, le Québec et des pays d’Afrique.
Qu’importe le lien que l’on mobilise et la justification que l’on donne, la finalité est le dépassement de l’État-nation. La religion, la couleur de peau, la nationalité, tout cela n’est plus structurant. Ce qui compte désormais est bien plus fort : ce sont les manières de vivre et de concevoir l’avenir.
Concomitamment, il faut rejeter toute tentation uniformisatrice, qui ne peut être source que de résistances violentes, l’expression d’une peur de la disparition. La conflagration contemporaine vient de cela. Le communautarisme, le terrorisme, prolifèrent par le truchement de l’incompréhension, de l’inquiétude, de l’instinct réactionnaire pour la survie de sa civilisation et de soi-même. La haine de l’Autre et le repli sur soi sont les serviteurs d’une protection désespérée.
On a laissé les identités, les sociétés, les cultures se livrer une véritable guerre, une concurrence libérale – au sens économique – où le plus offrant, le meilleur communicant, pouvait emporter la mise. Comment s’étonner alors de toutes ces identités frustrées, spoliées, ces unités nationales perdues (si tant est qu’elles aient véritablement existées). La radicalité germe quand il n’y a plus de rationalité, et le monde actuel n’est pas rationnel. Les crises qu’on laisse s’envenimer tout en sachant les solutions à mettre en œuvre, sont un aveu de folie et d’impuissance.
La situation migratoire, la criminalité... ces problèmes d’envergure appellent des réponses à grande échelle, nous le savons tous. Les frontières héritées des deux guerres mondiales et la parcellisation nationaliste – cette recherche du plus petit dénominateur commun sur un territoire donné – n’offrent plus un cadre pertinent de gestion. Comme ces clercs bornés contre Galilée, refusant obstinément de reconnaître l’évidence de la caducité de leur interprétation devant l’impérieux argument de la réalité, il faut nous aussi cesser de penser en termes de systèmes clos et exclusifs.
Il ne s’agit pas de forcer une tribu Sioux à vivre avec et comme une tribu Inca. Mais au sein de la fraternité humaine il est possible d’établir des règles de coexistence pacifique. Il ne faudrait pas croire que le retour au village isolé et auto-suffisant, comme certains aiment à l’imaginer, soit la solution. Le monde est désormais en réseau et interdépendant. Les enjeux des décennies à venir sont donc colossaux : la gestion d’une masse de population dont on ne connaît pas encore le seuil maximal ; la préservation des espaces naturels et des ressources ; le maintien de nos conforts de vie.
On comprendra donc qu’une “refondation des institutions nationales” aux contours flous et aux résultats hypothétiques, dans une telle configuration mondiale qui subit un profond changement de paradigme, d’épistémè, n’est guère satisfaisante. Il faut une plus haute ambition, à la mesure des enjeux, pour les citoyens.
Puisque la réponse ne peut et ne doit être que politique - au sens profond et originel de ce“qui concerne les citoyens” - il faudra des dirigeants courageux et audacieux, des citoyens lucides, capables de ressentir l’intérêt général et non plus leur intérêt propre. Les premiers devront abandonner leur pouvoir à une institution qui les dépasse, les seconds exercer leur souveraineté sous une forme nouvelle, à l’aune de la démocratie participative qui s’invente sous nos yeux.
La recomposition du paysage politique français, qui s’opère actuellement, témoigne des bouleversements qui ont lieu et de l’évolution des mentalités. Un nouveau clivage émerge, celui de l’universalisme, qui divisera les partisans d’un conservatisme acharné, convaincu que la nation et l’État ne sont pas morts ; et ceux, plus éclairés, à la manière de Churchill et De Gaulle, qui se préparent à penser l’après.

« Penser la rupture. Inventer un nouvel universalisme. »
par Vincent Métivier, le 13 septembre 2015
- - - - -
Ce constat, partiellement injuste, n’exprime aucune nuance. Je le revendique en refusant de le tempérer car j’ai le sentiment qu’il faut aller à l’essentiel. Le lecteur offusqué pourra rajouter des « parfois », « un peu », « en partie » aussi souvent qu’il le souhaite ; il aura toujours raison de le faire.
Après des mois d’engagement, je ne vois plus qu’une alternative à la décrépitude de notre système politique : sa disparition.
Nous, militants, avons beau gesticuler dans nos partis, faire des enquêtes d’opinion, appeler comme des moutons à des sauts ou des sursauts démocratiques, la défiance des citoyens envers le monde politique s’aggrave.
Des deux côtés, une forme d’autisme fait rejeter la faute sur l’autre. Les élus, aveuglés par leurs ambitions, sont incapables de se remettre vraiment en question ; les électeurs, eux, votent comme des pieds en s’en lavant les mains. Personne ne se sent plus coupable de rien. Pour faire simple, notre crise institutionnelle est avant tout une crise de responsabilités.
Pour donner un nouveau souffle à notre démocratie, il est indispensable d’augmenter considérablement la représentation et le pouvoir des citoyens. Selon le principe des vases communicants, cela se fera au détriment des partis et des professionnels de la politique, mais on ne peut pas se payer le luxe d’entretenir ceux qui desservent ceux qu’ils devraient servir.
Dans cette optique, attaquons-nous d’abord au problème de représentation du peuple.
Nous serions, paraît-il, en démocratie. Pourtant, à regarder la composition de l’Assemblée nationale, le doute est permis. Les élections parlementaires répondent à la loi du plus fort et une majorité des Français ayant une opinion « minoritaire » n’y est pas représentée. Il y a là une anomalie à corriger. Un scrutin avec une bonne grosse dose de proportionnelle, du genre à dynamiter les groupes majoritaires, changerait cela. Je sais bien que la France a eu quelques mauvaises expériences de ce type par le passé. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, certains de nos voisins européens ne s’en sortent pas trop mal (le Danemark, notamment).
Allons même plus loin. Plus loin, c’est le tirage au sort. En nous libérant des logiques électoralistes, le panachage d’un large tiers de l’Assemblée par de simples citoyens désignés par hasard – et évidemment défrayés – pourrait permettre au Parlement de retrouver une assise ainsi qu’une légitimité populaire qui lui font largement défaut aujourd’hui. Et, accessoirement, une honnêteté que ne connaissent pas nos lobbyistes actuels. Ce système, hérité de la démocratie athénienne, a notamment été utilisé pour l’Assemblée constituante islandaise de 2011.
Enfin, toujours sur la question de la représentativité, il serait bon d’améliorer l’accessibilité de tous les citoyens aux mandats électifs. Se présenter à une élection est aujourd’hui un vrai parcours du combattant. En vrac, cela requiert : du temps, de l’argent, un suicide professionnel (si on est pas fonctionnaire), un parti politique, une place à prendre à un autre candidat potentiel ou à l’élu sortant. Un Monsieur-tout-le-monde armé de son seul courage n’a donc aucune chance de se retrouver sur d’autres bancs publics que ceux du parc le plus proche. Pour changer ce paradigme, diverses mesures doivent être prises, allant du non-cumul des mandats au soutien financier et logistique du candidat indépendant.
La question de la représentation étant abordée, reste à soulever celle de la détention et de l’exercice du pouvoir, symbolique ou effectif.
Je précise symbolique ou effectif car il existe, de fait, une confusion entre les deux. Certains représentants de la Nation partent du principe qu’ils en sont d’abord une incarnation, donc qu’ils sont au-dessus des lois, de la morale et du peuple. Cette confiscation de la symbolique du pouvoir en font des demi-dieux capables, pour les députés par exemple, de voter l’impôt sans être assujetti au même régime que leurs concitoyens, ou de bénéficier d’une immunité pour profiter bien tranquillement de leur mandat et de ses largesses. Il serait bon de réformer le statut de l’élu pour l’inviter à une certaine modestie.
Cette confusion existe également au plus haut sommet de l’État, et c’est là qu’elle fait le plus de dégâts. Avoir un exécutif bicéphale sans cohabitation est une aberration, car ce régime donne tous les rôles au Président, et n’en donne plus aucun au Premier Ministre. Le chef du Gouvernement n’est désormais plus un fusible viable et le chef de l’État, normalement garant de sa continuité et de l’unité de la Nation, se fait siffler dans les stades… Comme Emmanuel Macron (Le 1 Hebdo, 08/07/15), je pense qu’il manque un roi à la France. Qu’importe qu’il soit de droit divin ou républicain, nous gagnerions, à ce niveau du pouvoir, à séparer la charge symbolique de la portée politique. Difficile d’imaginer Hollande en Reine d’Angleterre (pardon pour l’image !), mais c’est à mon sens la voie à emprunter.
Les politiques, élus ou mandatés, doivent par ailleurs être responsables de leur parole et de leurs actes. J’utilise ici la notion de responsabilité dans les deux sens.
D’une part, les gouvernements, tous échelons confondus, gagneraient à être composés d’experts dans leur domaine. D’autre part, il faudrait instaurer des contrats de gouvernance, contraignants et sanctionnables (idée empruntée à Sam Karmann, Twitter, 13/09/15). La conduite de la France ne peut plus être un chèque en blanc de la durée d’un mandat, laissé aux mains de semi-professionnels de la communication, mielleux et interchangeables.
Enfin, je suis intimement persuadé qu’il faut généraliser la pratique du référendum, d’autant que grâce aux nouvelles technologies, son recours n’est plus aussi coûteux ou fastidieux que par le passé. Toute question d’ordre sociale ou structurelle devrait y passer. Son utilisation fait peur en France, nos politiques estimant que les citoyens sont dénués de recul. C’est en partie vrai, mais à infantiliser le peuple, il reste un éternel adolescent en crise. La maturité s’acquiert par le respect et la reconnaissance. Les Suisses, exemples en la matière, décident ainsi de leur sort en conscience ; ils ont notamment refusé début 2012, via référendum, le passage de quatre à six semaines de congés payés.
Tout un programme, n’est-ce pas ? Soyez toutefois rassurés, ces propositions sont irréalisables car ceux qui pourraient les voter sont principalement ceux qu’elles limiteraient. La politique n’a jusqu’alors jamais atteint un tel degré de masochisme !

« Moins de politique pour plus
de démocratie (et vice versa) »
par Vincent Fleury, le 15 septembre 2015
- - - - -
On voudrait nous faire croire que la jeunesse est désabusée et son engagement essoufflé. Elle incarne pourtant un élan nouveau, souvent incompris. Débrouillarde, elle rebat les cartes et impose de nouvelles règles du jeu. Elle forge les institutions neuves. Elle se débat en dehors des statuts qui ont protégé leurs parents et au sein desquels on raisonne encore trop souvent.
Dans un pays sans croissance et sans emploi, les jeunes sont en première ligne. Face à un taux de chômage quatre fois plus élevé qu’il y a quarante ans, face à une temporalité accélérée par la mondialisation, ils se considèrent souvent mal armés.
Le constat est simple : notre monde bouge plus vite que nos méthodes, nos structures et in fine nos institutions. Cette génération du système D plus que "Y" a donc mis en place un système parallèle, à rebours des idées reçues, en passe de devenir le système de référence.
La jeunesse modélise un système où l’engagement est tentaculaire et moins codé. L'engagement n'est pas mort. Il est même de plus en plus vivant et s'exprime sous des formes renouvelées ! On manifeste moins, on pétitionne plus. On adhère moins à un parti politique ou à un syndicat, mais on s'inscrit en ligne pour accueillir chez soi des réfugiés de guerre. On s'affranchit des appartenances politiques, mais on organise des mouvements à l'extérieur des cercles traditionnels, qu'il s'agisse des Pigeons ou de la mobilisation « Je suis Charlie » du 11 janvier.
La jeunesse est mature. Elle ne court pas après un strapontin dans la décision publique, elle œuvre déjà et en dehors des institutions. Les structures traditionnelles sont dépassées. Logique. Elles ont refusé de changer. Les règles du jeu sont écrites par celles et ceux qui en bénéficient et permettent avant tout de protéger les "insiders".
La désillusion de la jeunesse envers nos institutions n’est pas un mouvement d’humeur... Alors que leurs aînés jurent encore par l’État, les jeunes sont 80% à considérer que la politique doit favoriser l’entreprise. Plus d’un tiers des lycéens et étudiants souhaitent créer leur propre structure. Ultra-connectée, la jeunesse ne comprend plus l’inertie d’un système dépassé.
Le réferendum de 2005 sur le projet de constitution européenne en est un exemple symptomatique. Une jeunesse mobilisée sur des enjeux techniques, qui vote en masse « non » et qui, quelques années plus tard, comprend que le plan B est un passage en force du plan A. Cette désillusion marque la fin d’un espoir.
Est-il alors trop tard pour ré-enchanter les institutions actuelles et éviter leur renversement brutal ? Non. Mais devant l’urgence, il faut agir vite ! Face à la crise de légitimité du politique, la démocratie doit être plus directe, les projets politiques davantage co-construits avec les citoyens. Face à l’inefficacité des politiques publiques, ce sont non seulement des évaluations permanentes qui doivent être mises en place, mais aussi un véritable « devoir de rendre compte » des responsables qui doit être instauré.



« Les institutions de demain seront forgées
par une jeunesse plus engagée que jamais »
par Aurore Bergé, Matthieu Ellerbach
et Julien Miro, le 16 septembre 2015
- - - - -
« La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Cette citation d’Abraham Lincoln qui caractérise la démocratie est sans nul doute la définition la plus célèbre du mot « démocratie ».
À l’heure où de nombreux peuples dans le monde ne peuvent toujours pas dire qu’ils vivent sous un régime démocratique et où, en Europe notamment, les volontés des peuples sont balayées d’un revers de main par les technocrates et les financiers qui nous gouvernent, je vais essayer d’être concis pour développer ma vision de ce que devrait être les changements que je souhaite au sein de la République française.
Je me bornerai (comme il nous l’est demandé) à développer ma vision pour la France et non une vision généraliste européenne même si je reste persuadé qu’une rénovation profonde des institutions de la république doit s’accompagner du retour à une Europe des Nations libres et indépendante, dirigées par les peuples et non pas les marchés et les lobbys.
J’ai choisi de commencer mon exposé par la citation de Lincoln car j’estime qu’à l’heure actuelle la république est malade de sa démocratie qui ne représente pas (ou plus) l’idéal qu’elle devait porter.
Je n’en appellerais pas à une VIème République (effet de style plus que changement de fond) mais à une Vème République rénovée et refondée pour recentrer le citoyen au cœur de la cité, comme c’est le cas par exemple en Suisse. Les référendums d’initiative populaire sont à cet effet l’exemple le plus criant d’une démocratie « participative » - en plus de « représentative » - réussie. L’Europe a tenté elle aussi, avec ses initiatives citoyennes, d’aller sur ce terrain, mais il ne s’est agi que d’un artifice, comme nous avons pu le constater avec l’initiative sur la fin de l’expérimentation animale, qui a été sacrifiée. Il faudra instaurer en France de véritables référendums d’initiative populaire (avec un seuil fixé entre 500 000 et 1 million de signatures) que l’on soumettrait obligatoirement au vote de la population (avec, malgré tout, une limite par an).
Le régime français est semi-présidentiel (à la différence des régimes parlementaires de nombreux pays européens). S’il est nécessaire de conserver la stabilité qu’il procure, je pense qu’il faut revenir à un mandat présidentiel de sept ans, non renouvelable, afin que le président élu fasse réellement les réformes pour lesquelles il s’est fait élire, sachant bien qu’il ne pourra pas se représenter. Parallèlement, on pourra renforcer les pouvoirs du Parlement qui pourra avoir un rôle d’initiative plus important.
Le Sénat et le Conseil économique et social devraient être supprimés, mais il faudrait veiller à ce que l’Assemblée représente de manière équilibrée les élus, les territoires, et toutes les composantes de la société civile. Le mandat législatif serait toujours de cinq ans, avec une proportionnelle intégrale, non par département mais par région (les vingt-deux anciennes régions, pas les grandes régions), avec un seuil de 5% des voix pour que soient représentés tous les mouvements et en même temps garantir une juste représentation des territoires (ce que la liste unique ne fait pas forcément, favorisant souvent une élite parisienne).
Une vingtaine de sièges seraient attribués au niveau national pour permettre à tous les partis politiques ayant obtenu au niveau national entre 1 et 5% des suffrages de bénéficier d’un représentant à l’Assemblée s’ils n’en ont pas eu un seul via le scrutin à base régionale. L’obligation liée à la parité tomberait - car on doit choisir les personnes pour leurs compétences et non autre chose - mais elle serait encouragée (malus dans le financement public, désavantage dans la répartition des sièges en cas d’égalité) pour inciter les femmes à s’engager en politique puisque notre pays n’a pas encore la mentalité des pays scandinaves, par exemple, en la matière.
Le cas de l’Outre-Mer serait traité à part avec un scrutin majoritaire à un tour conservé pour les circonscriptions uniques et une proportionnelle pour les autres, comme pour les Français de l’étranger. Le nombre de députés serait maintenu (compte tenu de la suppression du Sénat et du CES) mais les indemnités encadrées, diminuées et les retraites alignées (comme au gouvernement) sur le privé pour une équité, une moralité réelles. La politique deviendra l’espace qu’il devrait être : celui de servir les citoyens et non de se servir soi-même.
De même, le financement des partis devra être revu et les micro-partis interdits. Enfin, le cumul des mandats devra s’appliquer strictement. Un élu national - ou membre du gouvernement - ne pourra cumuler avec la présidence d’un exécutif local (un mandat de simple élu départemental sans responsabilité ou de simple conseiller municipal ou conseiller délégué sera autorisé, de la même manière qu’un mandat d’adjoint au maire ou de maire d’une commune rurale de moins de mille habitants).
Il en serait de même au niveau des collectivités locales, avec une défense de l’héritage de la commune, des départements et de la Nation. Les Régions (actuelles) seraient des lieux de concertation où siégerait des représentants des départements et des communes. Les scrutins départementaux et municipaux seraient proportionnels eux aussi (intégralement pour le département et avec une prime de majorité pour les communes). Les intercommunalités seraient supprimées ; les collectivités garderaient la possibilité de se regrouper pour certaines compétences (les communes rurales notamment), sans institutions propres ni indemnités correspondantes.
La principale caractéristique de la République telle que je l’imagine, avant même d’en articuler les compétences, les définitions ou le mode de gouvernement : elle se doit d’être morale et exemplaire. Les nominations de responsables ou de fonctionnaires se feront sur la base du mérite et de l’exemplarité. Les frais seront contrôlés, les conflits d’intérêts interdits et nous devrons nous inspirer des modèles scandinaves sur la transparence de la vie politique et l’intégrité des élus (tout élu corrompu ou soupçonné de corruption et autre ne pourrait tout simplement plus se présenter à une élection). Les liens entre les élus et les lobbys seraient activement contrôlés et des sanctions importantes pourront être prises pour ceux qui tentent d’influencer la vie politique par des pratiques de lobbying.
Les médias devront jouir d’une totale liberté d’opinions ; toute censure ou pression sera interdite. Néanmoins, nous contrôlerons et limiterons les liens entre industriels et groupes de presse en créant de nouvelles règles liées à la détention du capital des médias.
Enfin, tout les budgets des institutions et de la vie politique seront diminués pour montrer symboliquement l’exemple aux citoyens si ceux-ci doivent aussi supporter le prix de sacrifices et d’efforts.

« Appliquons à la lettre la maxime de Lincoln »
par Jordan Grosse Cruciani, le 17 septembre 2015
- - - - -
Une étude du Cevipof (le Centre de recherches politiques de Sciences Po, ndlr) montre que 90% des Français « considèrent que les responsables politiques ne se préoccupent peu ou pas de gens comme eux » (avril 2014). Cette nouvelle préfigurait les résultats alarmants du Front national lors des élections européennes en mai 2014. Ce parti se nourrit du rejet de la politique et de ses représentants par les Français. Indéniablement, une réflexion sur les institutions et le système politique doit être ouverte pour tenter de comprendre les motifs de cette rupture durable entraînant la montée des partis extrêmes.
1/ Pour une réforme profonde des institutions de la République
La France compte aujourd’hui 510 000 élus pour une population de soixante-six millions d’habitants. Cela représente un élu pour 130 habitants. Paradoxalement, l’impression des Français de n’être pas représentés coïncide avec cette hausse du nombre de politiques. Ceci témoigne donc d’abord d’un grave problème institutionnel.
Au Parlement, 577 députés et 348 sénateurs siègent. Dans les IIIème et IVème Républiques les élus avaient un rôle fondamental comme dans les régimes parlementaires classiques. Ils ont voté des lois socles de nos systèmes juridiques et représentaient parfaitement la société dans le cadre du scrutin proportionnel. Avec l’avènement du régime semi-présidentiel, le parlementarisme est « rationalisé » et les élus affaiblis face à l’exécutif pour une meilleure gouvernabilité.
Ils sont connus pour être trop bien payés, trop nombreux et asservis au mass media. Leur soi-disant « impossible ubiquité » conduit certains à vouloir limiter le cumul des mandats dans le même temps, voire dans la vie (pas plus de deux mandats de député dans toute sa vie). De la même façon, le Sénat est critiqué pour son mode de scrutin et son rôle. Ainsi, la désignation par des grands électeurs serait, selon ses détracteurs, anachronique. De plus, il sur-représenterait les régions rurales, car 98% des agglomérations françaises ont moins de 9 000 habitants et 48% de la population vit dans ces dernières.
Alors que faire ? On serait tenté de céder à la facilité et la démagogie en demandant la suppression du cumul des mandats. Toutefois, avec une équipe compétente autour de soi, il est possible de traiter tous les dossiers locaux ou législatifs. De plus, cela reviendrait à empêcher les citoyens de choisir l’homme politique qu’ils désirent véritablement puisque celui-ci pourrait être constitutionnellement empêché de se présenter aux élections, ce qui est profondément antidémocratique. Le cumul des mandats permet de donner la parole à des politiciens forts, affranchis de la tutelle du Parti, qui s’expriment au nom d’un nombre important d’habitants d’une circonscription et d’une ville. Les communautés locales sont de fait mieux représentées. En plus, des parlementaires plus forts permettent de faire contrepoids à l’exécutif qui gagne en importance.
Pour pallier la crise de représentation, on peut envisager une élection de liste à prime majoritaire (au moins la moitié des sièges pour la formation politique en tête) pour garantir la gouvernabilité au niveau national et permettre à des partis non moins importants de figurer au Parlement, miroir de l’opinion des Français. En tout cas, l’enjeu principal des années à venir sera de réduire le nombre de députés pour accélérer le processus législatif tout en luttant contre l’inflation de lois. De plus, les parlementaires disposeront d’une vraie équipe dotée de moyens plus importants pour engager des réflexions de fond avec des experts et davantage de collaborateurs. L’enveloppe de 6 500 euros nets à distribuer entre tous les assistants d’un élu paraît beaucoup trop faible pour recruter des professionnels capables de répondre de façon plus méticuleuse aux attentes des Français.
L’autre Chambre est vieillissante (moyenne d’âge de 61 ans) et jugée moins utile. Le Sénat est élu au suffrage indirect, grande source d’illégitimité. Sa mission de représentation est inadaptée et incohérente. En effet, la France s’urbanise et ses campagnes se vident ; elle doit rester une République jacobine indivisible et ne peut faire de distinction entre les territoires, source de tensions sociales et montée des extrêmes. Les sénateurs ne peuvent pas prétendre être les sages de la Républiques puisque le Conseil Constitutionnel remplit déjà ce rôle. Il reste alors deux solutions : élire les sénateurs au scrutin proportionnel sans changer les compétences du Sénat pour représenter des partis plus petits mais parfois innovants ; supprimer le Sénat et confier ses missions d’analyses au Conseil Economique et Social et ainsi décomplexifier le processus législatif.
2/ Pour que les citoyens soient (enfin) placés au cœur du projet démocratique
La participation des citoyens à la rédaction des projets locaux
Étant personnellement engagé en politique, j’ai pu me rendre compte que les citoyens avaient besoin d’être associés à l’écriture des propositions. Pour les élections municipales, j’ai milité dans le 7ème arrondissement de Paris dans lequel je vis, près de Sciences Po où j’étudie. Pour moi, l’engagement local doit primer. L’année d’avant, j’ai participé dans ma ville natale de Chalon-sur-Saône à des forums de projets citoyens dans lesquels j’ai pu faire des propositions pour la jeunesse et l’économie de la municipalité aux côtés d’acteurs de premier plan pour la liste de Gilles Platret/Sébastien Martin. Cette expérience m’a permis de comprendre que de telles concertations étaient indispensables de la part des candidats pour mieux comprendre les attentes de leurs futurs administrés. Ce travail doit venir des formations politiques qui comptent gouverner. Le citoyen doit pouvoir participer à l’écriture des programmes, et être un acteur local. Le concerter pour connaître ses préoccupations de sa vie quotidienne doit être obligatoire.
Plaidoyer pour l’utilisation du numérique pour une démocratie 2.0
Depuis ma deuxième année d’études, je travaille dans une initiative civique, Initiative Commune Connectée. Elle a pour but de doter l’ensemble des mairies de France d’une application mobile performante. Grâce à cette solution déjà mise en place dans plusieurs villes, les citoyens ont la possibilité de s’informer sur toutes les actualités de la commune, de signaler des problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne. La démocratie participative est accrue car les habitants envoient des propositions/questions à leurs élus municipaux. Ils peuvent ainsi interpeller le maire et ses adjoints sur des problématiques qui les concernent. Ces modules sont consultables notamment sur l’application du 8ème arrondissement de Paris.
Plus ambitieux encore sont les modules de consultation et de conseils numériques. Grâce à des sondages, la ville peut consulter ses administrés sur des projets urbains, des manifestations culturelles, etc. Il s’agirait de rendre référendaire ce type de consultation, de sorte que si elle n’obtienne un nombre de voix suffisamment important sur une part élevée de citoyens, la proposition soit rejetée. Cela sous-entend bien sûr qu’une grande partie des citoyens aient accès à internet ou à des smartphones sur lesquels ce type d’outils peut être téléchargé. Or, les structures telles que Initiative Commune Connectée s’adaptent à toutes les demandes et sont capables de fournir des outils conviviaux que tous peuvent utiliser. L’outil de conseils de quartiers numériques est une plateforme interactive sur laquelle les citoyens peuvent déposer des propositions et recueillir des voix sur ces initiatives. Les plus soutenues sont portées aux oreilles des services et des élus municipaux et peuvent être mis en œuvre.
La politique locale doit être ouverte à tous. C’est un chantier majeur pour pallier le rejet des Français des représentants publics. Le numérique est une solution pour répondre à ce besoin croissant et urgent. Bien entendu, il est un outil intéressant sur les questions nationales ou supranationales.
Initiative Commune Connectée a découlé d’une démarche citoyenne, Politiclic. C’est une plateforme de débat interactif lancée au moment des élections municipales. Chaque liste candidate pouvait s’y inscrire et indiquer les thématiques détaillées qui lui étaient chères. Les citoyens pouvaient retrouver des thèmes grâce à une recherche par proposition et non par nom pour permettre à tous les acteurs d’émerger (en gommant ainsi les privilèges de notoriété). Utilisée dans plus de 5000 villes et par plus de 20 000 listes candidates, cette plateforme a été une réussite pour faire émerger de nouvelles idées et permettre aux citoyens de découvrir des nouvelles propositions car « si leur devoir est de voter, celui des candidats est d’informer » (devise de Politiclic). Cette initiative a été réutilisée lors des élections européennes, cette fois-ci dans plus de vingt-sept pays pour favoriser le rapprochement entre les candidats européens.
Il ne s’agit pas bien sûr de créer une République de démocratie participative, irréaliste car des experts sont plus compétents pour statuer sur des problématiques précises. Il ne s’agit pas non plus de revenir à une démocratie athénienne, car les représentants sont indispensables pour une population de soixante-six millions d’âmes.
Néanmoins, pensons au numérique dans les processus de prises de décisions pour inclure les citoyens isolés dans la communauté politique et mettre fin à la montée des extrêmes, cancers de la démocratie et sources d’instabilité institutionnelle et sociale...

« Vers une démocratie 2.0 »
par Camille Chevalier, le 17 septembre 2015
- - - - -
Les principaux résultats de la troisième vague de l’enquête annuelle « Fractures françaises », publiée en avril 2015 par Ipsos/Steria, sont accablants ; en particulier, 76% des sondés estiment que le système démocratique fonctionne plutôt mal en France et que leurs idées sont mal représentées, soit une progression de quatre points par rapport à 2013. Pire, 86% d’entre eux considèrent que les décideurs politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels. De quoi s’interroger sur la pertinence de nos institutions, sur le caractère démocratique de leur fonctionnement et sur la façon dont doit se penser l’exercice du pouvoir aujourd’hui.
Un changement de paradigme institutionnel
Le fait est que ce désenchantement du politique accompagne un changement profond de paradigme institutionnel. L’idéal démocratique français, développé au XVIIIe siècle et concrétisé à l’occasion de la Révolution de 1789, s’est d’abord articulé autour d’un modèle parlementaire, reposant sur deux principes : l’universalité de la loi et la représentativité du législateur. Par universalité de loi d’une part, il faut entendre l’établissement d’une justice véritable, impersonnelle et épargnée de toute décision arbitraire. Par représentativité du législateur d’autre part, il faut appréhender la loi en tant qu’émanation de la volonté du peuple, par le biais de députés élus par celui-ci. À cet égard, l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est formel :
« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »
Seulement, il semble que désormais ce règne de la loi ait pris fin. Pierre Rosanvallon, dans son essai Le Bon Gouvernement paru en août de cette année, détaille l’idée selon laquelle nous serions passés d’un régime « parlementaire-représentant » à un régime « présidentiel-gouvernant ». Ce changement, opéré définitivement en 1962 avec l’instauration de l’élection du président au suffrage universel direct, correspond à un transfert de pouvoir effectué au détriment d’une assemblée de parlementaires et en la faveur d’un homme placé à la tête de l’exécutif. Si, sous la IIIe République, la conduite de la politique de la nation revenait au président du Conseil, dépositaire d’une coalition majoritaire au sein du Parlement et donc à la merci de la défection d’une de ses composantes, elle est aujourd’hui l’apanage d’un président, choisi au détour d’un « moment démocratique », celui d’une élection ponctuelle et qui ne saurait être contestée le temps du mandat attribué.
Vers un retour au parlementarisme ?
Les problèmes suscités par ce bouleversement sont multiples. L’effacement du Parlement au profit d’une figure présidentielle pose la question de la représentativité. Dans un régime parlementaire, le pouvoir est détenu par une assemblée plurielle qui de fait peut prétendre représenter les différentes franges d’une population donnée. A contrario, il apparaît difficile pour un homme de synthétiser en sa seule personne l’ensemble des composantes d’une même société. Plus encore, l’exercice du pouvoir, plutôt que de se manifester selon un mode représentant-représenté, garanti par le régime parlementaire, se concrétise selon un rapport gouvernant-gouverné : une fois élu, le président dispose des coudées franches pour appliquer la politique de son souhait, parfois bien différente des promesses avancées lors des campagnes antérieures, sans que le peuple – prétendu souverain – ne dispose de réels moyens de contre-pouvoir. « Monarchie républicaine », « démocratie d’autorisation » : les termes ne manquent pas pour qualifier les failles démocratiques qu’entrouvre la présidentialisation de notre régime politique.
De telle sorte que la tentation d’une VIe République parlementaire, en remplacement du régime semi-présidentiel actuel, revient régulièrement au centre du débat d’idées. Jean-Luc Mélenchon en a fait son cheval de bataille lors de la campagne présidentielle de 2012, et a lancé en 2014 le réseau citoyen nommé Mouvement pour la VIe République (M6R) ; Arnaud Montebourg, créateur dès 2001 d’une Convention pour la VIe République (C6R), déplorait dans son blog lors de la primaire socialiste de 2012 un président « élu pour cinq ans et qui concentre durant cette période l'ensemble des pouvoirs sans jamais en répondre devant qui que ce soit ». Plus récemment, le think tank Allons Enfants, lancé par Rama Yade, ambitionne de doter la France d’une nouvelle République, pour faire face à « l’essoufflement du débat public » et au « discrédit des partis politiques ».
Vertus du présidentialisme
Pourtant, il est difficile d’imaginer qu’une réactualisation du parlementarisme ait réellement un impact positif sur nos pratiques démocratiques. Historiquement, un tel régime ne s’est pas porté garant de l’intégrité des élus de la République : citons, au crépuscule du XIXe siècle, le scandale des décorations à l’origine de la démission de Jules Grévy ou bien encore le soudoiement de parlementaires dans le cadre de l’affaire de Panama, parmi tant d’autres. D’autant plus que les rivalités partisanes, exacerbées au sein d’un régime parlementaire, ont ankylosé les IIIe et IVe Républiques. Charles de Gaulle le rappelle amèrement dans ses Mémoires d’espoir : entre 1946 et 1958, « dix-sept présidents du Conseil, constituant vingt-quatre ministères, campèrent tour à tour à Matignon ».
La présidentialisation de la mécanique institutionnelle a le mérite de répondre à un triple défi, identifié par Pierre Rosanvallon. Celui de l’imputation, puisqu’en tant que « clef de voûte des institutions », le président porte la responsabilité de l’exercice du pouvoir, et il est alors possible de le sanctionner par les urnes si le jugement porté à l’égard de sa politique est majoritairement négatif à l’issue de sa mandature. Celui de l’identification ensuite, dans un contexte où les grands affrontements idéologiques ne sont plus, et où c’est aujourd’hui le soutien à telle ou telle personnalité qui constitue le moyen le plus évident d’être acteur de la vie politique. Celui de la simplification enfin, puisque le suivi possible de l’actualité gouvernementale par la voix seule de la tête de l’exécutif, dont toutes les paroles sont reproduites et largement diffusées, s’oppose à un système politico-administratif jugé opaque à bien des égards. À Pierre Rosanvallon de conclure : la stature de président est perçue par les citoyens comme un vecteur possible de « réappropriation sensible du politique ».
Repenser la stature de président
En ce sens, c’est moins le système qu’il s’agit de réformer que la façon dont sont exercées actuellement les fonctions présidentielles. Le président Charles de Gaulle incarnait la théorie des « deux corps du Roi » avancée dans les années 1950 par l’historien Ernst Kantorowicz. Selon ce concept, le Roi par nature dispose de deux corps : le corps « privé » de l’individu qui est porté à la fonction royale et un corps « public », qui transcende l’être humain et le situe au niveau de l’État dont il est la personnification. Nicolas Sarkozy a marqué une rupture fondamentale en brouillant la frontière entre ces deux corps. Par la surexposition volontaire de sa vie privée, par une succession d’incidents désacralisant ses fonctions, à l’instar du « casse-toi pauv’ con », il a fossoyé cette double identité que son successeur n’est pas parvenu à recouvrir.
L’enseignement du gaullisme est essentiel, puisqu’il associe le président à une conception unitaire de la nation. Le responsable politique, selon cette vision, rassemble les Français autour de projets de société en accord avec l’intérêt supérieur national. Évidemment, Charles de Gaulle lui-même n’a pas toujours suscité le consensus autour de ses décisions, mais il a toujours su porter et incarner la voix de la République. La Ve République, intrinsèquement, ne semble pas mal adaptée aux enjeux face auxquels la société française doit faire front. Les principes édictés par la Constitution de 1958 nous ont jusqu’ici préservés des crises politiques de la IIIe République et des atermoiements de la IVe. C’est davantage ce que Pierre Rosanvallon nomme le « mal-gouvernement » qu’il s’agit de combattre. À vouloir changer d’institutions, le risque est d’oublier de s’interroger sur la qualité de celles et ceux qui sont portés à la tête de l’État.
« Le président est mort, vive le président ! »
par Nicolas Germain, le 17 septembre 2015
- - - - -
S’essayer à l’exercice que me propose Nicolas peut paraître prétentieux. Il le serait si je souhaitais apporter un modèle type idéal de l’organisation démocratique de notre société, de surcroît si je le faisais en m’absolvant de toutes considérations partisanes. Il est surtout utile, car j’ai la conviction que c’est à ma génération qu’il reviendra de trouver des réponses durables.
Cela nécessite d’abord de s’attarder un peu sur la manière dont se formule le débat autour de notre démocratie. De là uniquement peuvent émerger une vision d’ensemble, et un certain nombre de préconisations futures.
La première interrogation porte ainsi sur les causes et la nature réelle de la « crise politique » que nous vivons et qui raffole des qualificatifs (de « confiance » envers les politiques, de la « représentation », « démocratique »...). Problème d’efficacité de l’action publique, déficit de leadership, démocratie supplantée par la technocratie, représentants corrompus… ? Les réponses existantes sont multiples et variées.
Commençons par les symptômes. Le premier d’entre eux est l’abstention qui remet en cause la légitimité des représentants. Mais il y a aussi la réduction du nombre d’adhérents des grands partis qui remet en question les formes d’action politique traditionnelles. La baisse du nombre de salariés syndiqués qui affaiblit le rôle de l’action syndicale. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une crise des pratiques et de la représentation politique.
Ce n’est pas tout. La confiance envers plusieurs institutions comme la justice ou l’éducation nationale est en baisse selon de récents sondages d’opinion. L’impôt, fondement du consentement à l’État démocratique, est aussi largement contesté dans les enquêtes. La perception selon laquelle la démocratie fonctionnerait de plus en plus mal est présente. Il y a certainement une remise en cause plus globale de la démocratie. S’agit-il pour autant d’une remise en cause de l’idée démocratique ? Je ne pense pas.
Il est nécessaire pour préciser le diagnostic, de sortir du cadre national et d’adopter une vision plus large. Je partage l’idée que le monde traverse une crise « systémique », à la fois économique, sociale, écologique et politique. En d’autres termes une crise globale de nos modèles d’organisation sociale et de leurs institutions, régis en premier lieu par le capitalisme.
La capitalisme n’a cessé de creuser les inégalités en exploitant dans un même élan les Hommes et la nature, jusqu’à ce que les inégalités soient trop fortes et jusqu’à ce que les ressources naturelles aient atteint leurs limites pour qu’il se retrouve dans l’incapacité de se renouveler en faisant croître les profits par la croissance de la production.
De la même façon, le capitalisme organise la concentration et l’accumulation des pouvoirs aux mains d’une minorité. Avec le néolibéralisme, le pouvoir des forces économiques et financières s’est considérablement accru depuis les années 1980. De même, ceux qu’on appelle les « experts » ont acquis eux aussi un pouvoir véritable. Certains parlent même de technocratie (la tyrannie des experts).
L’écologie politique apporte un regard complémentaire sur nos sociétés capitalistes. Notamment à travers un courant particulier qui émerge depuis les années 1970 : l’écosocialisme. Celui-ci reprend la dialectique kantienne de l’hétéronomie et de l’autonomie. Nos sociétés sont décrites comme étant hétéronomes. C’est à dire qu’elles confèrent l’autorité à une instance extra-sociale : divin, lois naturelles, supériorité de l'économie (main invisible de la concurrence, domination des marchés financiers et de la technoscience, idée que le travail ne peut avoir d’autre forme que sa forme d’aliénation actuelle, etc.).
Pour Cornélius Castoriadis, penseur écosocialiste que j’affectionne, il faut reconnaître que les institutions de la société sont de type « auto-institution », c'est-à-dire une œuvre humaine, non quelque chose appartenant à des "ancêtres", à l'Histoire, à Dieu... Castoriadis s’oppose ainsi au système de représentation politique irrévocable, car les représentants aliéneraient la souveraineté des représentés qui ne seraient « libres qu’un jour tous les cinq ans » (référence aux élections présidentielles en France qui dirigent la vie politique du pays). C’est donc par la démocratie directe ou la plus locale possible, et l’autogestion des secteurs sociaux que la société accèdera à une pleine autonomie démocratique.
Depuis les années 1980, l’altermondialisme est le mouvement social mondial qui porte cette critique du capitalisme et qui a par là même cherche à s’organiser en réseau au fonctionnement horizontal.
Ces dernières années il y a eu aussi Maïdan, Tahrir, 15 de Mayo, Occupy Wall Street, etc… des mouvements sociaux qui sont apparus dans des contextes différents mais qui présentent néanmoins des similitudes importantes : ils mobilisent une grande majorité de jeunes et recherchent tous une forme d’organisation horizontale.
Certains se structurent aujourd’hui en mouvements politiques, à l’image de Podemos en Espagne (issu du mouvement 15 de Mayo), qui acquiert l’adhésion des masses dans un pays où la crise ravage la cohésion sociale et territoriale, où la classe politique est touchée par de nombreux cas de corruption et perçue comme une oligarchie à part entière et où la monarchie reste un pouvoir symbolique. Podemos surfe sur les dysfonctionnements du système politique espagnol pour transformer son modèle. Son leader, Pablo Iglesias, théorise en effet le remplacement du clivage gauche-droite traditionnel par un clivage peuple-oligarchie. Il y a la volonté de faire évoluer la représentation pour aller vers davantage de démocratie.
La crise « systémique » que nous traversons n’a donc pas mené à un rejet de l’idée de démocratie mais plutôt à une remise en cause de ses formes d’organisation.
Revenons-en à la France. Je le disais précédemment, la perception selon laquelle notre démocratie fonctionnerait mal est très présente. Elle l’est d’autant plus pour les électeurs de gauche, comme le démontrent plusieurs sondages. L’exercice du pouvoir par la gauche semble provoquer des déceptions majeures pour son camp. Cette situation est-elle pour autant immuable ? Je pense que la gauche, a fortiori parce qu’elle est au pouvoir, doit questionner notre démocratie, revenir aux racines et aux principes de la chose démocratique pour lui donner du sens et de l’espérance.
À l’origine de la démocratie il y a le peuple, entité concrète, à l’inverse de la nation, notion abstraite qui transcende le peuple, l’associe à un territoire et à un ensemble de valeurs, de rites, d’institutions... Le peuple est une association politique d’individus. Le droit fonde le peuple.
La gauche au pouvoir doit se ressaisir de la question du peuple. Elle doit être capable de mieux le définir dans la globalisation, mieux comprendre par là même ses réalités et son rapport à la démocratie représentative.
Face au marché qui n’a cessé de s’étendre, le peuple tend à s’effacer. L’extension de la sphère marchande apporte toujours plus de concurrence entre les individus, le citoyen est supplanté par le consommateur. Les inégalités entre les individus ne cessent de croître. Elles favorisent ainsi plus facilement les égoïsmes sociaux. Elles affaiblissent par là même le contrat social qui fonde le peuple.
Pour redonner de la substance au « peuple » je reprendrais la distinction faite par le sociologue Robert Castel entre les différentes formes de citoyenneté. La citoyenneté politique s’accompagne d’une citoyenneté sociale pour former les « socles » d’une citoyenneté démocratique, explique-t-il. « La citoyenneté sociale est le fait de pouvoir disposer d’un minimum de ressources et de droits indispensables pour pouvoir s’assurer une certaine indépendance sociale. (…) C’est la question de l’indépendance minimale dont on peut disposer pour être maître de ses choix », selon Robert Castel. En d’autres termes, la citoyenneté nécessite de s’interroger sur les conditions qui rendent possible ou impossible la participation des individus aux décisions qui engagent leur destin politique. D’après Castel, au fondement de la citoyenneté sociale en France, il y a l’accès à l’emploi et les conditions salariales. Force est de constater que le chômage de masse et la précarité croissante du salariat ont mené un nombre toujours plus grand d’individus à perdre ces conditions. Agir pour l’emploi et la dignité seraient donc des priorités pour renforcer la citoyenneté.
Au lendemain des attentats de janvier dernier, celles et ceux qui n’étaient pas « Charlie » (j’entends, ceux qui ne se retrouvaient pas dans la perception républicaine de la communauté nationale) sont surtout celles et ceux qui ont perdu les conditions de cette citoyenneté car exclus du droit commun : droit à l’emploi, au logement, à l’éducation ou encore à la santé. Ces personnes se définissent dès lors en contradiction vis à vis de cette république qui ne veut plus d’eux. Ils se définissent contre la nation et davantage par rapport à leur lieu de vie ou leur religion.
Rappelons maintenant que le ralliement du socialisme à la démocratie s’est historiquement accompagné de la consolidation de la citoyenneté politique par l’affirmation d’une citoyenneté sociale. Jaurès le théorisait au début du siècle dernier.
La gauche au pouvoir, qui souhaite reconquérir les esprits et les voix qu’elle a perdus, doit donc retrouver un imaginaire démocratique fondé sur le peuple. Le peuple qui existe concrètement par l’acquisition de la citoyenneté sociale pour le plus grand nombre. Le combat pour la dignité et, au-delà de l’accès à l’emploi, l’égalité en sont les conditions.
Force est de constater que le compromis social-démocrate échoue parce qu’il a cessé de poursuivre ce combat. Aujourd’hui, la poursuite de règles budgétaires absurdes, notamment par les sociaux-démocrates, dirige l’action politique. Si l’on ne peut s’en dissocier totalement, il faut savoir contester l’idéologie néolibérale qui les formule et remettre en cause les dogmes qui leur sont associés. Car cette situation affaiblit tout espoir dans le progrès collectif qui a toujours fondé l’adhésion au projet socialiste.
Elle participe aussi au repli et aux égoïsmes sociaux qui font l’apanage du vote réactionnaire. Le discours réactionnaire progresse en France. Il défend une forme de radicalisme au sens étymologique du terme (revenir aux fondamentaux). Il propose de revenir aux institutions passées.
Et c’est le Front national qui incarne le mieux ce discours. Il s’imposa en suscitant l’indignation et la polémique. Avec cela il réussit à imposer ses thèmes à la sphère politico-médiatique. Il participa grandement à formuler les termes du débat politique, notamment sur la question de l’immigration, question sur laquelle il parvint à multiplier les amalgames et les stéréotypes. Il a compris qu’il fallait se battre sur le terrain des mots, ce qu’Antonio Gramsci appelait la « bataille culturelle ».
À l’heure de nouvelles menaces qui attisent les peurs et les haines - à l’instar du terrorisme islamiste -, à l’heure de la domination des discours identitaires - à l’image du « choc des civilisations » -, il est temps que la gauche se souvienne des mots du Premier ministre norvégien, Jens Stoltenberg, au lendemain de la tuerie d’Utoya en 2011 où soixante-neuf jeunes travaillistes furent assassinés par un fanatique d’extrême droite : « Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture et plus de tolérance ». Face à la réaction et à la droitisation de la société, la gauche doit s’organiser et mener la bataille culturelle pour la dignité et l’égalité.
Mais, au-delà du peuple, de la dignité et de l’égalité, la démocratie doit intervenir plus concrètement dans le quotidien des Français. Cela passe par un rapprochement entre les institutions et les citoyens, en les intégrant davantage à la prise de décision au quotidien. La mise en place de budgets participatifs est un très bon outil qui émerge dans certaines grandes agglomérations, à l’instar de la Ville de Paris. Les villes sont précurseurs dans ce domaine et doivent être accompagnées pour inventer une démocratie locale plus directe et participative. Attention cependant à ne pas se limiter à de la concertation. De multiples outils sont à créer pour favoriser l’initiative citoyenne et le partage des savoirs qui permettra au plus grand nombre de participer.
Les progrès proviendront surtout d’en bas. Cependant il faut aussi penser à l’exécutif national, dont l’élection donne le « la » de la vie politique française.
Dans la Vème République, les pouvoirs sont concentrés dans les mains d’un seul dirigeant, le Président, qui nomme et révoque le gouvernement, alors même que la Constitution dans son article 20 stipule que c’est le gouvernement qui conduit et détermine la politique de la nation.
Une nouvelle république doit accompagner les transformations de la démocratie locale. Une république sociale permettant une réelle reconquête démocratique. Je soutiens à ce titre l’instauration d’une VIème République parlementaire et primo-ministérielle où le Parlement, au-delà de faire et de voter la loi, aurait un réel pouvoir de contrôle sur l’exécutif représenté par un Premier ministre détenant son pouvoir du Parlement. Pour éviter toute instabilité, des procédures pourraient être mises en place pour obliger les députés votant une motion de censure contre un Premier ministre à s’accorder sur le nom de son remplaçant. Mais la priorité réside dans le renouvellement et la représentativité du Parlement. Les règles de parité y participent mais la possibilité pour chacun d’exercer la démocratie passe par le non-cumul des mandats. Je suis personnellement favorable au mandat parlementaire unique, au non-cumul des fonctions exécutives et au non-cumul dans le temps. Le statut de l’élu local est aussi un outil intéressant pour permettre à tous d’exercer un mandat politique tout en retrouvant un emploi à la sortie. Voilà les mesures phares concernant l’évolution de nos institutions représentatives.
La VIème République passe aussi par la décentralisation pour approfondir la démocratie locale. Elle est un échelon nécessaire pour soutenir le développement de la démocratie dans toutes les sphères économiques et sociales à côté de l’État, du modèle coopératif à l’économie sociale et solidaire. Pour exister les ressources des collectivités doivent être pérennisées, à la fois par le biais de la fiscalité mais aussi de la solidarité entre collectivités.
Avec le processus de décentralisation doit être assumée une certaine vision de la République laïque, le « nous sommes différents donc nous sommes égaux ». Cela passe par la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution, engagée par le gouvernement. Cela passe aussi par reconnaissance de toutes les mémoires de la France, notamment de ses diverses vagues d’immigration.
Ces mesures sont loin d’être exhaustives. Je n’ai pas parlé des partis politiques ou des syndicats, ni du numérique qui constitue une véritable opportunité pour la démocratie. Je préfère en rester à ces mesures qui posent, selon moi, les bases d’une réforme institutionnelle nécessaire pour la France - et pour la gauche.
Nous sommes en état de faire ces choix aujourd’hui. Nous avons la possibilité d’inventer les mots et les institutions d’un nouveau modèle démocratique écosocialiste. Nous avons la possibilité de redonner de l’espoir dans le projet démocratique socialiste. Après avoir permis plusieurs progrès tels que le non-cumul des mandats ou l’amélioration des règles déontologiques, le gouvernement peut et doit prendre cette direction.

« Le socialisme c’est la démocratie jusqu’au bout ! »
par Lucas Trotouin, le 24 septembre 2015
Une réaction, un commentaire ?
Que vous inspirent les réponses ci-dessus ?
Et vous, lecteur, quelles modifications apporteriez-vous à nos institutions ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook et Twitter... MERCI !