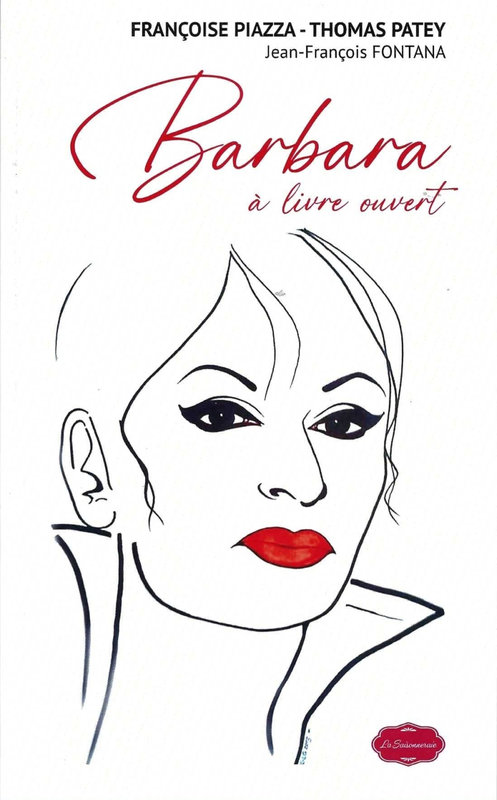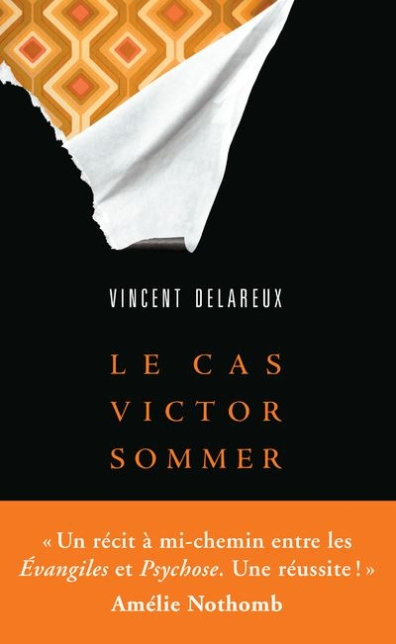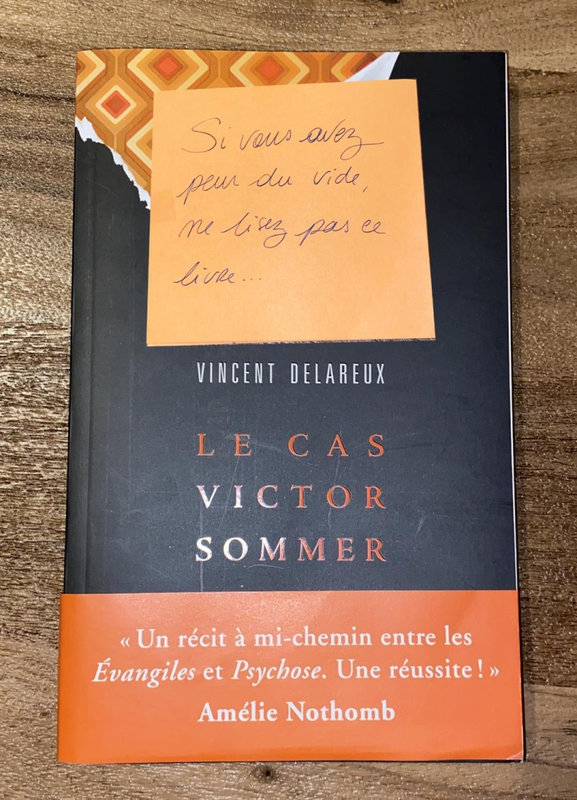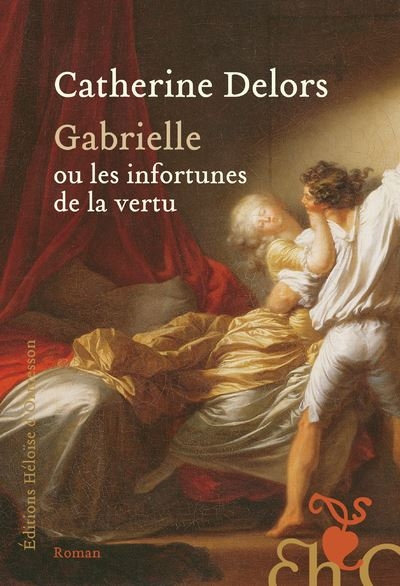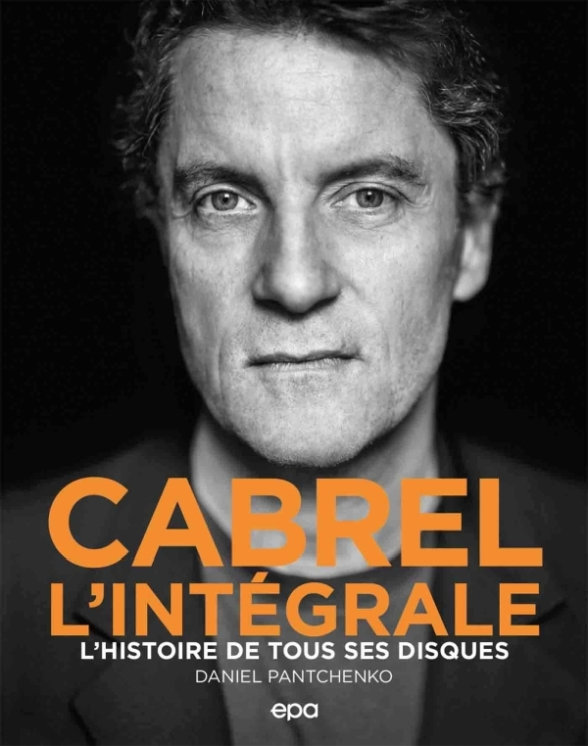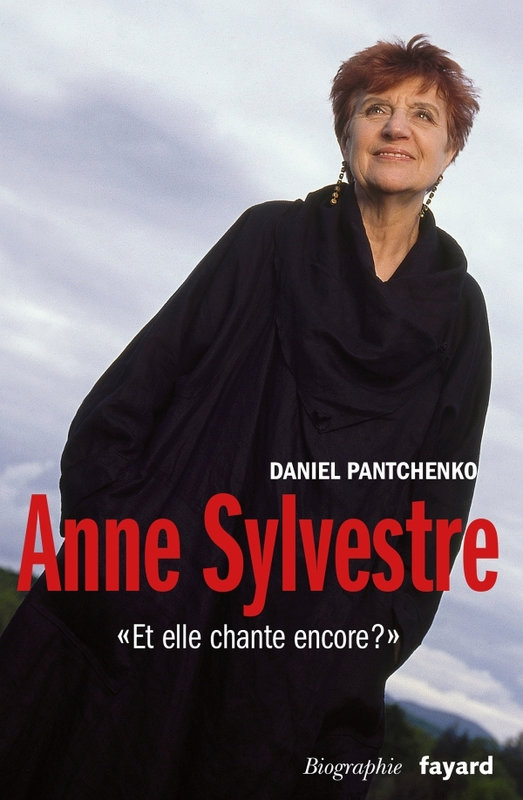En cette fin d’année, je vous propose un article grand format, fruit d’une lecture enrichissante - Les guerres d’Italie, un conflit européen (Passés/Composés, septembre 2022) - et d’une rencontre avec un passionné passionnant, l’historien Didier Le Fur, un des plus grands spécialistes français du XVIème siècle. M. Le Fur a dirigé la conception de cet ouvrage rassemblant quelques uns des meilleurs connaisseurs français et européens de ces guerres d’Italie finalement méconnues et qui pourtant ont été lourdes de conséquences quand aux cohésions nationales (les guerres de religion en découlent en partie, en France et dans l’espace germanique) et aux équilibres de l’Europe (à l’issue de cette période, les Habsbourg domineront l’Allemagne et l’Italie trois siècles durant).
Après lecture, nous avons échangé pendant près de 2h30, par téléphone, avec Didier Le Fur, à la mi-octobre. La retranscription fut longue, parfois laborieuse, il a fallu faire des choix pour une longueur d’article raisonnable - exit, une question sur Catherine de Médicis et des éléments de discussion relatifs à l’Histoire et à la politique - mais pour un résultat, je crois, qui intéressera celles et ceux qui viendront à bout de cette lecture. Je remercie en tout cas Didier Le Fur pour cet échange, l’ouvrage mérite réellement d’être lu, et j’en profite également, alors que 2022 touche à sa fin, pour remercier Amandine Dumas, qui fut précieuse pour la réalisation de cet article, et à travers elle, toutes et tous les attaché(e)s de presse. Exclu, Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.
EXCLU - PAROLES D’ACTU
Didier Le Fur : « Les guerres d'Italie
voulues par la France ont surtout provoqué
de grandes souffrances... »

Les guerres d’Italie, un conflit européen (Passés/Composés, septembre 2022).
Didier Le Fur bonjour. Il est beaucoup question, pour justifier les aventures des rois de France en Italie à partir de 1494, entre Naples et Milan, de prétentions dynastiques. Dans quel cadre européen s’inscrivent ces débuts des guerres d’Italie ?
la fin du XVè en Europe
Le contexte est assez simple. La guerre dite de Cent Ans, qu’en France on a longtemps appelée guerre "contre les Anglais", s’est achevée sous Charles VII (1453). Il y a, dès lors, une reconstruction incontestable du pouvoir monarchique, avec également une réflexion sérieuse sur la pensée de l’État. Il y a eu une vraie possibilité, durant les XIVème et XVème siècles, de voir la France évoluer vers un modèle plus fédéral, mais l’option retenue fut celle de la centralisation, choix qui s’est par la suite constamment poursuivi. Après la guerre de Cent Ans donc, conflit qui a objectivement ruiné les finances royales, choix fut fait on l’a dit de recentraliser le pouvoir, et de reprendre l’État en main.
Parallèlement à cela fut signée, en Italie, la paix de Lodi (1454) qui était censée pacifier toute la péninsule. Elle intervient à peu près en même temps que la fin de la guerre de Cent Ans, et la prise de Constantinople par les Turcs (1453 dans les deux cas). Certes, la paix de Lodi va chavirer relativement vite : au bout d’une vingtaine d’années il n’en sera plus vraiment question. En France, le travail d’unification du domaine royal avec les frontières du royaume s’accentue, un travail que l’on retrouve sous les règnes de Louis XI (1461-1483), Charles VIII (1483-1498) et Louis XII (1498-1515), jusqu’à François Ier (1515-1547), de l’annexion de la Provence à celle de la Bretagne au domaine royal. Centralisation et accroissement de la puissance territoriale vont de pair dans le cas de la France. Et cette puissance-là, qui est incontestable, va donner d’autres ambitions aux rois de France pour revendiquer des droits, notamment ceux échus après la mort de René d’Anjou et de Charles du Maine à Louis XI. Des droits sur des terres plus lointaines, dans la péninsule italienne, désignées sous l’appellation de royaume des Deux-Siciles, et qui devint le royaume de Naples, pour ces mêmes Français après 1496. La revendication d’un territoire par le droit est coutumière, c’est en grande partie comme cela que le royaume de France s’est augmenté. Ce sont ces droits-là qui vont amener à la fin du XVème siècle les rois de France en Italie...
Merci... Cadre intéressant, avec ce lien fait avec la guerre de Cent Ans...
C’est une suite, forcément. Et ces guerres d’Italie vont s’arrêter à la fois en raison des problèmes économiques, puis des guerres civiles en France. Sinon on aurait continué, je crois que c’est une évidence... La paix du Cateau-Cambrésis de 1559, fut regardée comme une pause : il n’y a plus d’argent nulle part, autant du côté français que du côté hispano-impérial. Cette légende des richesses d’Amérique, pour les Espagnols, a envahi l’historiographie au XXème siècle, mais dans les faits Charles Quint, et même Philippe II (son fils, roi des Espagnes de 1556 à 1598, ndlr), avaient de gros problèmes d’argent... Et la seule qui va en profiter réellement, ce fut Gênes... Si les guerres de religion - vous aurez remarqué que contrairement à leurs voisins les Français ne font jamais de "guerres civiles", des "révoltes", des "jacqueries" ou "des révolutions" oui, mais pas de "guerres civiles" - n’étaient pas intervenues, celles d’Italie se seraient poursuivies.
Avec cette question on fait un bond dans le temps : François Ier a-t-il perdu cette si importante élection impériale de 1519 aussi par la crainte qu’inspirait alors la France, puissance agressive, aux princes et aux prélats européens ?
le duel Charles/François
D’abord, il y a une différence d’âge. D’un côté, un jeune homme de 19 ans qui jusque là n’a jamais fait la guerre. Charles Quint est devenu ce qu’il est devenu parce qu’il était né Habsbourg, autant pour l’Espagne que pour le titre de roi des Romains, qui va lui conférer la charge impériale. De l’autre côté était François Ier, 25 ans, avec déjà un passé militaire glorieux : il avait Marignan (1515) derrière lui, bataille qui lui permit la conquête du duché de Milan ; elle affirmait une capacité militaire incontestable, et c’est d’ailleurs à cette occasion que cette bataille fut racontée puisque jusque là, cela n’avait pas été fait.
Dans la propagande que les Français vont développer pour justifier cette candidature française, il était impératif de démontrer la capacité de François Ier à assumer la protection de l’espace germanique en plus de la protection du royaume de France. Cette victoire de Marignan et la conquête de Milan en étaient les preuves. Un élément important, car la puissance ottomane était proche des frontières impériales et tentait de grappiller des territoires vers la Hongrie ; elle avait déjà conquis la Croatie...
Il y avait cette idée, toujours, de montrer qu’un prince se devait être un prince guerrier capable de conduire des armées et de les mener à la victoire. Et ce point-là fut l’atout de François Ier sur Charles Quint. Reste que la défense des frontières ne fut pas le seul argument retenu par les Français, il y a eu aussi tout un discours autour des liens communs entre Français et Germains que l’on fit remonter jusqu’aux origines gauloises, avec cette idée qu’un roi de France pouvait donc gouverner des Allemands puisque français et allemands auraient été à l’origine un seul et même peuple.
Le plus gros problème pour François Ier fut de briser ce courant déjà bien en place où les identités nationales se renforcent, il n’y parvint pas : le fait d’être gouverné par un étranger était devenu de moins en moins supportable à beaucoup. Alors certes, le Habsbourg était autrichien, il n’était pas totalement allemand, mais de par ses liens avec de précédents empereurs : Maximilien Ier (son grand-père Habsbourg, ndlr), et Frédéric V, son arrière-grand-père, il correspondait davantage à l’imaginaire allemand qu’un Français qui lui avait une toute autre conception du pouvoir et de l’organisation politique.
Il faut ici reparler de la centralisation de l’autorité royale, étrangère à la plupart des États allemands dans l’Empire. La définition même de cette Allemagne qu’on connaît aujourd’hui, fédérale, est un peu une résurgence de ce Saint-Empire germanique. Certains territoires ont été absorbés par les uns et par les autres, mais finalement l’idée des Länder, de cette construction régionale, existait déjà au début du XVIème siècle. C’était d’ailleurs un peu compliqué de pouvoir imaginer qu’un roi de France, avec cette politique de centralisation qu’ils connaissaient et pouvaient critiquer, puisse être leur chef...
Intéressante perspective, opposant déjà les libertés germaniques au centralisme français...
Oui exactement. Mais le même problème se présente avec l’Italie. Et c’est pourquoi Charles Quint va être mieux accepté que les rois de France. Même si la position française, avec cette autorité, et principalement sous Louis XII, calmera aussi les factions internes qui mettaient à feu certains territoires.
L’alliance de la France de François Ier avec l’Empire ottoman, autant dire le grand épouvantail pour le monde chrétien, a-t-elle provoqué des remous au sein de la société française ?
l’alliance avec l’épouvantail ottoman
Disons qu’ils ont été très astucieux, ils ont présenté cela comme une alliance commerciale, qui n’est pas une alliance politique. On a le droit de s’associer pour faire de l’argent. Notons que Venise était l’état chrétien le plus puissant dans le monde oriental à la fin du XVème siècle, et une des volontés de Louis XII fut de réduire cette influence. Un traité commercial fut d’ailleurs signé avec le pacha d’Égypte, au tout début des années 1510 qui impliquait des facilités pour les marchands français sur les routes de Marseille ou de Gênes, via Alexandrie. Au même moment, il y avait aussi le chah de Perse, Ismaël Ier (1501-1524), qui commençait à faire parler de lui parmi les chrétiens ; l’organisation de la Perse rassurait parce que les chiites ont un clergé - c’est savoureux quand on songe à la manière dont on considère, maintenant, la religion en Iran. Dans leur imaginaire et dans leurs croyances, ils étaient regardés plus proches des chrétiens que les Turcs. On se disait alors qu’une alliance pouvait être possible dans la perspective d’une croisade, y compris pour se protéger des prétentions ottomanes dans les Balkans, en Hongrie, et en Italie. Dès le règne de Louis XII, l’idée d’un relationnel économique certes, mais peut-être aussi politique, était déjà dans l’air. La puissance incontestable de Bajazet II (1481-1512) et de Selim Ier (1512-1520) rompit cette idée, tout simplement parce que la Perse fut conquise par les Turcs tout comme l’Égypte. Dans les années 1520, tout ce qui fut imaginé par Louis XII était devenu obsolète.
Il faut repenser les rapports avec l’Orient. Dans les années 1520, on songeait en France à développer un nouveau relationnel économique, et potentiellement une alliance, pas forcément militaire, pas forcément politique, mais qui correspondrait à une forme de soutien avec les Turcs, un lien que s’apporteraient deux ennemis face à un ennemi commun bien identifié. Un peu comme Staline et Roosevelt s’associant contre Hitler à partir de 1941. Mais il était hors de question de mettre cela à découvert, tout simplement parce qu’un roi très-chrétien ne peut pas s’associer dans une alliance politique avec un prince ottoman, et inversement l’Ottoman n’eut pas non plus envie de s’allier avec un chrétien. On oublie souvent ce point, mais le sultan qui était plus puissant que le roi de France, n’avait pas intérêt à afficher au grand jour une telle association. Cette ambivalence, des deux côtés, va être respectée. Il y aura toutefois des relations, des ambassades, et un rapprochement réel après la défaite française de Pavie (1525) entre la France et l’empire de Soliman, et plus encore après 1530 : à partir de cette date, l’alliance politique fut effective, même si elle ne fut pas déclarée. Lorsque l’armée de Soliman, et surtout de Barberousse (le fameux corsaire ottoman, ndlr), va arriver à Toulon et y camper pour préparer le siège de Nice, la propagande royale trouva un stratagème assez extraordinaire : alors qu’officiellement il n’y avait pas de musulmans dans le pays, la propagande de François Ier annonça à une population peu au fait des affaires mondiales que Soliman souhaitait devenir chrétien. L’annonce de la conversion prochaine du sultan, qui justifiait l’accueil de ces soldats qui à la suite de leur souverain allaient devenir chrétiens eux aussi, ne manque pas de sel.
Beaucoup d’habileté dans la politique royale en effet...
Oui, c’est intéressant : au moment où des Turcs vont poser le pied en France, la royauté va se retrouver coincée et devoir justifier ce que, des années durant, elle n’a pas assumé. Soliman devenu chrétien, cette alliance devenait concevable. Mais l’entente avec Soliman rentre dans une politique plus vaste que François Ier entreprit au début des années 1530: la recherche des soutiens de tous les opposants à Charles Quint, dont les princes protestants allemands, les cantons suisses protestants, et bien sûr l’Angleterre... Même si cette dernière alliance tiendra surtout du vivant de Catherine d’Aragon (la première épouse déchue d’Henri VIII, elle était également la tante de l’empereur, ndlr) : sa disparition éteindra une grande partie les griefs nés entre Henri VIII et Charles Quint après son divorce, ce qui provoquera des renversements d’alliances.
Mais Henri VIII, finalement, est un prince secondaire dans ce jeu. À l’époque Soliman est bien plus puissant que tous les autres, à l’exception de Charles Quint. On a tendance, aujourd’hui, à considérer ce sultan comme négligeable dans ce conflit, voire anecdotique, et à donner à Henri VIII la même place qu’un François Ier ou qu’un Charles Quint. Considérez, aujourd’hui, une guerre entre Poutine et Biden, et mettez Macron au milieu. Ça ressemble à ça : il existait une puissance anglaise politique, financière et militaire certes, mais son influence était réduite. Cet oubli parce que, par la suite, l’Angleterre devint une puissance énorme, et tint tête au royaume de France, comme pendant la guerre de Cent ans, et lui infligea plusieurs défaites successives, je pense notamment au temps napoléonien. Au début du XVIème siècle, l’Angleterre, c’est 5-6 millions d’habitants et un État qui sort d’une longue période de guerres civiles, et si Henri VIII reprit place dans le concert européen, il ne put prétendre à autre chose qu’à une place d’arbitre. Certainement pas celle d’un belligérant à part entière, et à cette époque, la puissance d’un souverain et d’une nation tient essentiellement à leur capacité à être belligérant à part entière.
La France a-t-elle manqué en cette époque, par ses méthodes plutôt brutales de domination, des occasions de s’attacher des alliances équilibrées, solides et durables en Italie ? On songe aussi à Napoléon qui n’a vu ses alliances avec les États de la tierce Allemagne que comme un moyen d’assoir la puissance française...
Italie et centralisme français
Longtemps les dirigeants français ont cru que la puissance armée suffisait, avec un peu de diplomatie par-ci par-là.
C’est une vraie question : comment faire coïncider les principes d’unification, d’autorité et de puissance avec le vivre ensemble. La France fut sous le règne de Louis XII la première puissance européenne, riche par l’étendue de son territoire, la qualité de son sol et sa population nombreuse. Certes, il y avait parfois des famines à cause de mauvaises saisons, mais c’est peu par rapport à d’autres États qui n’avaient pas de quoi nourrir leur population en raison de l’étroitesse de leur territoire, du relief de celui-ci, et devaient recourir à l’importation de blé, etc... Cette puissance française a su conquérir des territoires limitrophes, de langue française et avec des habitudes françaises, mais pas les autres. Pour Charles VIII, on a pu parler d’inexpérience pour Naples. Pour Louis XII, le problème fut presque le même dans le même royaume. À Milan et à Gênes, en revanche, cela fonctionna mieux, si l’on se place d’un point de vue impérialiste, malgré l’autoritarisme des Français. Il est intéressant de voir que Louis XII n’a jamais été critiqué directement ni à Gênes, ni à Milan ; il y avait un vrai respect pour le personnage mais aussi une vraie opposition envers les Français sur le terrain : leur violence, leur grossièreté, et cette manière de se comporter avec un rapport de dominant à dominé...
Le fonctionnement très hiérarchisé de la société française ne pouvait être accepté dans des cités qui, malgré leur imperfection, avaient tout de même installé une forme de régime avec des pouvoirs partagés. Ce système français, qui prévalait partout sur le territoire national, va être imposé avec peu de finesse dans les territoires conquis, parce qu’il était considéré, par ces mêmes Français, comme le meilleur. Mais, comme je vous le disais tout à l’heure, ce qui peut fonctionner pour supprimer des factions dissidentes au sein d’un État montre aussi ses limites, parce que cela coûte cher d’entretenir une armée d’occupation, et qu’on n’impose pas impunément une domination extérieure à des peuples habitués à des formes de liberté où ils trouvent leur compte...
De ce point de vue, c’est bien expliqué dans le livre, Charles Quint et les Habsbourg ont fait preuve de davantage de compréhension, et de finesse...
Parce qu’eux vivaient avec cet empire aux pouvoirs partagés. Regardez Maximilien Ier, souvent il ne put monter une armée conséquente parce que la Diète (assemblée réunissant les États et cités membres du Saint-Empire, ndlr), lui refusait l’argent. Pourtant la puissance de l’empire germanique à cette époque est réelle. L’empire est aussi grand que la France démographiquement parlant, il est relativement riche aussi, il y a du commerce, de quoi nourrir la population... Si son fonctionnement avait été à l’égal de la monarchie française, il y aurait largement eu de quoi concurrencer le roi de France, voire l’empêcher sérieusement dans ses ambitions expansionnistes. Mais privé du soutien financier de la Diète et des revenus personnels insuffisants pour mener une guerre sur le long terme, les tentatives de Maximilien Ier ont rapidement tourné court. Les hispano-impériaux ont eu cette intelligence pragmatique consistant à respecter les libertés, notamment la liberté de commerce en Italie. Ils n’ont pas imposé une autorité politique sévère.
Quand on regarde l’état de l’Europe à la fin des guerres d’Italie on se dit : tout ça pour ça ? La France n’aurait-elle pas eu meilleur compte à pacifier et à développer son domaine plutôt que de chercher querelle à d’autres ?
(Rires) C’est ce qu’on a répété cent fois à Charles VIII, à Louis XII, à François Ier, à Henri II... Il y a une jolie phrase qui avait été adressée à ce dernier, quelque temps avant qu’il ne signe la paix du Cateau-Cambrésis (1559) et qui disait en substance : "Vous allez avoir 40 ans, vous commencez à avoir des cheveux blancs, occupez-vous de vos châteaux, occupez-vous de vos affaires et de votre famille, ces guerres ne servent à rien..."
D’autant que les gains semblent avoir été très faibles...
bilan globalement...
Sur le plan territorial, et toujours si l’on se place d’un point de vue impérialiste, le bilan fut pratiquement nul. Sauf les cités de Toul, Verdun et Metz qui ont été conservées après le traité du Cateau-Cambrésis, parce que la paix s’est faite avec l’Espagne, non avec l’empire. Calais et Thionville furent, quant à elles des villes reprisent à l’Angleterre. Mais il faut considérer toutes les souffrances endurées par la population pendant ces années. Songez à Alexandrie, ville du duché de Milan ravagée à chaque fois que les Français franchissaient les monts, songez aux sièges et aux pillages de Milan, Pavie, et bien d’autres villes encore en Toscane ou dans le royaume de Naples, à ces hommes et ces femmes qui payèrent de leur vie les ambitions de quelques uns. Cette violence française, ces destructions, ont été zappées de notre imaginaire et de nos souvenirs. Alors que ce fut terrible. Et je ne parle même pas des épidémies, des problèmes alimentaires, de la destruction de terres agricoles qui s’y ajoutèrent... Ce fut là un appauvrissement incontestable de la péninsule, que les Italiens mirent des années à relever.
De tout cela, les Français furent responsables parce que conquérants, d’ailleurs cela faisait partie de leur stratégie. Avancer en force, semer la terreur pour que les autres villes ensuite obéissent et se rendent. Ils n’ont pas vu les conséquences d’une telle stratégie, mais sans doute aussi, à leur corps défendant, savaient-ils qu’une conquête éclair, une bataille victorieuse et un traité de paix imposé rapidement pouvaient tout changer. C’était tellement vulnérable, tout ça...
Ce qui est intéressant, c’est ce qui se construisit alors : de plus en plus, des nations vont s’entendre pour lutter contre un ennemi commun. Auparavant l’ennemi commun, c’était le Turc. L’idée d’union de pays chrétiens contre un ennemi de la Foi était une évidence depuis des siècles. Mais que des États chrétiens s’unissent contre un autre État chrétien pour le détruire, ou pour l’empêcher de nuire, ça c’était nouveau. C’est Louis XII qui va contribuer à faire de ces conflits italiens un conflit européen, notamment dès les problèmes avec Naples et Ferdinand II, en essayant de monter une armée sur les Pyrénées et la côte de Barcelone. Il va échouer mais l’idée resta. L’union qu’il établit en 1508 contre Venise avec Maximilien Ier et Jules II en est la preuve. Reste que cette stratégie se retourna bientôt contre lui et la France. Sous François Ier, peu à peu, les conflits vont se déplacer de la péninsule - où les Français pourront de moins en moins rentrer - vers les territoires de France. Cette guerre de François Ier avec Charles Quint passe pour une guerre dont l’enjeu serait le contrôle du territoire de l’autre, or, ce n’est qu’un déplacement des conflits, dont l’origine reste l’Italie. Si François Ier n’avait pas été obsédé par l’idée de conserver Milan, pour lui ou pour l’un de ses fils, tout se serait arrangé après 1525.
Il faut observer aussi qu’alors, la querelle d’un prince, si elle n’était pas conclue, se transmettait à son successeur. Et finalement, entretenir les querelles faisait partie du devoir des souverains. C’est un élément important dans cette idée de continuité, dans cette lenteur et dans cette langueur de ces guerres.
Et comme vous le suggérez, la France s’est abîmée moralement à force de chercher querelle à ses voisins, avec qui elle aurait pu établir d’autres types de relation...
Oui, c’est sûr et certain. Les frontières n’ont quasiment pas bougé, pour de folles sommes d’argent dépensées, surtout pour de grandes souffrances humaines et des ravages territoriaux. Pour rien comme vous le dites, ou pour si peu. Mais quand on regarde, aussi, le bilan de toutes les prétentions napoléoniennes, hitlériennes ou autres, finalement on en arrive toujours un peu au même résultat : le pouvoir de la nation, de la frontière. Ce sont des sujets sur lesquels on avait pas mal travaillé dans les années 1970. Puis ces sujets ont été délaissé été, peut-être parce que l’union Européenne avait abattu la puissance de l’idée de nation et muée la symbolique de la frontière. On ne faisait plus la guerre en Europe, on pensait être protégé, donc travailler ces questions ne servait plus à grand-chose, avait même des relents nationalistes pas très heureux. Or, ce problème nous revient là comme un boomerang, en pleine figure avec la guerre russo-ukrainienne. Songez aussi au discours du président chinois il y a quelques semaines en direction de Taïwan. Cette fragilité du monde, on était convaincu d’en être protégé, nous européens. Les rapports indirects d’un conflit russo-ukrainien voire d’une asiatique nous touchent aussi, financièrement et économiquement certes, mais peut-être aussi politiquement un jour.
À la fin des guerres d’Italie, l’empire Habsbourg a l’ascendant sur les royaumes ibériques et sur une bonne partie de l’Europe allemande, tandis que l’Angleterre commence à regarder sérieusement du côté des mers qui feront sa gloire - Elizabeth I n’est pas loin. La France a-t-elle repensé son positionnement européen et mondial à ce moment-là, et n’a-t-elle pas raté une entente qui, dans un esprit de revers, eût été naturelle, soit avec les impériaux, soit avec les Anglais ?
les yeux tournés vers les mers
La concurrence, la haine même avec les Habsbourg était tellement énorme qu’il était compliqué d’envisager une entente. Si la paix des Dames (1529) a existé (elle mit fin à la septième guerre d’Italie et fut signée par la mère du roi de France et la tante de l’empereur, ndlr), c’est parce que François Ier et Charles Quint étaient incapables de se retrouver l’un l’autre en face à face. Évidemment que dans les faits, les souverains étaient à la manoeuvre, la paix est une question trop importante qui implique des territoires, il était inconcevable de laisser une paix se faire entre personnes n’ayant pas officiellement de pouvoir.
Il est évident que, jusque dans les années 1530, ce qui se passait de l’autre côté de l’Atlantique n’était pas la chose la plus importante, tant pour les Français que pour la très grande majorité des autres États d’Europe : dominer l’Europe c’était dominer le monde. Ces conquêtes étaient vues comme subsidiaires ; en France, on ne savait pas trop d’ailleurs ce que ça rapportait. Par ailleurs, le royaume avait été exclu du partage des terres nouvelles du continent américain par la papauté d’Alexandre VI ; certes, depuis Louis XII, il y avait bien des armateurs privés qui s’y aventuraient, quelques voyages réguliers furent même entrepris par des armateurs rouennais notamment, mais cela restait marginal. D’ailleurs, à cette époque les côtes africaines restaient souvent plus attractives pour les Français, tout simplement parce qu’avec le cabotage on a moins besoin de navires. Il ne faut pas oublier que la France n’était pas encore un pays maritime. Preuve en est que, pour la campagne de Naples de Charles VIII, celui-ci fut obligé de construire en vitesse des bateaux, d’en louer au Portugal et à la république de Gênes. La France n’avait pas le matériel pour faire de grandes expéditions, et pour tout dire elle n’en avait pas l’ambition. La France regardait vers les terres, pas encore vers la mer.
À partir des années 1530, il y eut ces voyages de Jacques Cartier, qui honnêtement ont été largement magnifiés par les historiens français, et notamment après 1830, parce qu’il fallait bien qu’on ait nous aussi un découvreur comme les Portugais, les Italiens et les Espagnols, mais l’homme prit une route connue des pêcheurs de morue depuis longtemps. Rien de vraiment exceptionnel. D’autre part, il n’était pas noble. Or, pour faire une conquête et prendre le pouvoir sur un territoire au nom du roi, la personne se devait d’être noble pour pouvoir réunir le ban et l’arrière-ban (convoquer les vassaux et arrières vassaux, ndlr) et exercer la justice royale. Jacques Cartier fut financé, certes, encouragé, bien sûr, mais il fut surtout un éclaireur. L’aventure canadienne fut un fiasco. L’expérience brésilienne dont on parle bien moins, eut plus d’ampleur. Elle fut encouragée par les marchands rouennais dont on a déjà parlé qui avaient développé un commerce avec l’Amérique du sud, et qui incitèrent Henri II à tenter l’aventure. C’est l’épisode de la baie de Rio. Un projet politique aussi, puisqu’il fut envisagé d’y envoyer les protestants. Mais les rivalités, les ignorances, là encore à faire une conquête loin du territoire national s’avérèrent désastreuses. Quant la tentative de colonisation de la Floride, elle s’acheva piteusement en 1565, sous Charles IX (1560-1574). Des expériences qui pouvaient être utiles à l’idée de monarchie universelle que les rois de France entretenaient par ailleurs pour justifier leurs combats en Italie, mais dans lesquelles ils ne s’investirent jamais autant que pour les territoires de la péninsule. Ce ne fut que sous le règne d’Henri IV (1589-1610), qu’il fut reparlé plus sérieusement de nouvelles aventures vers le Canada...
J’avais lu d’ailleurs quelque chose de très intéressant à propos des Français qui, contrairement à d’autres peuples, ne s’expatriaient pas, et que cela avait beaucoup joué dans l’échec de ces colonies : contrairement notamment aux Anglais ou aux Hollandais, les Français ne s’installaient pas massivement outre-océan.
Oui, furent embarqués d’abord les plus pauvres. Ceux qui firent le voyage au début du XVIIème siècle étaient des paysans du Poitou, de la Charente, et des régions montagneuses sans guère de revenus. Ceux qui vivaient en ville, dans les plaines fertiles, qui avaient de l’argent où seulement de quoi se nourrir avec leur lopin de terre et leurs animaux n’étaient pas franchement intéressés par ce type d’aventure. L’intérêt de la bourgeoisie et d’une partie de la noblesse désargentée pour les colonies n’apparut réellement qu’au XVIIIème, lorsqu’ils se rendirent compte des profits qu’ils pouvaient tirer.
Nous commémorons cette année, à l’occasion de son 450e anniversaire, le massacre de la Saint Barthélémy. Peut-on établir des liens évidents entre ces guerres d’Italie et l’explosion des conflits religieux en Europe ?
après les guerres d’Italie, la guerre civile ?
Justement, en mettant ces guerres d’Italie de côté, on a oublié quelque chose d’important dans l’explication du développement du calvinisme, de loin la religion réformée la plus répandue en France - le luthéranisme n’a pas vraiment marché dans le royaume au XVIe siècle, sauf en Normandie. On a souvent expliqué ce phénomène - c’est en tout cas l’explication qu’on m’avait apportée à l’école, et longtemps après aussi - par l’influence des commerçants, notamment allemands et suisses, qui venaient aux foires de Lyon et qui avaient peu à peu converti, par leurs ouvrages et les liens d’amitié sceller avec la population française, de plus en plus de monde, notamment tout long de ce croissant qui de Provence, passe par le Languedoc, se prolonge en Guyenne, et s’achève aux limites de la Normandie. Or, c’était oublier que la plupart des soldats de l’armée royale d’origine française était de ces régions, et que, quand on est en guerre, le commerce s’appauvrit considérablement, que les échanges avec les États avec lesquels on se bat sont stoppés. Par ailleurs, les personnes de nationalité étrangère vivant en France, et alors que leur pays étaient en guerre contre le royaume étaient expulsés ; il fallait attendre un, deux, trois ans parfois pour pouvoir recréer les liens. C’était bien trop irrégulier pour engendrer ce courant qui ne cessa de se développer à partir des années 1540, et plus encore après 1550.
À la fin du règne d’Henri II, près de 20% de la population française était susceptible d’avoir adhéré à la Réforme, ce qui est beaucoup quand on voit le système d’information, le temps mis pour le courrier, la faible diffusion des textes, etc. Et ça a touché toutes les classes de la société, notamment la noblesse. Or parmi cette dernière, beaucoup ont participé aux guerres de François Ier et d’Henri II : c’est un point qu’on a oublié, et qui pourtant est très clair dans des tas de récits, notamment italiens, dont on à pas fait cas. 6000 Suisses des cantons protestants, 6, 9 ou 12000 lansquenets ou reîtres allemands, protestants eux aussi, étaient avec les armées françaises, en Champagne, en Picardie, pendant des mois. En Savoie ils ont été là pratiquement tous les jours pendant près de 20 ans. Tout cela a incontestablement eu une influence. Ces protestants qui vivaient avec leurs pasteurs, à proximité de catholiques, même séparés par nations, échangeaient, forcément. Y compris bien sûr entre officiers. À la fin de ces guerres d’Italie, une grande partie de la noblesse française s’était convertie. Si cela n’avait été que le fait de commerçants ou de paysans, voire même de simples soldats, ça n’aurait jamais marché. Il aurait été facile de circonscrire, comme le pouvoir royal avait pensé le faire, les mouvements réformés par des punitions violentes, des expulsions... À partir du moment où des gens de pouvoir ont mêlé la religion à la politique, comme cela fut sous François II et Charles IX jusqu’à la Saint Barthélémy, la force de la réforme en fut décuplée, et la résistance royale mise à défaut, au moins au début. C’est vraiment un point important : je suis totalement convaincu que ce temps de guerre et les zones des conflits ont participé fortement à la diffusion du calvinisme en France.
On associe beaucoup ce seizième siècle à une Renaissance culturelle foisonnante, à des histoires de gentilshommes aussi. On n’a pas vraiment ce ressenti quand on vous lit. En ce temps-là, il y a eu à la fois de la violence, des pillages culturels, ou bien aussi de véritables patronages d’artistes par les grands princes ?
renaissance et récits politiques
Il y a beaucoup de questions dans votre question. On l’a dit, l’échec politique fut total, et jusqu’au XVIIIème siècle il a été entretenu par les historiens. Ces guerres furent considérées comme un ratage, une illusion, une chimère exorbitante pour aucun bénéfice. Ces jugements sont aussi à replacer dans le cadre de la lutte Bourbon-Valois : les Bourbon sont arrivés au pouvoir à la disparition des Valois, une succession qui fut justifiée comme étant un choix de Dieu, afin de mettre de meilleurs rois sur le trône. C’est toute la propagande du règne de Henri IV pour expliquer son avènement, et qui grosso modo va durer jusqu’à Louis XVI dans les livres d’histoire. Sous Napoléon Ier, les critiques des guerres d’Italie sont toujours là, sans doute, pour condamner indirectement les guerres de l’empereur. Dans son ouvrage, Anquetil, s’il ne critique pas ouvertement les campagnes napoléoniennes, il ne se retient nullement pour condamner celles menées trois siècles plus tôt par les rois de France, sous-entendant que l’on dépense beaucoup d’argent, que l’on ruine la vie de milliers d’hommes pour quelque chose qui sera probablement éphémère.
La monarchie restaurée, à partir de 1814-15, ne pourra évidemment pas reprendre à son compte l’imaginaire d’avant 1789. La monarchie de Louis XVIII se voulut comme un régime d’avant l’absolutisme. Pour cette raison, la propagande royale invoqua des figures royales populaires, dont la réputation fut toujours bonne, et dont le souvenir est marqué par une politique modérée, et aussi assez éloignées dans le temps. Si Louis XII a fait ses guerres d’Italie, pour lequel il était critiqué, sa politique intérieure était considérée depuis la seconde moitié du XVIème siècle comme exemplaire ; outre qu’il aurait été un bon roi, économe et parcimonieux, il portait avec lui cette gloire d’avoir fait baisser la taille de manière significative, chose extrêmement rare. Cette image de bon gestionnaire, de roi père du peuple qu’il s’était construite pour expliquer de son vivant qu’il pouvait gérer sinon le monde au moins la chrétienté, dans son ambition impérialiste, avait traversé les siècles, et n’était plus regardé que par le prisme national. Une politique fiscale qui, par ailleurs avait été rendue possible seulement parce que les états italiens sous sa domination payaient le manque à gagner en France. Il fut donc une figure essentielle au règne de Louis XVIII, tout comme le fut Henri IV, autre père du peuple, autre roi modéré et qui plus est, père de la dynastie Bourbon. Il faut aussi avoir en tête qu’en 1815, la France était occupée et donc dans l’impossibilité de faire la guerre. La France de Louis XVIII, en son commencement, ne pouvait se regarder impérialiste. Par ailleurs, sa situation économique n’était pas brillante. Et parce qu’il fallait toujours espérer autant dans l’avenir que dans le nouveau régime et tenter de rassembler ces Français déchirés, la propagande royale misa sur un élement qui pouvait unir tout le monde, l’existence d’un « génie français ». Un génie qui se serait exprimé autant par la création artistique, que par les sciences, etc.. et qu’il était plus aisé de développer alors, voire même de perfectionner.. Des thèmes qui étaient à la base de l’idéologie du progrès, à laquelle tous les régimes politiques adhérèrent au XIXe siècle puisque fédérateurs, cultivant ainsi et toujours cette « particularité française ». Par ailleurs, au même moment on vidait le Louvre, par la restitution de plus de 6000 œuvres pillées, lors des guerres napoléoniennes. Dans ce contexte, fut entreprit une véritable politique culturelle devant prouver l’existence antérieur de ce « génie ». Le Louvre servit de pierre angulaire à ce courant. Car en plus de rassembler les œuvres françaises au Louvre, qui devint par ce biais le temple de la création française, fut commandé par le pouvoir des peintures devant illustrer les grands moments de ce « génie ». Ce fabriqua ainsi, peu à peu, deux récits : celui de la « civilisation française » née de toutes les autres « civilisations » et que le Louvre allait désormais protéger, et celui d’une histoire de France en peinture, figurant les grands moments qui firent la gloire de cet état depuis ses origines, récit qui sous Louis Philippe sera définitivement installé au château de Versailles.
Parallèlement à cela, la monarchie entendit préserver ses principes moraux, ses valeurs, qui restaient catholiques. Elle développa ainsi tout un imaginaire d’avant le temps des hérésies, des luttes diverses et variées entre Français pour faire oublier les guerres civiles et les autres. Par l’intermédiaire des valeurs chevaleresques qui correspondaient si bien à l’idéal monarchique, on exalta aussi ce qui fut nommé l’esprit français. Et pour illustrer cette idée, il fut recherché dans le passé des figures qui auraient rassemblé en elles toutes les valeurs humaines et spirituelles encouragées par le nouveau régime. On trouva certes des capitaines, mais il fallait un souverain pour mieux assoir l’idée. Le chevalier Bayard, dont la popularité avait été remarquable depuis le début du XVIIe siècle, n’avait jusque là jamais été attaché à François Ier ; on préférait se souvenir de lui sous le règne de Louis XII. Quant à François Ier, il avait été déclaré mauvais roi depuis le règne d’Henri IV, pour ses guerres perdues en Italie, justement, mais aussi pour sa prétendue légèreté et sa soumission aux femmes. Reste que l’homme avait fait bâtir des châteaux toujours debout et que l’on commençait à les restaurer. C’est alors qu’on se souvint de l’épisode de l’adoubement du roi par Bayard inventé par Symphorien Champier en 1525, et qu’il situa au soir de la bataille de Marignan. La popularité de l’un aida à la réhabilitation de l’autre. Par ce qu’il avait laissé à la France comme bâtisseur, mais aussi par son esprit chevaleresque recréé qui impliquait bravoure toujours indispensable, et le souvenir du faste d’une cour qu’il avait considérablement augmenté, preuve d’un état prospère, il devint rapidement un excellent roi, digne de servir de modèle au nouveau régime, incarnant à lui seul ce génie français. Ses frasques sexuelles devinrent de la galanterie civilisée, et ses dépenses, de la magnificence. Son temps fut redécouvert, les artistes de son époque sortirent de l’oubli. Tout cette mythification de cette époque va littéralement faire oublier, ou au moins rendre secondaires, ses échecs politiques et impérialistes. L’idée fut continuée sous la monarchie de Juillet et les autres régimes ensuite. Et fut inventé, toujours en rapport avec cette idéologie du progrès, ce temps de "renaissance", celle d’une nouvelle prise de conscience de l’Homme par rapport à son destin. L’historien Jules Michelet fut celui qui constituera le mieux ce concept, qui vit toujours. Alors certes, les guerres d’Italie dans ces nouveaux livres d’histoire ne seront pas oubliées, mais elles ne seront plus expliquées, justifiées, elles deviendront un décor pour argumenter cette révolution. Elles ne seront considérées que comme l’étincelle qui fit naître la « Renaissance », un prétexte, et vont peu à peu disparaître de l’imaginaire collectif au profit d’un temps d’élévation de l’homme vers sa perfection. Les Français, dans cette affaire étant bien évidemment supérieurs aux autres, d’où l’invention à la même époque de la notion de « civilisation française » dont nous avons parlé tout à l’heure. Ce temps de guerres, de violences et d’échecs, mué en une nouvelle naissance devint un moment crucial et positif de l’histoire de France et des Français.
Pour le coup c’est une construction de récit politique, mais vous, avec votre regard d’historien, dans quelle mesure pensez-vous que c’était une manipulation des faits, et dans quelle mesure y a-t-il eu du vrai là-dedans ?
Il y a du vrai. Quand Louis XII arrive en Italie, il récupère toute la bibliothèque de Pavie. Les bibliothèques Sforza et Visconti sont à Paris, il faut le savoir... Il y a aussi tout l’imaginaire antique qui avait été délaissé et qui renait non pas seulement parce que les rois de France partent en Italie, mais aussi parce que cela convient parfaitement à leur propagande impériale, et peut illustrer visuellement la théorie des transferts des empires. Par ailleurs, la découverte des jardins, d’une autre forme d’architecture à influencée une forme de création en France, c’est incontestable. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’Italie était ravagée, et tout peintre, architecte, jardinier avaient besoin de commanditaire ou de mécène pour vivre. La France était un pays vaste et riche, certains italiens ont été appelés, d’autres sont venus tenter leur chance. Mais cette vague n’est pas si importante. Par ailleurs, l’idée de la collection a toujours existé. Elle était la preuve soit d’une érudition, soit d’un haut niveau de vie ou d’une élévation sociale. Des Français ont enrichis leurs collections, certes, mais essentiellement des nobles, et souvent par le pillage, plus rarement par la commande ou l’achat. Mais ce sont des choses, je le répète extrêmement secondaires au regard de l’action politique.
Charles Quint a-t-il été un prince plus intelligent que la plupart des rois de France de cette époque ? Doit-on d’abord à son caractère l’échec de ses ambitions de constituer un empire chrétien universel et durable, à supposer qu’il l’ait eue ?
le mystère Charles Quint
"À supposer", comme vous dites en effet. Entre des thèmes de propagande qui justifient des levées d’impôts, des guerres et des conquêtes, et la réalité il y a parfois un monde. Mais ce fut pareil pour les Français : les rois qui se voulaient-ils eux aussi empereurs universels, y croyaient-ils vraiment ? Je ne sais pas et ne faisons pas de politique fiction...
Charles Quint était-il intelligent ? Je n’en sais strictement rien. Il se trouve qu’il a bénéficié dans sa vie de jeune homme d’une chance immense. En héritant de l’Espagne, puis en se faisant élire roi des Romains, il a presque sans rien faire acquis une puissance colossale, en Europe et de l’autre côté de l’Atlantique. Je pense qu’il était très bien conseillé. Comme je l’ai dit précédemment, les Allemands savent vivre dans des États composites alors qu’en France, avec cette idée d’unité territoriale et de centralisation du pouvoir monarchique l’imaginaire n’est pas le même. Les conquêtes impériales n’étaient pas moins autoritaires que les conquêtes françaises, mais les compromis que Charles Quint accepta pour conserver ses conquêtes furent bien plus grands que ceux envisagés par les Français.
Quant à cette idée de monarchie universelle, la propagande tant en France que dans l’empire, elle l’a entretenue dès le départ. Pour Charles Quint, elle se développa après son élection de 1519, puis après sa victoire à Pavie et la défaite de François Ier (1525), et le sac de Rome (1527) et d’avantage encore jusqu’à son couronnement comme empereur. N’oublions pas que coup sur coup Charles Quint était parvenu à mettre à genoux ses principaux rivaux chrétiens François Ier et Clément VII. Ces deux là vont ensuite, par un réflexe de survie, s’allier (la ligue de Cognac, etc...) sans plus de résultat. Il est un fait incontestable, en 1530, lorsqu’il se fait couronner empereur, Charles Quint est l’homme chrétien le plus puissant du monde et le rêve de la monarchie universelle sous son contrôle, une possibilité avec laquelle ses publicistes ont su jouer alors très intensément. Mais, dès 1531, il fera de son frère Ferdinand un roi des Romains. Dans le même temps, il donnera à sa sœur, Marie de Hongrie la régence des Flandres, en remplacement de leur tante Marguerite d’Autriche, décédée. Puis, dès qu’il en aura l’âge donnera à son fils Philippe II les Flandres et l’Espagne. Finalement, il n’y aura pas d’empire universel sous un seul homme. Politiquement et sur le plan matériel, ce n’est pas tenable. En revanche, le partage de cet immense territoire entre une même famille fonctionna. En fin de compte, le résultat de ces guerres d’Italie est bien là : c’est maintenant une famille, les Habsbourg, qui domine l’Europe chrétienne, avec à sa tête Charles Quint, soutenu par son frère, sa sœur et son fils ; une domination qui va durer plus d’un siècle.
Mais donc, je reviens là-dessus, face à cette rivalité amère, et alors que les Tudor n’avaient plus vraiment d’ambition territoriale en France, on ne pouvait pas s’entendre avec les Anglais, même si de puissance moindre ?
Tout de même, dans les années 1520, Henri VIII rêve toujours de revenir en France. C’était sans doute impossible à faire, mais il pouvait y croire. La reprise de Calais par les Français en 1558 est restée dans le coin de la gorge de Mary Ière puis d’Elizabeth Ière. Les ententes quand elles ont eu lieu ont toujours été ponctuelles, encore une fois parce que la puissance anglaise d’alors était secondaire. L’historiographie récente a mis Henri VIII au même niveau que les autres, un peu comme on a fait pour certains intellectuels de ces temps. Par ailleurs, Henri VIII, François Ier et Charles Quint ont tous eu de très longs règnes. Mais je le redis, l’Angleterre ne peut alors, par ses moyens et par ses hommes, qu’être un soutien. Elle a très bien joué ce rôle du reste, et fit capoter à chaque fois les ambitions de l’un et de l’autre, un peu comme la papauté au même moment. Mais elle n’a rien gagné non plus. Ce n’est qu’avec la guerre contre l’Écosse, sous Elizabeth Iere que ce royaume prit une autre dimension. Notez qu’à la fin de sa vie (une fin de vie qui n’était pas prévue) Henri II envisageait très sérieusement une invasion de l’Angleterre et placer Marie Stuart à la place d’Elizabeth... Mais voir les rois de France quitter l’Italie pour mettre la main sur l’Angleterre et l’Écosse n’était pas du tout, non plus, dans l’intérêt de Philippe II...
La guerre de Cent-Ans n’était pas encore complètement terminée donc...
Tout cet imaginaire fait de rancunes et de rivalités va durer jusqu’au XXème siècle.
L’Italie n’a pas été unie sous bannière italienne avant la moitié du XIXe siècle. Les plus grandes occasions manquées en la matière sont-elles à rechercher du côté de l’État pontifical ?
le pouvoir temporel du pape
Non parce que les papes de l’époque, Jules II et Léon X, ont tous caressé cette idée d’une possibilité d’unification de l’Italie sous la papauté. Elle avait pour elle ce pouvoir spirituel grâce auquel elle a pu menacer ces rois français qui cherchaient à la déstabiliser. Quand Charles Quint prendra en main, soit sur le plan militaire, soit sur le plan diplomatique, cette péninsule italienne, son souci sera aussi de limiter cette puissance pontificale. Non pas en cherchant à amoindrir le pouvoir spirituel du pape, dont il eut besoin pour se faire couronner empereur, mais en lui interdisant ses prétentions expansionnistes.
Nous évoquions tout à l’heure l’Angleterre qui avait empêché l’un et l’autre en tant qu’arbitre ou soutien temporaire à une des deux puissances, et bien la papauté a fait la même chose. Elle a entravé les ambitions de Louis XII qui, sans cela, aurait bien pu réussir son pari. Et par ce pouvoir spirituel, elle a aussi empêché Charles Quint de dominer complètement l’Italie. Mais là encore, ce dernier a été plus habile que les Français, qui se sont risqués à invoquer la validité même du pouvoir spirituel du pape, principalement sous Jules II, en envisageant de le déposer par un concile. L’empereur a lui mis le doigt sur le pouvoir temporel qui était toujours discutable : tout le monde savait alors que la donation de Constantin (en vertu de laquelle Constantin Ier était censé avoir donné l’imperium sur l’Occident, ndlr) était un faux, et les dons territoriaux faits à la papauté dataient essentiellement de Charlemagne, donc de l’Empire. Si Charles Quint a laissé à la papauté son territoire, il a également circonscrit les prétentions temporelles de la papauté. L’erreur française, celle de Louis XII en particulier, fut de vouloir jouer avec le feu du pouvoir spirituel : on prétendait pouvoir changer de pape à sa convenance. Il faut dire aussi que Charles Quint eut des papes bien plus souvent favorables à l’Empire qu’à la France dont ils limitèrent, même alliés les possibilités dans la péninsule. Les Français n’étaient acceptés que comme libérateurs, non comme conquérants.
Et donc, on peut considérer que, jusqu’au milieu du XIXè siècle, c’est en grande partie l’Empire, et notamment la Maison d’Autriche, qui va tenir l’Italie...
Incontestablement. Jusqu’à son unification, ce sont bien en effet les Habsbourg de la Maison d’Autriche qui vont dominer l’Italie. Avec quelques nuances parenthèses toutefois : il y a eu l’époque napoléonienne,...
Cette question-là sera un peu plus fantaisiste. Dans une série de jeux vidéo, Assassin’s Creed, on déambule dans l’Italie de ce XVIè siècle et on peut rencontrer des personnages de l’époque, interagir avec eux : De Vinci, Machiavel, César Borgia, etc... Si vous pouviez faire un tour en ce temps-là, quelle question poseriez-vous à l’un des personnages de ce temps, quel conseil lui donneriez-vous ?
fantaisie historique
J’avoue que je serais très curieux d’aller voir Louis XII ! Parce que finalement, il a été le plus malin et le plus brillant. Il s’est conduit de manière très autoritaire, personne ne le conteste, mais il a eu une vraie intelligence ; avec des publicistes, il s’est forgé une image de roi idéal, qui perdurera longtemps. J’aimerais essayer de comprendre ce temps que j’ai toujours eu du mal à concevoir, et qui détermina le début de la fin, pour l’historien, de la réussite de l’aventure impérialiste dans la péninsule. Ce temps où il s’attaqua au pouvoir spirituel du pape, en essayant de le faire déposer par un concile, emportant avec lui un Maximilien Ier qui rêva alors de porter la tiare. Parce que fut un échec, tant en France qu’en Allemagne, il n’en fut guère parlé de cette union franco-allemande où l’un le Français se ferait empereur, et l’autre, le Germain se ferait pape. C’est comme un trou noir dans l’Histoire de cette époque, qui pourtant fut essentiel. Là serait ma curiosité. Les autres ? Pas vraiment...
Quels sont vos projets, vos envies pour la suite ?
Le projet est déjà bien entamé, c’est un travail sur Charles IX qui permettra définitivement de conclure les guerres d’Italie. En 1559, les Italiens croient que les Français vont revenir, ils le croiront longtemps d’ailleurs. On va finalement passer d’une succession de guerres expansionnistes à une succession de guerres civiles. Je voulais travailler sur Charles IX depuis longtemps, parce que sans lui, on ne peut pas travailler sur d’autres personnages, notamment les Guise. Après, je travaillerai sur d’autres sujets. Et comme je vous l’ai dit, j’ai aussi envie de me pencher sur ces notions si actuelles de nation, et d’empire...
J’espère bien évoquer ces sujets avec vous en temps voulu ! Un mot pour conclure ?
Je n’ai jamais su faire de conclusion de ma vie, ça va être difficile (rire). Je vous laisse libre de la faire !

Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !