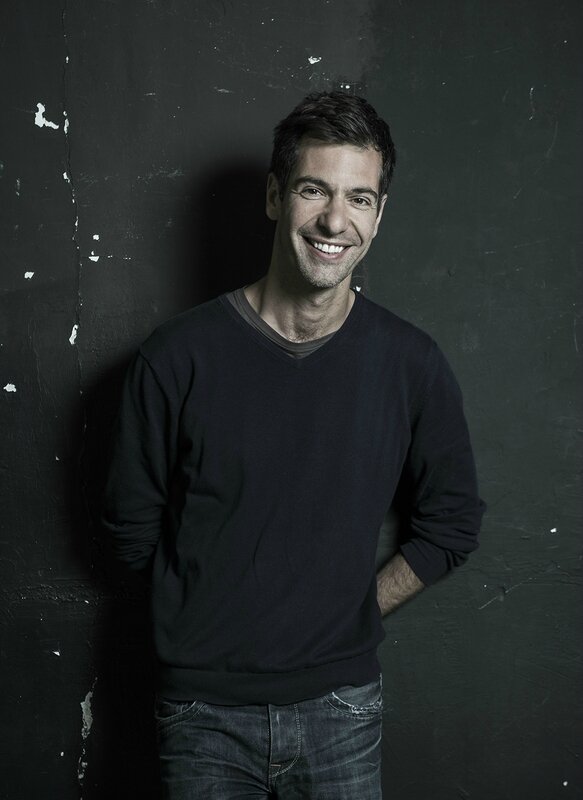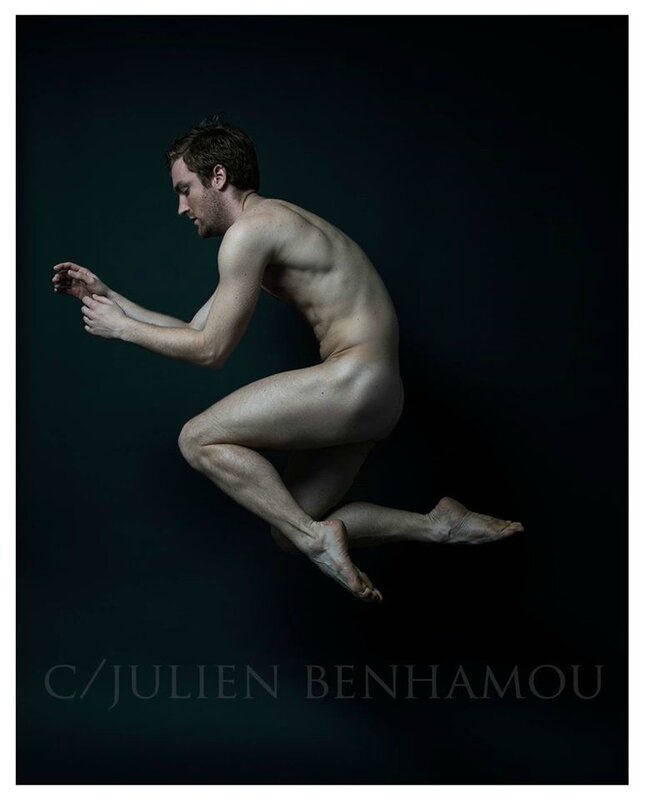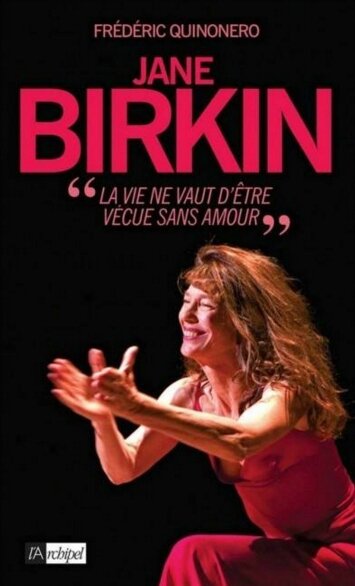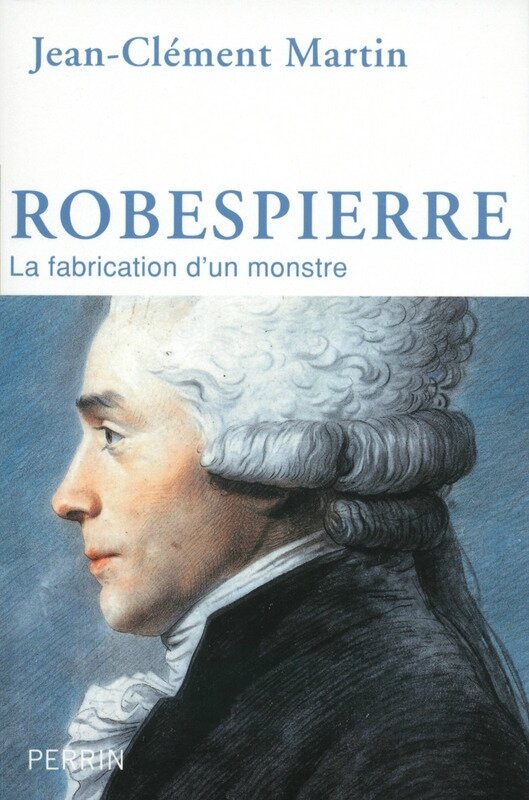« Garder l'espoir face au terrorisme... », par Guillaume Lasconjarias
L’aéroport de Bruxelles, le 22 mars 2016. Crédit : capture d’écran/Twitter.
Elles paraissent de moins en moins irréelles, ces images de quartiers de capitales européennes transformés en un éclair - plutôt, en un souffle - en zones de guerre. Le plus terrible, c’est peut-être que nous commençons à nous y habituer, à intégrer désormais dans un coin de nos têtes les scénarios-catastrophes comme des hypothèses plausibles. Comme un réveil, un réveil brutal. Paris, janvier 2015. Paris, novembre 2015. Bruxelles, donc, mars 2016. Dix ans après Madrid (2004) et Londres (2005), trois tragiques illustrations en quinze mois à peine d’un terrorisme de masse en plein cœur d’une Europe occidentale qui, longtemps, s’est un peu crue préservée des turpitudes du monde. Faut-il apprendre à vivre avec ces menaces ? Comment agir pour les désamorcer et, surtout, traiter les racines du mal ?
Le 22 mars, quelques heures après les attentats bruxellois, et cinq mois après notre interview d’octobre (qui mériterait certainement d’être lue ou relue), j’ai souhaité inviter M. Guillaume Lasconjarias, chercheur au sein du Collège de défense de l’OTAN, à nous livrer à titre personnel l’état de ses réflexions quant à ces questions qu’aujourd’hui tout le monde se pose. Je le remercie de s’être prêté à l’exercice. Un document à découvrir... et à méditer. Une exclusivité Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.
Garder l’espoir face au terrorisme...
par Guillaume Lasconjarias, le 23 mars 2016
Hier, mardi 22 mars 2016, au cours d'une matinée tragique, la Belgique a été frappée par une série d’attaques coordonnées et meurtrières. Au-delà du pays, c'est l’Europe qui a été touchée par ces actes monstrueux dans une de ses capitales – et pas n’importe laquelle, Bruxelles, centre des institutions de l’Union Européenne et capitale de l’Europe, mais aussi quartier-général de l’Alliance atlantique. D’abord prudentes, les autorités belges ont confirmé la piste terroriste, et l’État islamique a bientôt revendiqué ces frappes. Encore une fois, les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments, et le drapeau belge a été projeté en signe de solidarité sur les façades des monuments les plus symboliques de Paris, Berlin ou Rome. Sur Twitter et sur Facebook, le hashtag « #JeSuisBruxelles » s’est répandu, signe d’une émotion perceptible. Devant l'horreur, comment ne pas céder à la colère et à la peur ? Alors que l’enquête débute, la première réaction est d'abord de protéger une population sous le choc. Comme à Paris après le Bataclan, forces policières et unités militaires quadrillent le terrain et patrouillent tandis que les responsables politiques prêchent pour un renforcement de la coopération européenne. Mais dans le même temps, comment ne pas s'interroger sur les faillites du renseignement, comment ne pas céder à la tentation d'identifier les coupables mais aussi de chercher des responsables, bref se donner l'impression faussement réconfortante d'agir ?
Dans ces conditions, comment prétendre à vouloir prendre du recul ? Et pourtant, comment ne pas s’interroger sur ce qui devient une nouvelle normalité, une menace qui n’est plus seulement planante mais une réalité tangible ? Sommes-nous donc condamnés à vivre dans l’ère du terrorisme de masse ? Les Européens sont-ils prêts à faire face à ce que le Premier ministre italien Renzi appelle « une menace globale mais où les tueurs [« killers »] sont aussi des locaux » c’est-à-dire qu’ils appartiennent à nos sociétés [Note 1] ? Et bien entendu, sommes-nous prêts à y faire face, à nous en défendre et à prendre des mesures qu’on prétendra efficaces, quitte à troquer nos libertés contre plus de sécurité ? Le débat n’est pas neuf, mais il mérite peut-être d’être abordé sous un angle légèrement différent.
Souvent, la première préoccupation du chercheur ou de l’universitaire, surtout confronté à une notion aussi complexe que le « terrorisme », est de circonscrire l’objet et de donner une définition. Mais voilà : il n’existe pas de définition du terrorisme. Ou plutôt, il en existe plusieurs : les États, les organisations internationales possèdent chacun une idée de ce qu’est le terrorisme, en insistant sur les dimensions techniques – les faits et la typologie des actes – et sur les aspects légaux – l’illégalité de l’emploi d’une force indiscriminée et souvent aveugle. Dans un ouvrage qui vient à point nommé, l’historienne Jenny Raflik s’y essaye et rappelle que derrière l’étymologie (la terreur et la peur), il y a l’émotion et que derrière l’émotion, il y a une subjectivité : « le terroriste des uns pourrait aussi bien être le résistant des autres » [Note 2]. La condamnation de l’acte et de celui qui le commet n’est donc pas universelle, il existe des appréciations selon les camps et la panoplie des moyens dont ils disposent pour accomplir leurs objectifs politiques ou idéologiques. Le terrorisme pénètre dans le champ de la morale, de la cause juste : par un renversement observé, les terroristes deviennent des martyrs, et les victimes sont en fait des coupables. L’acte, de quelque nature qu’il soit - fusillade, bombe, assassinat… - devient l’expression du faible contre le fort, un moyen de fragiliser des sociétés et des gouvernements en frappant n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. Certainement, la première réaction face à cette brutalité est la sidération. Puis la peur, puis l’incompréhension, puis la colère, dans un kaléidoscope d’émotions – encore – qui se succèdent.
Viennent alors les nécessaires ajustements et la question lancinante de l’adaptation ou de la réponse à la menace : y sommes-nous préparés ? Peut-on y être préparé ? Plutôt que d’accuser l’inhérente fragilité des démocraties libérales face à la terreur, il est loisible de réfléchir à des cas particuliers et peut-être, de s’interroger sur la façon dont on peut, sans trahir ses valeurs, résister. L’atout de l’historien peut être de trouver des similitudes et des réponses dans un passé plus ou moins récent ; on songe aux comparaisons possibles avec la façon dont nos mêmes sociétés démocratiques ont, dans les années 1960 et 1970, puis dans la dernière décennie, fait l’expérience du terrorisme – qu’il soit rouge (la bande à Baader ou la RAF en Allemagne, les Brigate Rosse en Italie), noir (par des groupes d’extrême-droite néo-fascistes aussi en Italie) ou jihadiste. On peut s’inspirer de la capacité d’Israël à résister et à conserver les attributs d’une démocratie représentative dans un environnement volatil. Sans doute y a-t-il, dans ces cas, matière à tirer parti pour non seulement comprendre, mais aussi bâtir une véritable stratégie de résilience.
Pourtant, dans l’agitation médiatique, le premier besoin semble l’action, la prise de décision symboliques – on se souvient du débat sur la déchéance de nationalité – accompagnant des mesures sécuritaires – le déploiement des forces armées sur le territoire et en ville en étant l’expression manifeste. Sans contester le bien-fondé de ces choix, il faut sans doute chercher d’autres réponses sur le long terme. Affirmer que nous sommes en guerre contre le terrorisme n’apaise en rien : au contraire, cela renvoie à des images d’« axe du mal » (Axis of evil), de « guerre mondiale contre le terrorisme » (Global War on Terror) qui n’ont au final eu qu’un succès très limité. À l’inverse, se résigner à l’idée de vivre avec cette épée de Damoclès n’est guère plus défendable. On peut et l’on doit songer à des stratégies qui permettront dans le long terme de lutter autant contre les actes que contre les raisons qui justifient le terrorisme : un éditorial paru ce jour, au lendemain des attaques, invite à aller visiter Molenbeek, ce quartier défavorisé de Bruxelles, pour mieux comprendre le terreau sur lequel pousse le terrorisme qui frappe nos sociétés ouvertes [Note 3].
C’est sans doute logiquement ce que les sciences humaines, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, le droit, les humanités en général, doivent faire : aider à comprendre, à expliquer – et non à justifier. Elles doivent servir à apporter des réponses qui ne peuvent être seulement techniques. Elles doivent mettre en avant que les fractures sociales, politiques, et religieuses, peuvent être dépassées, et peut-être résolues. Elles doivent rappeler que si ce combat est une lutte pour des valeurs, ces valeurs doivent continuer à être portées haut sans « faire payer à la liberté les frais d’une sécurité menteuse » [Note 4]. Au contraire, accepter de combattre pour nos valeurs et vaincre par nos valeurs [Note 5], sans transiger, mais sans céder à la peur de l’enfermement, du repli sur soi et de la défiance généralisée.
Note 1 Matteo Renzi, dans la Repubblica du 22 mars 2016, “Minaccia globale, ma i killer sono anche locali”
Note 2 Jenny Raflik, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Paris, Gallimard, 2016, p. 16.
Note 3 Giles Merritt, “FRANKLY SPEAKING - After the Brussels attacks: Meeting fire with fire isn’t the answer”, Friends Of Europe
Note 4 Selon une critique faite par Pressenssé et Pouget des « lois scélérates » dans la France de la fin du XIXe siècle (cité par J. Raflik, op. cit., p. 302)
Note 5 Selon la belle expression employée par le chef d’état-major de l’armée de terre dans un article du Figaro le 21 mars 2016.
Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook et Twitter... MERCI !