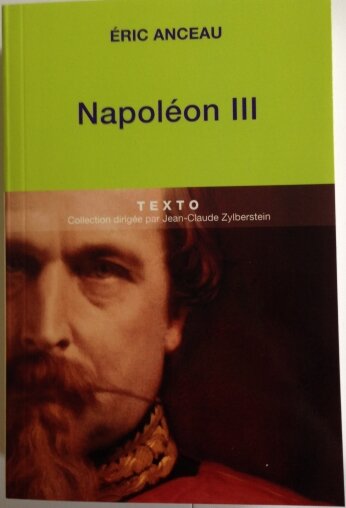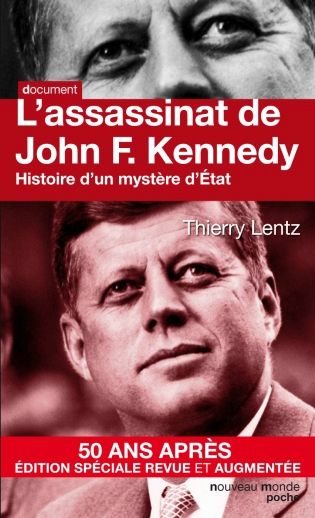En août 2015, le Japon et le reste du monde se souviendront, à l'occasion de leur soixante-dixième anniversaire, des deux uniques bombardements atomiques de l'Histoire : Hiroshima, le 6 août 1945, Nagasaki, le 9 août 1945. Deux noms qui resteront à jamais associés à l'horreur qu'inspire cette arme : ses retombées, ses images, terrifiantes... Ses victimes, innombrables... Jusqu'à quatre cent mille morts, peut-être davantage... Des dommages irréversibles. Des stigmates qui se sont perpétués, transmis, et qui se transmettent encore. Les leçons, le message aussi : « Plus jamais ça ! ».
Barthélémy Courmont est professeur de science politique à l'Université Hallym, en Corée du Sud, il est également chercheur associé à l'I.R.I.S. Il fut il y a quelques années l'auteur de l'ouvrage Pourquoi Hiroshima ? (L'Harmattan). Il a accepté d'évoquer pour Paroles d'Actu les coulisses de la décision de Truman, quelques aspects méconnus de la Guerre froide, les enjeux, les périls liés au nucléaire militaire au 21ème siècle. Tantôt terrifiant, tantôt rassurant, un document passionnant, dont je le remercie chaleureusement. Bonne lecture ! Une exclusivité Paroles d'Actu. Par Nicolas Roche, alias Phil Defer. EXCLU
ENTRETIEN EXCLUSIF - PAROLES D'ACTU
BARTHÉLÉMY COURMONT
Rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, nouvelle Asie
Chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)
« N'oublions pas l'héritage d'Hiroshima »

(Hiroshima. AP)
Q. : 21/09/13 ; R. : 08/10/13
Paroles d'Actu : Bonjour Barthélémy Courmont... « Comme si la Lune, les étoiles, et toutes les planètes venaient de me tomber sur la tête ». Avril 1945. Franklin Roosevelt est mort. Harry Truman n'a que trop conscience du poids de la charge qui pèse désormais sur lui. Lorsqu'il est informé, quelques semaines plus tard, de la réussite du test d'une nouvelle arme surpuissante, il apparaît qu'il sera rapidement confronté à un choix extraordinairement lourd... Que sait-on de ses réflexions, de ses questionnements préliminaires ? A-t-il été sérieusement pris de doutes, de cas de conscience avant de valider l'utilisation du feu nucléaire contre le Japon ?
Barthélémy Courmont : Il convient de replacer le moment où Harry Truman est informé de l’existence du Projet Manhattan par Stimson (le secrétaire à la Guerre, ndlr), en avril 1945, dans son contexte. Roosevelt vient de disparaître et, en vertu de la Constitution, c’est le vice-président qui devient immédiatement président des États-Unis. Truman est alors aux antipodes de ce que fut Roosevelt. L’homme du New Deal, élu quatre fois (cas unique dans l’histoire des États-Unis), au fort charisme et garant d’une présidence forte, laissait sa place à un sénateur du Missouri, arrivé à la Maison Blanche consécutivement à l’élection de novembre 1944, et qu’il avait, aux dires des historiens, choisi comme co-listier pour ne pas être encombré d’une personnalité trop forte. Autant dire que rien ne prédestinait alors Truman à la présidence des États-Unis. Ajoutons à cela que la guerre n’était pas terminée, ni en Asie, ni en Europe, et qu’il lui restait donc non seulement à finir le travail, mais aussi et surtout à préparer les États-Unis au nouvel ordre mondial issu du conflit. Truman n’avait pas la moindre idée de l’existence du Projet Manhattan, que Roosevelt avait souhaité garder secret au point de ne pas en informer son vice-président. Trois semaines plus tard, l’Allemagne capitulait sans conditions, puis venait le temps des empoignades avec Staline à Postdam, tandis qu’exactement au même moment, le premier essai nucléaire était mené avec succès à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, le 18 juillet 1945. Ces premiers mois de la présidence Truman furent d’une richesse exceptionnelle, un véritable moment historique, et c’est sur les épaules d’un président peu expérimenté que des décisions d’une importance cruciale pesèrent. Il fit front avec détermination, et, si on peut bien sûr lui reprocher d’avoir été le seul homme d’État à utiliser le feu nucléaire, il convient de tenir compte de ce contexte très particulier.
Dès l’annonce officielle de la destruction d’Hiroshima, Harry Truman a reconnu avoir pris la décision seul, après consultation de ses conseillers militaires et diplomatiques, mais considérant qu’il s’agissait de la décision la plus sage. Dans ses Mémoires, Truman est revenu sur cette décision, qu’il reconnaît avoir été l’une des plus importantes de sa vie. S’il n’exprime pas le moindre doute sur le fait qu’il a pris la bonne décision, c’est en s’appuyant sur le lien de cause à effet entre le bombardement nucléaire et la capitulation japonaise (même s’il est difficile de savoir si le Japon n’aurait pas, de toute façon, capitulé à très courte échéance), et sur le fait que ce choix était selon lui le “moins pire”, notamment si on se réfère aux évaluations des pertes consécutives à une invasion du Japon, comparable à la campagne menée en Europe. N’oublions pas non plus le volet financier du projet, qui a coûté à l’époque deux milliards de dollars, en d’autres termes un immense sacrifice, d’autant que les États-Unis étaient en guerre sur deux fronts, et ne pouvaient dès lors se permettre des dépenses inutiles. En utilisant le résultat de ces recherches coûteuses, Truman justifiait ces dépenses, notamment auprès des membres du Congrès, dont il convient de rappeler qu’ils n’en étaient en rien informés. Dans ces conditions, il va de soi que, dans les réflexions du président américain, le sort des victimes japonaises n’entrait pas en considération.
Aux côtés de Truman, deux personnages jouèrent un rôle décisif : Henry Stimson et James Byrnes. Le secrétaire à la Guerre, qui fut le premier à informer Truman de l’existence du projet Manhattan, n’appréciait pas le principe du bombardement des villes, et fut celui qui demanda le retrait de Kyoto (l'ancienne capitale impériale, ndlr) des cibles nucléaires. Il accepta l’idée que la bombe atomique était un choix permettant l’économie de vies humaines, mais il serait erroné de considérer qu’il s’en accommoda pleinement. De son côté, Byrnes, que Truman nomma au Département d’État à la place de Stettinius, était plus concerné par la confrontation éventuelle avec les Soviétiques qu’avec la fin de la guerre du Pacifique. Pour lui, la bombe atomique permettait de porter un coup à Moscou autant qu’à Tokyo, et pour cette raison il fut dès le départ enthousiasmé par le projet. Notons en parallèle que les scientifiques ayant contribué au Projet Manhattan s’élevèrent contre une utilisation de leur engin une fois la capitulation allemande validée, par le biais d’une pétition, mais qui resta lettre morte. L’utilisation de la bombe atomique, c’est le passage de relais du monde scientifique aux décideurs politiques, qui deviennent les seuls maîtres du feu nucléaire.
Enfin, en août 1945, la haine vis-à-vis des Japonais atteignait aux États-Unis son paroxysme, avec notamment les douloureuses expériences d’attaques kamikazes, et si elle ne put influencer directement la décision d’utiliser l’arme nucléaire, elle joua en revanche un rôle important dans les préparatifs de l’attaque, notamment en laissant de côté des questions humanistes et moralisatrices qui auraient été soulevées dans le cas d’un bombardement atomique d’une ville allemande. Ainsi, là où l’utilisation de l’arme nucléaire contre l’Allemagne aurait sans doute été à l’origine d’un vaste débat de société, même a posteriori, de telles considérations ne furent jamais évoquées à un tel niveau dans le cas d’Hiroshima, et il fallut attendre la Guerre froide et la crainte d’une guerre nucléaire avec des pertes civiles potentiellement inacceptables pour que le souvenir des horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki ne s’impose dans des débats sur la discrimination raciale.
PdA : Parmi les arguments invoqués pour justifier cette décision : la fanatisation de l'État-major japonais qui eût requis, pour l'obtention d'une paix sans condition par des voies conventionnelles, une victoire militaire totale, donc une invasion, forcément terriblement coûteuse au plan humain ; la volonté d'affirmer la puissance et la résolution des États-Unis face à une Union soviétique de plus en plus entreprenante en Europe de l'est. Quel est le jugement des historiens d'aujourd'hui, votre jugement s'agissant de l'éventuel "bien-fondé" de l'arbitrage final de Truman ?
B.C. : Comme sur de nombreux autres points, les historiens restent divisés sur cette question essentielle, et notamment en ce qui concerne les tentatives de négociation d’une capitulation honorable par la diplomatie japonaise dans les semaines qui précédèrent le double bombardement nucléaire. C’est cependant au milieu des années 1960, sous l’impulsion de jeunes historiens comme Gar Alperovitz ou Barton Bernstein (qui publièrent par la suite un nombre important d’ouvrages et d’articles scientifiques), qu’un nouveau regard, beaucoup plus critique, fut porté sur la décision d’utiliser la nouvelle arme et les premières semaines de l’administration Truman. Qualifiés de révisionnistes, ces historiens remirent en cause les arguments “officiels”, en apportant les preuve des efforts des diplomates japonais, et en replaçant la décision de Truman dans le cadre d’une Guerre froide qui ne disait pas encore son nom.
Nous avons vu que plusieurs membres de l’administration Truman, Byrnes en particulier, étaient incontestablement partisans d’une ligne dure vis-à-vis de Moscou. Le nouveau secrétaire d’État considérait ouvertement, en juillet 1945, alors que s’organisait la conférence de Postdam, que la confrontation avec l’Union soviétique était, d’une manière ou d’une autre, inévitable. Dès lors, s’il était décidé d’adopter une position de fermeté dans les négociations diplomatiques qui opposaient Truman à Staline, tous les moyens pouvant permettre de prendre un avantage décisif devaient être prises en considération. Ces éléments nous amènent à penser que l’arme nucléaire fut dès lors pensée comme une asymétrie dans ce qui deviendra officiellement la Guerre froide, offrait à Washington une avance dans sa rivalité avec Moscou. Il est nécessaire ici de revenir sur les conditions dans lesquelles les relations russo-américaines se détériorèrent après la conférence de Yalta, les points de divergence, ainsi que les questions relatives aux informations concernant l’utilisation de la bombe atomique, l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre le Japon, et la stratégie « pré-Guerre froide » telle qu’elle fut développée à Washington.
Reste la question de l’estimation des pertes américaines consécutives à la prolongation du conflit, qui joua un rôle important dans le processus décisionnel. Elle mérite quelques éclaircissements sur lesquels je me suis penché. Dans les mois qui précédèrent la capitulation du Japon, et plus encore après la fin des hostilités en Europe, les autorités politico-militaires américaines se penchèrent sur les différents scénarios permettant de mettre un terme à la guerre du Pacifique. Après la fin des hostilités en Europe, les premières troupes américaines furent transférées sur le théâtre du Pacifique, en vue d’un éventuel débarquement sur les côtes japonaises, suivi d’une progression terrestre, à la manière de ce qui avait été effectué un an plus tôt en Europe.
Le 10 mai 1945, au lendemain de la première réunion de la commission provisoire chargée d’étudier les différentes options offertes dans la guerre contre le Japon, Henry Stimson assista à une réunion des chefs d’état-major dont l’objectif était d’étudier les différents aspects de l’invasion du Japon, et de préparer cette invasion. La première conclusion des chefs militaires était que l’entrée en guerre de l’Union soviétique n’était pas nécessaire au succès du débarquement, et que les troupes américaines avaient la capacité technique de faire plier les forces japonaises sans avoir besoin d’une assistance de Moscou. Cela supposait bien entendu un sacrifice important, mais celui-ci permettait d’éviter un partage des bénéfices une fois la victoire obtenue. D’un autre côté, les chefs d’état-major reconnaissaient qu’une invasion de la Mandchourie par l’Armée rouge pouvait être suffisante pour pousser le Japon à la capitulation, et ce avant même que les troupes américaines ne doivent s’engager dans un débarquement coûteux en vies humaines. S’opposaient ainsi deux conceptions, l’une favorisant une invasion et la non-participation de l’Union soviétique, l’autre privilégiant une économie de vies humaines et l’entrée en guerre de l’Armée rouge. Mais, tandis que les hostilités venaient de prendre fin en Europe, les dirigeants politiques américains continuaient d’espérer que Moscou se joigne rapidement aux opérations dans le Pacifique. La priorité des dirigeants américains, y compris des militaires, était de parvenir à une reddition du Japon à moindre coût humain, et, pour cette raison, la participation de l’Armée rouge était vivement souhaitée. Pour autant, la possibilité d’une invasion ne fut pas écartée, et les chefs d’état-major furent chargés de réfléchir aux différentes options.
Le 25 mai, le Joint Chiefs of Staff approuva un plan d’invasion du Japon prévu par un débarquement sur l’île de Kyushu le 1er novembre 1945, sous le nom d’opération Olympic. Considérant que la poursuite des bombardements conventionnels et du blocus maritime ne pouvait être suffisante pour faire plier l’empereur, les chefs militaires américains décidèrent de préparer un plan d’invasion comparable à ceux en Europe, qui apporterait des résultats significatifs malgré des pertes lourdes. Le président Truman donna son accord le 18 juin, considérant à ce moment que la situation politico-militaire du Japon justifiait un débarquement, qui malgré les pertes énormes aurait été un succès et aurait mis fin aux hostilités. Cette opération nécessitait la participation de l’allié soviétique qui, en attaquant la Mandchourie, aurait occupé le plus gros de l’armée japonaise, rendant le débarquement possible. L’opération Olympic supposait donc, comme cela avait été prévu à Yalta, la coopération de Staline contre le Japon. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la date du 1er novembre avait été retenue, soit trois mois après la date limite prévue pour l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon, c’est-à-dire à un moment où le gros des forces japonaises aurait été mobilisé en Mandchourie.
L’opération Olympic, dans l’hypothèse où elle n'aurait suffi à faire capituler le Japon, devait être suivie d’une autre opération, du nom de Coronet, qui consistait, à partir de Kyushu, à débarquer sur l’île principale de l’archipel, Honshu, puis de progresser jusqu’à Tokyo, à la manière de ce qui avait été fait en Allemagne. Le début de cette opération était prévu pour le 1er mars 1946, supposant au préalable le succès d’Olympic et l’implantation des forces américaines dans l’archipel.
Le général George C. Marshall était favorable au plan d’invasion, qu’il avait cautionné comme étant à son avis la seule possibilité de venir à bout des forces japonaises. Si certains, comme l’amiral Ernest J. King, souhaitaient multiplier les assauts sur les positions japonaises en Chine et en Corée avant d’attaquer l’archipel, Marshall considérait qu’un débarquement sur Kyushu était possible, et aurait été couronné de succès. Avant que la bombe atomique ne vienne s’installer comme un adversaire de taille à la stratégie de l’invasion, Marshall s’était imposé à Washington parmi les autres chefs militaires comme l’homme providentiel apportant enfin une solution à une guerre trop longue et coûteuse. L’Army prenait le dessus sur la Navy, profitant des effectifs mis à disposition de ces opérations après leur démobilisation en Europe, et offrant la solution la plus radicale, permettant à coup sûr un succès sur le Japon, même au prix de lourdes pertes.
Les principaux amiraux, King à leur tête, considéraient pour leur part que l’invasion du Japon n’était pas nécessaire, et en ce sens ne partageaient pas le point de vue des généraux de l’Army. Pour eux, les opérations Olympic et Coronet n’auraient jamais dû être préparées, puisque tout débarquement sur les côtes japonaises aurait été plus meurtrier que la poursuite des raids aériens et du blocus maritime. Cependant, et ce point est important, dans les discours qui ont immédiatement suivi le bombardement d’Hiroshima, aucune mention n’a été faite de la possibilité de poursuivre le blocus maritime, tandis que l’invasion était annoncée comme étant la seule alternative à la bombe. Il semble donc que les choix stratégiques de l’Army aient fortement influencé les dirigeants américains, tandis que les options de la Navy furent négligées. Cela s’explique en partie par l’image dont bénéficiaient les généraux de l’Army, auréolés de victoires en Europe, par rapport aux amiraux de la Navy.
Les options proposées par la Navy, qui reposaient sur une stratégie de long terme visant à affaiblir un Japon totalement isolé, et un usage limité de la violence, restèrent ainsi sans écho, et ne furent révélées que par la suite, notamment dans les mémoires des amiraux concernés. Intensifier le blocus maritime, et le poursuivre pendant plusieurs mois, aurait ainsi, selon la Navy, permis d’éviter Hiroshima et Nagasaki, et rendu inutile toute tentative de débarquement. Il convient donc de s’interroger sur les choix de l’état-major et de la Maison Blanche, qui dès leurs premières réunions concernant la préparation de la dernière phase de la guerre du Pacifique, semblèrent écarter des stratégies d’essoufflement. En fait, à l’inverse des généraux de l’Air Force, les officiers de la Navy n’estimaient pas indispensable une intensification des bombardements contre les villes japonaises, considérant que l’endiguement aurait pu être suffisant.
La conférence du 18 juin autour du président Truman rassembla les principaux acteurs militaires et politiques américains, les généraux Marshall et Ira C. Eaker (représentant le chef d’état-major des forces aériennes, Henry H. Arnold), les amiraux Leahy et King, le secrétaire à la Marine Forrestal et le secrétaire-adjoint à la Guerre John McCloy. Le secrétaire à la Guerre Henry Stimson était souffrant et avait au départ annoncé qu’il serait absent (et remplacé par McCloy), mais il se présenta pourtant à la Maison Blanche au début de la réunion. Si ce fut à l’occasion de cette rencontre que Truman donna son aval à l’opération Olympic, les différentes personnalités présentes montrèrent leurs divergences, et masquèrent leurs préoccupations concernant la participation de l’Union soviétique à l’effort de guerre. Les chefs militaires avaient été convoqués quatre jours plus tôt, le 14 juin, avec comme recommandation de présenter des estimations concernant les pertes humaines dans le cas d’une invasion terrestre du Japon, de l’intensification des bombardements, ou d’un blocus naval. Dans le memorandum conviant les participants à la réunion, Leahy notait ainsi que « Truman souhaite être informé de ce que nous souhaitons que les Russes fassent ». Illustrant l’importance de l’événement, Truman nota dans son journal la veille de la réunion : « Je dois prendre une décision concernant la stratégie à adopter au Japon. Devons-nous envahir le Japon ou le bombarder et préparer un blocus ? C’est la décision la plus importante à ce jour, mais je la prendrai une fois que j’aurais tous les éléments entre les mains ».
Stimson avait entretenu McCloy de ses préoccupations la veille de la réunion, et devant le silence du secrétaire-adjoint lors de la conférence, Truman lui demanda son avis alors que celle-ci se terminait. McCloy le lui donna, selon ces termes, qui restent l’un des témoignages les plus importants concernant les débats entourant l’utilisation de l’arme nucléaire : « Il suggéra alors une solution politique… Quelque communication au gouvernement japonais qui énoncerait nos conditions, où nous n’emploierions pas les mots de ‘reddition inconditionnelle’, mais qui nous procurerait tous nos objectifs. ‘Quelles seraient ces conditions ?’ me demanda le président. J’improvisai : nous ne menacerions pas leur existence en tant que nation ; nous les autoriserions à choisir leur propre forme de gouvernement, y compris le maintien du Mikado (l'institution impériale, ndlr), mais uniquement sur la base d’une monarchie constitutionnelle, etc. ‘Bon ! J’y avais pensé, dit le président. Pourriez-vous mettre cela en forme, le donner au secrétaire d’État pour voir ce que nous pourrions en faire ?’ ‘Je suis très heureux que cette question ait été soulevée’, observa M. Stimson. Je demandais alors s’il ne fallait pas leur dire que nous avions la bombe atomique. Le mot produisit comme un saisissement. On n’avait pas le droit de le prononcer, pas plus que de parler de tête de mort et de tibias dans un cercle distingué à Yale. Cela ne se faisait pas ! ‘Je pense que notre position morale serait meilleure si nous leur donnions un avertissement spécifique au sujet de la bombe’ ajoutai-je. Un désaccord se manifesta. ‘Nous ne savons pas si elle éclatera, objecta-t-on. En cas d’échec, notre prestige serait grandement atteint.’ ‘Mais, répondis-je, tous les savants assurent que la chose explosera ; il est précisément question de l’essayer, mais ils sont tout à fait certains, d’après les rapports que j’ai vus, de la réussite. L’avantage moral que nous prendrions devrait faire accepter le risque d’un essai raté. Parlons au moins en termes généraux de sa puissance. Annonçons qu’une seule bombe détruirait une ville entière. Ils comprendraient.’ ‘Envoyez votre mémorandum au Département d’État, dit le président ; nous étudierons la question.’ Le point de vue des soldats et des marins présents était intéressant. Ils se montrèrent tous soucieux d’employer leurs propres forces pour mettre fin à la guerre. L’amiral Leahy, qui était une sorte de conseiller général et ne commandait aucune force, me parut seul d’accord pour rechercher un règlement politique… Je m’en souviens très nettement… Le général Marshall prit position. L’utilisation de la bombe, dit-il, aurait des conséquences politiques si formidables qu’il laisserait les civils prendre toutes les décisions à son sujet. Il comptait n’y intervenir d’aucune manière. Cependant, je ne l’entendis jamais exprimer l’opinion qu’il ne fallait pas l’utiliser… ».
La réunion commença à 15h30. Après avoir présenté l’enjeu de la réunion, Truman donna la parole à Marshall, en tant que chef du Joint Chiefs of Staff. Celui-ci se montra favorable à un débarquement à Kyushu, considérant qu’il s’agissait de l’option la moins coûteuse en vies humaines. Marshall estimait que la conquète de Kyushu était essentielle à la bonne poursuite des bombardements des villes d’Honshu, et indispensable à l’éventuelle formation d’un blocus. Le chef du J.C.S. expliqua ensuite que le débarquement devrait être programmé avant le 1er novembre 1945, afin de ne pas laisser à l’industrie japonaise le temps de se réorganiser et de produire de nouvelles capacités de défense. S’attardant sur la question du calcul des pertes dans le cas d’une invasion, Marshall considéra enfin que toute projection était déplacée, mais qu’il ne pensait cependant pas que le nombre de victimes américaines puisse dépasser le chiffre de la prise de Luzon (Philippines), c’est-à-dire 31 000 morts et disparus. Les arguments de Marshall, appuyés par l’Army et la Navy, étaient que la victoire sur le Japon ne pourrait être obtenue uniquement depuis les airs, et qu’il fallait par conséquent se résoudre à considérer un débarquement comme la seule option permettant d’envisager la victoire finale. Marshall rappelait souvent que les bombardements n’avaient pas été suffisants pour faire définitivement plier l’Allemagne nazie, et qu’il avait fallu attendre le débarquement sur les côtes normandes, et la progression vers Berlin pour que la victoire finale se dessine enfin. L’amiral King se montra totalement favorable à la proposition de Marshall, considérant que Kyushu était la « clef de toute opération », et que l’invasion d’une des principales îles de l’archipel japonais aurait des effets importants, permettant même une éventuelle fin des hostilités avant même l’invasion d’Honshu.
Suite à ces présentations, l’amiral Leahy contesta les estimations de Marshall concernant le nombre de victimes, considérant que les pertes dans le cas d’un débarquement à Kyushu seraient comparables à celles d’Okinawa. Il avança donc le chiffre de 49 000 morts en opposition aux 31 000 de Marshall. King se montra immédiatement sceptique, considérant que la marge de manœuvre à Kyushu serait nettement supérieure à celle d’Okinawa, et que pour cette raison, le nombre de victimes ne dépasserait pas celui de Luzon, ou de très peu, mais en aucun cas ne serait aussi élevé qu’à Okinawa. En réponse à cette réaction, Leahy décrivit les différentes raisons rendant l’invasion de Kyushu difficile et particulièrement meurtrière, appuyant une fois de plus sur l’idée selon laquelle les pertes seraient plus proches de celles d’Okinawa que de Luzon.
Truman se montra nerveux, et conclua que, d’une façon ou d’une autre, l’opération proposée pouvait avoir pour conséquence, dans le pire des cas, de provoquer des pertes aussi lourdes qu’à Okinawa, ce à quoi les personnalités présentes ne purent que se montrer d’accord, notamment le général Eaker, qui mentionna au passage avoir également l’accord d’Arnold. Les personnes présentes tombèrent également d’accord sur le fait que le temps était favorable aux Japonais, et qu’il fallait dans ces conditions préparer un plan d’invasion dans les délais les plus brefs possibles, et sans retard. Le président Truman conclua la séance en considérant que, malgré le coût humain important d’un débarquement à Kyushu, à certains égards comparable à Okinawa, cette opération s’avérait être l’option la plus crédible, et c’est donc à cette occasion qu’il donna son feu vert à la préparation du plan d’invasion.
Enfin, et ce point est important, lors de la conférence, le général Marshall cita l’opinion du général MacArthur, qui n’était pas présent. Ceux-ci se présentaient ainsi : « Les risques et les pertes du débarquement seront grandement réduits si les Russes attaquent en Sibérie suffisamment à l’avance pour obliger l’ennemi à engager le gros de ses forces. A mon avis, rien ne doit être changé à Olympic ». Truman comprenait le désir des militaires de voir l’Armée rouge entrer en guerre, mais, d’un autre côté, souhaitait limiter autant que possible la participation de l’Union soviétique à la guerre contre le Japon, afin de se placer en position de force une fois l’armistice signée. Indiscutablement, dans l’esprit du président américain, du succès de l’essai nucléaire dépendait le choix de la stratégie à adopter pour remporter la victoire finale. Si, en juin, l’opération Olympic était l’option la plus acceptable, car elle permettait de conduire à la défaite du Japon, les conditions évoluèrent rapidement, et ,un mois plus tard, les perspectives d’un débarquement furent laissées de côté au profit d’une option nettement moins coûteuse, et plus rapide.
Cependant, considérer que, dès le départ, les considérations entourant le projet d’un débarquement étaient une fausse piste est une erreur dans la mesure où, malgré les rapports des scientifiques, rien n’indiquait que la bombe serait opérationnelle dans les délais prévus. Ce qui préoccupait Truman n’était pas de savoir si les États-Unis disposeraient un jour de la bombe atomique, et si celle-ci serait effectivement aussi puissante que prévu, mais à quel moment elle serait opérationnelle et utilisable. Dans le cas d’une entrée en guerre de l’Union soviétique, les États-Unis devaient être prêts à lancer une offensive permettant de remporter la victoire finale, même si cela devait supposer un coût humain excessivement important. Cependant, il convient de s’interroger sur les conditions dans lesquelles l’opération Olympic a peu a peu été abandonnée au profit du bombardement atomique, et les arguments qui furent avancés par les autorités américaines.
PdA : 6 août 1945 : Hiroshima... 9 août 1945 : Nagasaki... et leurs suites... Quels sont les chiffres, les images dont vous estimez qu'ils devraient rester gravés dans l'esprit de nos lecteurs comme ils le sont dans le vôtre ?
B.C. : Au-delà de son caractère sinistre, la question des chiffres concernant les victimes est intéressante en ce qu’elle continue de diviser, près de soixante-dix ans après les deux bombardements nucléaires, les historiens. La raison est propre à la nature même des engins utilisés, dont on sait que les victimes succombèrent à quatre catégories de facteurs : le souffle de l’explosion; l’extrême chaleur dégagée lors de l’explosion; les incendies qui se propagèrent dans des villes construites essentiellement en bois; et, bien entendu, les radiations. L’évaluation des victimes dues aux radiations est beaucoup plus difficiles que les trois catégories précédentes, en raison de la période d’étude, et de l’identification de conditions au-delà desquelles les victimes ne seraient pas considérées comme directement exposées.
Dans ces conditions, le nombre de victimes exact est difficile à déterminer, et varie de données dites “basses” (80 000 pour Hiroshima et 60 000 pour Nagasaki) à “hautes” (plus de 400 000 pour les deux bombardements réunis), selon la place qu’on accorde aux victimes de cancers des années après l’évènement, et pour lesquels le lien avec l’exposition aux radiations est hautement probable, mais ne constitue pas toujours une évidence. Prenons l’exemple d’Hiroshima. Plusieurs années après l’explosion atomique, les habitants se sont dispersés. Certains sont restés à Hiroshima, d’autres par contre ont quitté à jamais cette terre maudite. C’est notamment le cas de ceux qui avaient perdu biens et proches, ou plus simplement de ceux qui ont trouvé refuge dans d’autres régions, une fois la guerre finie. Il est par conséquent difficile de retrouver des traces de tous les habitants pour les comptabiliser parmi des victimes d’Hiroshima. De plus, rien ne prouve, malgré les soupçons, que ces personnes sont décédées des suites d’Hiroshima, et les nombreux cas de cancers peuvent, même pour une part infime d’entre eux, ne pas être dus aux radiations dégagées le 6 août 1945. Dans cette catégorie sont également comptés tous les enfants nés de victimes d’Hiroshima, et qui souffraient de maux transmis par leurs parents, et transmirent ces maux par la suite. Là encore, il est particulièrement difficile de compter combien de personnes sont décédées vingt, trente ou cinquante ans plus tard des suites des radiations dégagées. Enfin, cette catégorie souffre du rapport victimes/population qui n’est pas quantifiable. Si 300 000 personnes sont décédées directement ou indirectement des suites de la destruction d’Hiroshima depuis 1945, comme l’affirment certaines sources, la population de la ville reste difficile à connaître, à moins de faire une somme de tous les renouvellements de population depuis cette période, ce qui semble impossible.
Un chiffre mérite cependant à mon sens d’être retenu : 1. Il a fallu une seule bombe pour détruire chaque ville, là où le bombardement de Tokyo en mars 1945 (plus de 300 000 morts) a nécessité la mobilisation de milliers de bombardiers, et d’un nombre incalculable de bombes incendiaires. Ce chiffre est encore plus éloquent dans le cas d’Hiroshima, quand on sait que cette ville n’avait pas été victime d’un seul raid aérien avant le 6 août 1945. Une seule bombe fut donc nécessaire pour détruire à près de 90% une ville importante, et les images prises dans les jours qui suivirent les deux bombardements se passent à ce titre de commentaires. L’image d’une déshumanisation, qui contraste, quand on visite les magnifiques et terrifiants à la fois musées d’Hiroshima et de Nagasaki, avec l’humanisme que ces deux villes souhaitent désormais véhiculer.

PdA : Au-delà de l'horreur qu'elles évoquent, peut-on dire de ces dates qu'elles marquent le début de quelque chose de profondément nouveau, différent, dans la manière d'aborder les relations internationales notamment ?
B.C. : Incontestablement. La capacité de destruction de l’arme nucléaire ouvrit une nouvelle ère des relations internationales, dont la Guerre froide fut le catalyseur pendant plus de quarante ans, et dans laquelle les rapports de force sont totalement bouleversés.
De fait, depuis soixante-dix ans, l’arme nucléaire s’impose comme le symbole de la puissance par excellence. Avec elle, l’humanité a été mise en possession de sa propre mort car, si la planète a survécu à toutes les guerres, y compris deux à échelle mondiale, qu’elle a subies, chacun a conscience qu’elle aurait été anéantie par la troisième si celle-ci avait été nucléaire. Lancés dans une formidable course aux armements, qui les a conduit à posséder chacun jusqu’à plus de 13 000 armes nucléaires déployées, et autant en réserve, Moscou et Washington avaient de quoi faire disparaître trente à quarante fois le monde. Cependant, conscients de leurs responsabilités, les deux superpuissances ont toujours évité, depuis Hiroshima et Nagasaki, d’utiliser ces armes dont elles savaient qu’elles pourraient les entraîner au-delà de l’irréparable.
On peut considérer qu’avec l’arme nucléaire, l’Homme devint maître de son propre destin, mais cette maîtrise est placée entre les mains de certains. En d’autres termes, à partir de 1945, certaines personnes disposèrent du pouvoir de destruction de tous, eux-mêmes compris. La victoire était celle de l’État (et des théories réalistes des relations internationales), mais pas de l’individu, là où des armes plus simples restaient accessibles au plus grand nombre, comme le prouve l’importance des trafics d’armes de petit calibre. En ce sens, le progrès technique réalisé avec la bombe atomique ne peut être comparé avec les différentes évolutions dans l’histoire de la guerre, aucune arme n’ayant jamais eu de capacité décisive aussi marquée. C’est non seulement l’intensité de la destruction, mais aussi la nature de celle-ci, reposant sur le pouvoir décisionnel d’un petit nombre, qui furent totalement bouleversées. De même, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’Homme en possession de l’arme nucléaire pouvait avoir le contrôle de la terre, avec tous les risques que cela implique. La guerre restait la « poursuite de la politique par d’autres moyens », selon les termes de Carl von Clausewitz, mais l’arme nucléaire offrit la possibilité de contrôler l’avenir de l’humanité toute entière. Ces « moyens » devenaient quasi irrationnels, dans la mesure où ils pouvaient apporter une destruction totale et sans aucune distinction.
Admirée, redoutée, fascinante, terrorisante, déshumanisante aussi, l’arme nucléaire a ainsi été génératrices de sentiments contradictoires. Gage de paix et de sécurité pour les uns, annonce de l’apocalypse pour les autres ; partisans de la dissuasion nucléaire ou avocats d’un désarmement nucléaire général et complet convaincus de l’urgence absolue d’un tel programme ; pays dotés d’armes nucléaires ou pays qui par choix ou par impossibilité juridique, scientifique ou financière n’en sont pas pourvus ; responsables politiques, chefs militaires, essayistes ou experts, du Nord au Sud, tous restent persuadés du caractère absolu de l’atout nucléaire. Les pays qui en sont pourvus, qu’on les jalouse, les admire ou les condamne, restent malgré tout considérés comme au-dessus du lot, dotés d’un avantage incomparable à tous les autres. Ainsi, depuis soixante-dix ans, les pays nucléaires règnent sur l’Olympe de la puissance, et l’arme suprême sert de moteur aux relations internationales.
PdA : J'aimerais, pour cette question, faire appel à votre intime conviction. La possession par chacun des deux camps d'arsenaux pléthoriques, l'assurance qui en a découlé d'une destruction mutuelle certaine en cas de conflit nucléaire ont contribué à éviter, précisément, les conflits directs et à grande échelle entre les deux blocs. La situation aurait-elle été la même si l'arme nucléaire n'avait pas été développée ? La "guerre froide" serait-elle restée "froide", je pense en particulier au théâtre européen ?
B.C. : Il est bien sûr difficile de répondre à cette question sans tomber dans une forme de politique-fiction, ou d’extrapolations qui resteront de toute façon invérifiables. Il convient d’abord de rappeler que, si l’arme nucléaire a, de fait, réduit les risques de confrontation entre Washington et Moscou, elle n’est pas parvenue, selon la formule de Raymond Aron, à assurer la paix entre les deux blocs. Par ailleurs, plusieurs conflits, même par acteurs interposés, confirment que les deux blocs n’en restèrent pas à des rhétoriques et des politiques de dissuasion, mais n’hésitèrent pas en certaines occasions à passer à l’attaque. Le cas de la Guerre de Corée est à ce titre particulièrement intéressant, considérant que les deux puissances possédaient déjà le feu nucléaire (Moscou ayant procédé à son premier essai en 1949), et que la puissance de ces armes était suffisamment limitée (en comparaison avec les armes thermonucléaires développées plus tard) pour en « permettre » l’utilisation. La question fut évoquée côté américain, pour endiguer l’offensive des « volontaires » chinois, mais elle resta sans effet, et la déclassification des archives des deux pays n’indique pas une volonté d’utiliser l’arme nucléaire afin de prendre l’avantage sur l’autre bloc.
Cela signifie-t-il que l’opposition idéologique et politique entre Moscou et Washington n’aurait pas été au-delà de ce qu’elle fut sans l’équilibre de la terreur imposé par l’arme nucléaire ? Difficile de se prononcer, mais il serait erroné de considérer l’origine des conflits, et les motivations de ceux-ci, sur la simple base des capacités militaires à la fois offensives et défensives. La guerre est analysée de multiples manières, et les théories sur le dilemme de sécurité nous offrent un regard pertinent sur les risques de déclenchement d’un conflit. Mais de là à en conclure que, sans l’arme nucléaire et les capacités de représailles, la guerre froide aurait dégénéré en un conflit ouvert entre les deux blocs, il y a un pas. N’oublions pas que les deux pays disposaient, en marge de leur arsenal nucléaire, de capacités dites conventionnelles considérables, qui ne furent cependant jamais utilisées à grande échelle, et ce malgré l’existence de « plans », desquels étaient d’ailleurs exclues les armes nucléaires.
Vous faites cependant référence, dans votre question, à la possibilité de voir les deux grandes puissances s’affronter sur d’autres théâtres d’opérations, et cette question fait écho à la crise des euromissiles. Moins célèbres que les fusées de Cuba, les forces nucléaires intermédiaires (FNI), plus communément appelées euromissiles, ont cependant donné lieu à la plus grande controverse stratégique des années 1980, et à certains égards de toute la Guerre froide. L’Union soviétique avait déployé au milieu des années 1970 des SS-20, missiles nucléaires terrestres qualifiés d’« euromissiles », car leur portée ne leur permettait d’atteindre que le sol européen, et laissait le territoire américain à l’abri. Les dirigeants européens, au premier rang desquels les Allemands de l’Ouest, craignaient un « découplage » de la défense de l’Europe de celle des États-Unis. Si l’Union soviétique utilisait les SS-20, les Américains étaient certains de ne subir aucun dommage chez eux, ce qui ne devait pas nécessairement supposer que la puissance nucléaire américaine soit utilisée au même titre qu’elle le serait dans le cas d’une attaque contre le territoire américain.
Pour répondre au défi, les Européens demandèrent aux Américains de déployer leurs propres euromissiles, l’objectif étant de dissuader Moscou de se lancer dans une bataille nucléaire sur le sol européen, dont les conséquences auraient été aussi terribles de part et d’autre. En 1979, l’OTAN adoptait ainsi la « double décision ».
Les États-Unis déployèrent des missiles de croisière et des Pershing II à partir de 1983, mais entre temps, une négociation soviéto-américaine s’engagea et aboutit sur un accord mutuellement acceptable. Moscou choisit l’intransigeance en profitant du décalage entre l’ouverture des négociations et le déploiement des missiles américains. Les autorités soviétiques espéraient qu’en durcissant le ton, elles feraient peur aux gouvernements européens qui, du coup, renonceraient au soutien apporté par les missiles américains. Alors que Moscou avait déployé ses SS-20 plusieurs années auparavant, les Soviétiques accusaient Washington de relancer la course aux armements. Finalement, malgré une mobilisation d’une partie des opinions publiques ouest-européennes contre le déploiement des missiles, les Occidentaux gardèrent le cap et, devant l’échec de la négociation - que l’Union soviétique, jouant la carte de l’intimidation, n’avait jamais prise au sérieux -, les premiers déploiements de Pershing eurent lieu en novembre 1983. Les Soviétiques réagirent vivement en rompant les négociations nucléaires de Genève. Mais après une courte période de bouderie diplomatique, Moscou allait revenir à la table de négociation. De façon réaliste, elle enregistrait que son opération de découplage non seulement n’avait pas réussi, mais se retournait contre elle. Elle comptait obtenir un avantage stratégique, mais se retrouvait finalement sous la menace de missiles terrestres à dix minutes de Moscou. Les États-Unis, de par leur éloignement, n’étaient pas pour leur part dans la ligne de mire des euromissiles, ce qui était un avantage considérable. Cette crise est en ce sens révélatrice de l’absence de situation totalement symétrique, en Europe comme à Cuba vingt ans plus tôt, et c’est peut-être cette absence de symétrie qui fut, dans le cas de la Guerre froide, la meilleure garantie de non-utilisation de la force armée, et de sa composante nucléaire.

La Tsar Bomba soviétique (1961) fut l'arme la plus puissante jamais utilisée par l'Homme.
Elle équivalut aux explosions combinées d'Hiroshima et de Nagasaki... multipliées par 1 400...
Elle représenta l'apogée d'une course folle aux armements. Le début d'une sérieuse prise de conscience...
PdA : Avançons un peu dans le temps... 2003 : l'Irak est envahi par l'Amérique de Bush. Le rapport de forces est totalement disproportionné, le régime écrasé. 2006 : la Corée du nord effectue son premier essai nucléaire. Une assurance-vie à l'efficacité redoutable... Un moyen d'entamer de sérieuses négociations, de pouvoir faire valoir son point de vue, en tout cas. L'appel d'air n'est-il pas préoccupant s'agissant de la non-prolifération ?
B.C. : Ce qui est intéressant dans cette question, c’est l’attitude de Pyongyang face à l’invasion de l’Irak en 2003. Le régime de Saddam Hussein ne disposait pas d’armes de destruction massive, ce qui précipita la campagne militaire américaine. De son côté, la stratégie du fou ou du pire de Pyongyang repose sur sa force nucléaire supposée et déclarée, et des capacités balistiques démontrées à l’occasion de plusieurs essais. Si elle n’est pas officiellement formulée, la stratégie de dissuasion nord-coréenne, qui doit assurer la survie du régime et favoriser les négociations avec les adversaires désignés, s’appuie sur deux piliers sans lesquels elle n’aurait aucune portée : la menace permanente d’une utilisation, et une opacité complète sur les réelles capacités nucléaires dont dispose ce pays. Cette double caractéristique est essentielle pour permettre à Pyongyang d’énoncer une stratégie pouvant être couronnée d’effet. Elle est fragile et dangereuse, mais si elle bien maniée, elle offre à ce petit pays exsangue une capacité de nuisance, et donc de marchandage, totalement disproportionnée.
Les États proliférants s’efforcent généralement, une fois qu’ils ont constitué un arsenal nucléaire, de définir une doctrine de dissuasion informant les agresseurs éventuels des réponses auxquelles ils devraient s’attendre. L’Inde et le Pakistan se sont ainsi échangé des signaux très clairs en ce sens après leurs campagnes d’essais en 1998, et instauré une sorte d’équilibre de la terreur calqué sur le modèle de la guerre froide. Pyongyang a pour sa part choisi de terroriser ses voisins en brandissant la menace de l’emploi, et allant même jusqu’à l’annoncer en réponse à ce qui serait perçu comme une provocation. Il s’agit là d’une nouvelle forme d’utilisation de l’arme nucléaire, qualifiée de stratégie du fou en ce qu’elle s’inspire de la Mutual Assured Destruction (MAD), et est renforcée par le caractère souvent jugé imprévisible du régime nord-coréen. Le message pourrait ainsi être caricaturé en ces termes : « Ne m’approchez pas de trop près où je fais tout sauter ! ». En terrorisant ses adversaires, et en utilisant à cet effet son arme nucléaire, là où ses capacités conventionnelles dépassées n’ont pas le même impact, Pyongyang pratique une forme de dissuasion par le chantage. Il faut remonter, toutes proportions gardées, à l’époque où les États-Unis détenaient le monopole du nucléaire, entre 1945 et 1949, pour retrouver une situation similaire, avant que l’équilibre de la terreur ne s’impose. La différence de taille est que la Corée du Nord place son existence dans la balance, ce qui a pour effet de bouleverser les comportements habituels qui définissent la dissuasion nucléaire.
L’autre pilier de la stratégie de dissuasion de Pyongyang est l’opacité de ses capacités. Les adversaires désignés du régime nord-coréen sont ainsi dans l’incertitude la plus totale, non seulement en ce qui concerne ses intentions, mais aussi et surtout les moyens permettant de les mettre à exécution. Or, dans un bras de fer de cette nature, le plus important n’est pas l’information dont on dispose sur le niveau de ses propres forces, mais l’information à laquelle l’autre n’a pas accès. Pyongyang joue sur cette incertitude, et l’alimente en permanence, à coup d’annonces et de tests dont les succès réels ne peuvent être démontrés et restent flous. Ici, le message serait : « Ne m’approchez pas de trop près car vous ne savez pas de quoi je suis capable ! ». Face à ce discours, la prise de risque est totale. Qui se lancerait ainsi dans une offensive militaire contre un pays dont on ne connaît que trop peu les capacités, et qui prétend par ailleurs disposer de moyens de riposte disproportionnés ?
L’opacité des capacités nucléaires de Pyongyang peut être interprétée comme la preuve de son manque de consistance. En d’autres termes, nous sommes en droit de nous interroger si la Corée du Nord dispose d’une véritable force de frappe nucléaire (à savoir des ogives pouvant être montées sur des missiles), et même si elle dispose de l’arme nucléaire tout court. Après tout, on pourrait tout aussi bien considérer que Pyongyang ne dispose pas de l’arme, ou en tout cas d’une arme utilisable, et pratique ainsi une forme inédite de dissuasion nucléaire sans le nucléaire. En ce sens, l’arme nucléaire nord-coréenne peut être qualifiée d’arme du pauvre, moins coûteuse que des capacités conventionnelles auxquelles le régime ne peut prétendre, mais qui lui permet par son potentiel destructeur de se hisser au niveau des grandes puissances. Et le résultat est plutôt spectaculaire pour un petit pays dont on imagine difficilement le régime capable de survivre sans l’arme nucléaire, ou plus exactement sans le doute qu’il laisse planer sur la possibilité qu’il la possède. À ce petit jeu, il y a de fortes chances que Pyongyang poursuive cette stratégie tant qu’elle sera en mesure de le faire, et on pourrait même imaginer d’autres régimes tentés par la même forme de dissuasion, suggérant un risque de prolifération de telles pratiques.
PdA : Il est difficile d'imaginer qu'un État, quel qu'il soit, utilise l'arme (thermo)nucléaire de nos jours, sauf en cas de péril mortel. Les retombées seraient incalculables, la désapprobation internationale unanime. Est-il réaliste, en revanche, de craindre que certaines ogives puissent tomber entre les mains de groupes extrémistes ? On a beaucoup parlé du Pakistan comme possible "maillon faible" du club nucléaire. Le club compte-t-il des "maillons faibles" évidents, aujourd'hui ?
B.C. : Il est évident que des groupes terroristes se dotant de l’arme nucléaire imposeraient une nouvelle grille de lecture de la dissuasion. Cette dernière repose sur le rôle central de l’État, et sur la rationalité qui l’accompagne. Il est ainsi de fait assez difficile d’imaginer un dirigeant s’exposer à des représailles massives, également qualifiées de disproportionnées, se mettre à dos la communauté internationale, sans même faire mention des effets possibles de l’utilisation de sa propre arme contre lui-même. Le scénario d’Hitler dans son bunker, prêt à toutes les extrémités pour entrainer avec lui sa propre population, reste heureusement très rare, mais il ne doit cependant pas être exclu, et sert de mise en garde contre ceux qui détiennent le feu nucléaire. Dans le cas des États, s’il est souhaitable que la dissuasion repose sur les épaules d’un individu, afin d’en assurer la crédibilité, elle doit également être entourée de garde-fous, afin d’éviter le pire. Dans le cas des groupes terroristes, de tels garde-fous n’existent pas nécessairement, selon la nature et les revendications du groupe terroriste bien entendu. Les attentats de New York et Washington du 11 septembre 2001 eurent pour effet de renforcer la crainte de voir des groupes terroristes se doter d’armes de destruction massive (il s’agissait notamment d’un des aveux d’Oussama ben Laden, enregistré en 1998), et d’imposer de nouveaux codes de conduite en matière de contrôle des activités pouvant être détournées par des groupes terroristes. C’est ainsi que le Conseil de Sécurité de l’O.N.U. adopta en 2004 une de ses résolutions les plus importantes de ces dernières années, la 1540, dont l’objectif est de réduire les risques de prolifération par des acteurs non étatiques, en imposant aux États de renforcer les contrôles et les dispositifs juridiques liés à la protection des sites dits sensibles.
Pour autant, les armes de destruction massive constituent-elles la principale menace à laquelle des puissances comme les Etats-Unis doivent faire face ? Utilisées de façon classique, à savoir par le biais d’un vecteur balistique, elles restent l’apanage des États, et la politique de dissuasion permet d’en limiter la portée. Dès lors, les regards se tournent vers la possibilité d’utiliser de façon à la fois efficace et asymétrique les armes N.B.C (nucléaire, biologique, chimique), et d’obtenir des résultats aussi « satisfaisants » pour leurs commanditaires que les attentats du 11 septembre 2001. Par ailleurs, des groupes terroristes peuvent-ils réellement atteindre une capacité de nuisance en matière d’armes N.B.C. sans l’aide d’un État ? Enfin, la couverture médiatique des nouvelles armes, comme les agents bactériologiques, n’a-t-elle pas pour effet de favoriser la prolifération, de fait que surestimer la puissance des armes biologiques pourrait inciter les terroristes à les acquérir ? En fait, il convient d’établir une distinction entre les armes nucléaires d’une part, et les armes chimiques et bactériologiques de l’autre, bien que toutes appartiennent à la catégorie des armes de destruction massive. Si les risques de prolifération des armes chimiques et bactériologiques sont plus importants que dans le cas des armes nucléaires, la capacité destructrice de ces dernières reste nettement supérieure, ce qui justifie une attention particulière.
La résolution 1540 tend vers une réduction des capacités de développement de telles armes en se procurant les matériaux nécessaires, reste l’hypothèse d’une « association de malfaiteurs » avec des États, ou des responsables dans des États ne bénéficiant pas de mesures de contrôle suffisamment strictes. C’est ici que le Pakistan est souvent montré du doigt comme un maillon faible, non pas en raison des dirigeants, mais du fait des difficultés relatives au contrôle de ses activités. En février 2004 (deux mois avant l’adoption de la résolution 1540), le Pakistan reconnaissait ainsi que le directeur de son programme nucléaire, Abdul Kader Khan, a transmis des informations à d’autres pays. Le « pays des purs », État fragile et menacé d’implosion, est sans aucun doute le maillon faible, malgré lui. Mais il ne faut pas exclure d’autres scénarios. Après tout, l’ex-U.R.S.S. fut, dans les années qui suivirent sa disparition, un territoire identifié comme à hauts risques en matière de possibilité d’accès à des matières fissiles et des composants nucléaires. Et la Corée du Nord, à l’agonie, pourrait très bien être tentée par la vente de quelques composants à des groupes terroristes transnationaux. Le risque est donc réel, il serait cependant exagéré de parler de menace pour les raisons évoquées.
PdA : Quels seront, à votre sens, les périls, les enjeux liés au nucléaire militaire dans les prochaines années ?
B.C. : Ils sont de deux ordres, que j’estime en continuité avec la trajectoire de ces armes depuis 1945. D’abord, les risques liés à la prolifération, fut-elle horizontale (augmentation du nombre de pussances nucléaires) ou verticale (augmentation des stocks d’armes nucléaires). La possibilité de voir le nombre de puissances nucléaires augmenter reste entière, malgré des traités internationaux et des dispositifs de contrôle efficaces. Nous sommes certes très loin de la prolifération généralisée annoncée dans les années 1950, et le fait que le club des puissances nucléaires – officiellement reconnues par le Traité de non prolifération ou non – reste inférieur à dix est à mettre au crédit de ces initiatives multilatérales. Cela ne doit cependant pas nous écarter de l’impératif d’une mise en garde permanente adressée à tous les candidats potentiels, et quelles que soient leurs motivations.
En Asie, la question de la prolifération verticale reste d’actualité. La Chine continue d’augmenter son arsenal, et la rivalité Inde-Pakistan s’est traduite par une augmentation des arsenaux de ces deux pays. Tandis que les autres puissances nucléaires se sont engagées dans un processus de désarmement, ces trois pays continuent leur progression. La Corée du Nord est bien entendu un problème encore plus sérieux, compte-tenu des incertitudes concernant la rivalité avec le Sud et les réactions des États de la région, mais la prolifération de Pyongyang n’a, d’un point de vue légal, rien de différent de celle de New Delhi et d’Islamabad. Elle s’est effectuée au mépris du Traité de non prolifération et, quelle que soit la position que ces États aient manifesté à son égard, sa portée universelle en fait des actes de violation. Le problème nord-coréen est donc ailleurs. Si l’Inde et le Pakistan sont les principales puissances militaires en Asie du Sud, la nucléarisation de la Corée du Nord pourrait à terme entraîner celle de la Corée du Sud, du Japon, voire de Taiwan, ces trois entités disposant de la technologie et des matières fissiles (par le biais de leurs programmes civils) pouvant leur permettre de franchir le pas en l’espace de quelques mois, au point qu’on évoque parfois le principe de dissuasion virtuelle pour ces pays, à savoir des capacités indiscutables, mais sans que le seuil du nucléaire n’ait encore été franchi. C’est donc, assez logiquement, en Asie du Nord-est que les risques liés à la prolifération restent les plus sensibles, et ne sont pas forcément liés à la nature des régimes, mais à des réactions justifiées par une perception négative de leur propre sécurité.
L’autre risque est lié à une forme de banalisation de l’arme nucléaire, qui laisserait la porte ouverte à son emploi. Le souvenir d’Hiroshima et Nagasaki s’éloigne un peu plus de nous chaque jour, et le nombre de survivants – les fameux Hibakusha porteurs d’un message d’espoir, de tolérance mais aussi d’intransigeance face à la bombe – se réduit. Que restera-t-il de cet héritage une fois les derniers témoins disparus ? Quel regard porteront les générations futures sur un évènement appartenant au passé, et auquel se sont superposés une multitude d’autres évènements depuis ? Il est indispensable d’entretenir la mémoire des bombardements atomiques, au même titre que la mémoire de l’Holocauste, et à ce titre les efforts des municipalités d’Hiroshima et Nagasaki doivent être loués mais aussi encouragés, pour que leur drame ne soit jamais reproduit ailleurs.
PdA : Pour vous, le désarmement nucléaire doit-il être, à terme, un objectif ?
B.C. : S’il doit être un objectif, afin de s’assurer que plus jamais de telles armes ne seront utilisées ? Sans aucun doute. S’il est possible ? Je reste malheureusement très méfiant sur ce point. Les premiers appels au contrôle international des armes nucléaires ont été formulés par les scientifiques du Projet Manhattan, dès 1945, avant même la formulation de politiques de dissuasion et des pratiques proliférantes. Ces appels furent répétés un nombre incalculable de fois, mais ne reçurent qu’un faible écho, bipolarité oblige. La fin de la Guerre froide accéléra le processus de désarmement de Moscou et Washington, mais elle fut également marquée par l’intrusion de nouveaux acteurs proliférants. De fait, la prolifération ne s’est jamais si bien portée que depuis la fin de la Guerre froide, si on tient compte du fait que trois nouveaux États, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, ont procédé à des essais.
Le geste le plus fort, le plus symbolique aussi, en matière de désarmement nucléaire total ces dernières années est le discours de Barack Obama à Prague en avril 2009, en marge d’une tournée en Europe. Ce discours s’impose comme une mise en garde à l’attention des proliférants, mais aussi comme un appel à une réflexion considérant la possibilité de sortir du nucléaire. Le souhait de Barack Obama se heurte cependant à des limites qu’il convient de mentionner. Le principal défi vient du Congrès américain, qui pourrait contrecarrer les souhaits de ratifier le T.I.C.E., comme il l’avait fait en 1999, au grand dam de Bill Clinton, qui était alors favorable à un engagement plus net de Washington dans ce domaine. Les Républicains, pourtant nettement minoritaires, pourraient contrer les projets américains, et l’administration Obama devra convaincre de la nécessité du changement dans un domaine qui a sérieusement divisé la classe politique américaine ces dernières années. Sur la scène internationale, l’accord passé avec la Russie n’est que l’arbre qui cache une forêt touffue, et qu’il sera difficile de franchir sans encombre. Les points de désaccord restent ainsi nombreux, comme le bouclier antimissile, ou le traitement des États proliférants.
Mais c’est surtout sur la relation avec les États dits « voyous » que les regards se portent. Les souhaits de Barack Obama se heurtent en effet aux gesticulations de Pyongyang et Téhéran (et potentiellement d’autres États proliférants), mais également au bon vouloir de la Chine, puissance nucléaire reconnue par le T.N.P., et élève parfois dissipé de la lutte contre la prolifération nucléaire. En se replaçant sur la question du désarmement tout en gardant la main sur la lutte contre la prolifération, l’administration Obama donne de nouveaux espoirs au contrôle des armes nucléaires, et à la conférence d’examen du T.N.P., dont on craignait il y a encore peu de temps qu’elle perde en crédibilité. Mais les défis n’en demeurent pas moins importants, et à la bonne volonté de Barack Obama devra s’ajouter la complicité de l’ensemble des États, en vue de restaurer un environnement de confiance propice au désarmement et à une lutte plus efficace contre la prolifération. Un vœu aussi pieux que difficile à concrétiser, et le président américain n’est d’ailleurs jamais parvenu à transformer son discours en des actes concrets.
Dans l’hypothèse, pour l’heure improbable, où l’ensemble des puissances nucléaires – reconnues ou non par le T.N.P. – s’accordaient pour détruire tous les stocks, le problème ne disparaîtrait pas pour autant. L’arme nucléaire, c’est avant tout un savoir, une accumulation de techniques qui, en associant plusieurs composants, mettent au point l’arme la plus puissante jamais produite. Si les stocks disparaissent, le savoir ne s’effacera pas, et le risque de voir, pour des raisons multiples, des acteurs choisir de se lancer à nouveau dans des programmes nucléaires restera entier. On peut ainsi poser la question dans l’autre sens et se demander si les armes nucléaires ne sont finalement pas la meilleure garantie face à leur prolifération incontrôlée. La réponse à cette question serait de donner les clef du nucléaire à la communauté internationale dans son ensemble – en reprenant exactement les souhaits des scientifiques en 1945 – mais si l’espoir est permis, il convient de douter du succès d’une telle entreprise.
Sans doute faut-il donc se résoudre à vivre avec le nucléaire, comme nous n’avons fait depuis soixante-dix ans, et surtout s’assurer que les doctrines de dissuasion n’évoluent pas vers des doctrines d’emploi, tout en imposant un cadre multilatéral en matière de contrôle. Et partir du principe simple mais incontournable que le danger ne vient pas tant de l’arme elle-même que de celui qui la possède et pourrait être amené à l’utiliser.
PdA : Quels sont vos projets, Barthélémy Courmont ?
B.C. : En marge de mes activités universitaires, je travaille actuellement sur des projets de recherche très différents, mais qui traitent essentiellement des questions politiques et sécuritaires en Asie-Pacifique, ainsi que des stratégies des grandes puissances. Mon prochain livre, qui paraîtra en décembre, s’intitule Une guerre pacifique, et traite de la relation Pékin-Washington. J’ambitionne cependant, en vue de la célébration des soixante-dix ans du bombardement d’Hiroshima, de consacrer un nouveau travail à cette ville, portant sur une analyse du nucléaire par le biais de mes propres expériences en relation avec ce sujet pour lequel j’ai consacré ma thèse de doctorat en science politique présentée en 2005. Je proposerai un synopsis à plusieurs éditeurs, et espère pouvoir produire un petit essai invitant à un devoir de mémoire, mais aussi de réflexion sur le sens à donner à ces évènements tragiques des 6 et 9 août 1945.

Merci infiniment, cher Barthélémy Courmont, pour votre investissement, pour vos réponses passionnantes. Et vous, quelle décision auriez-vous prise, à la place de Truman ? Quels seront, de votre point de vue, les périls, les enjeux liés au nucléaire militaire dans les mois, les années à venir ? Postez vos réponses - et vos réactions - en commentaire ! Nicolas alias Phil Defer
Vous pouvez retrouver Barthélémy Courmont...