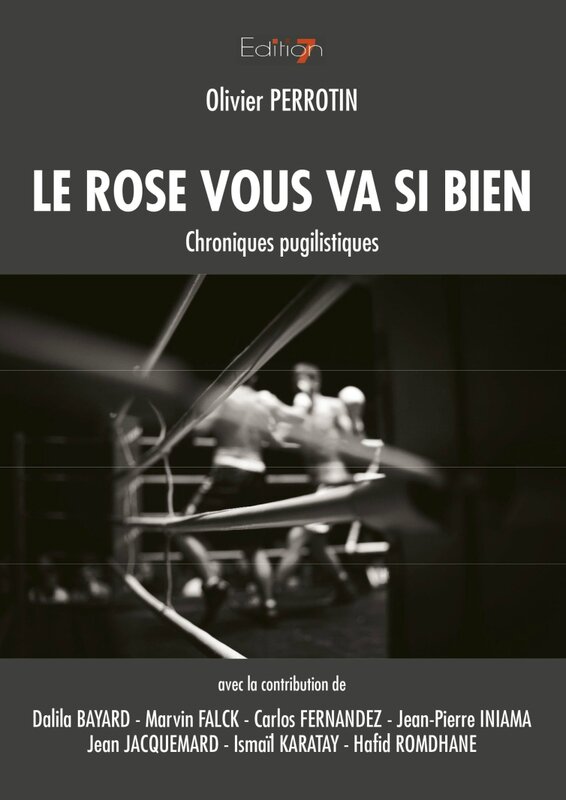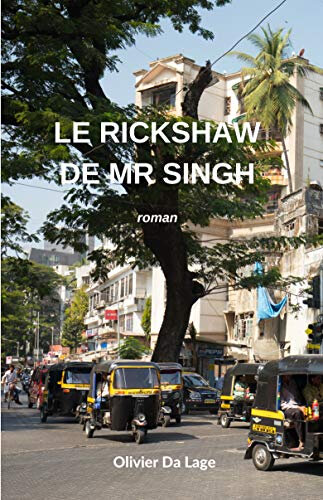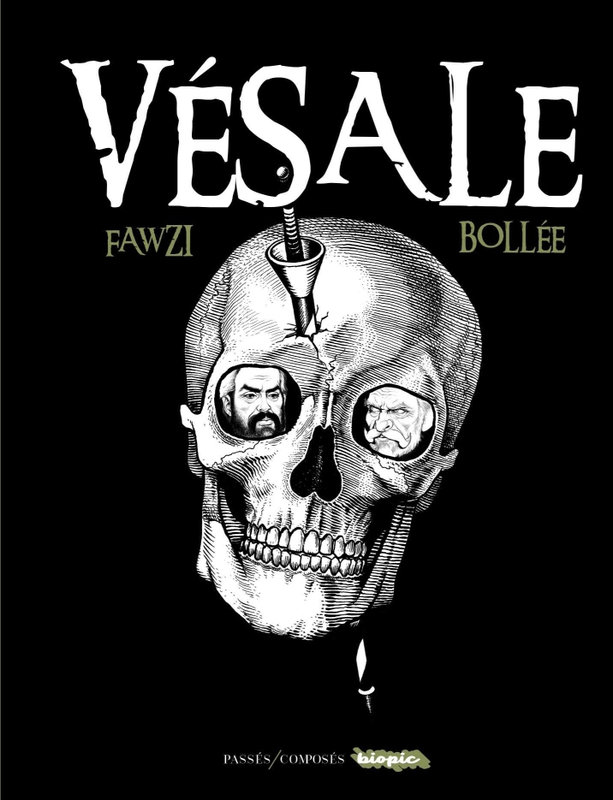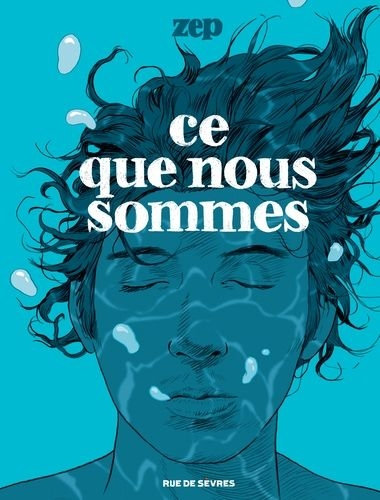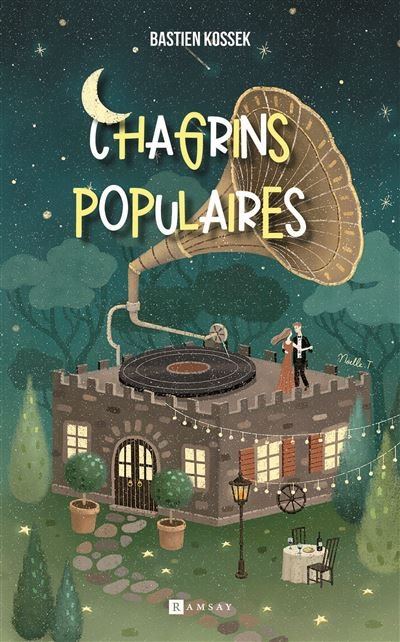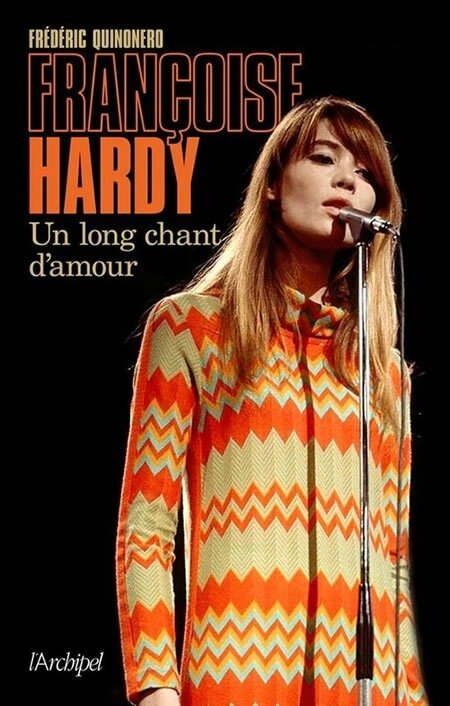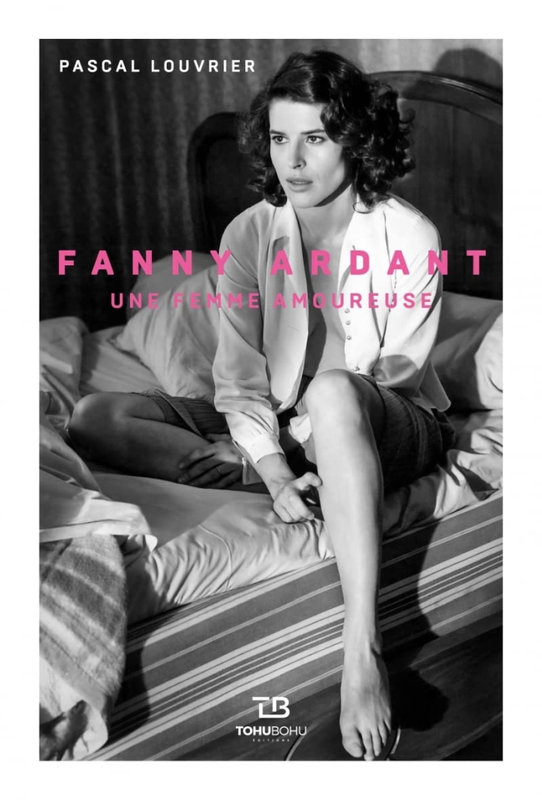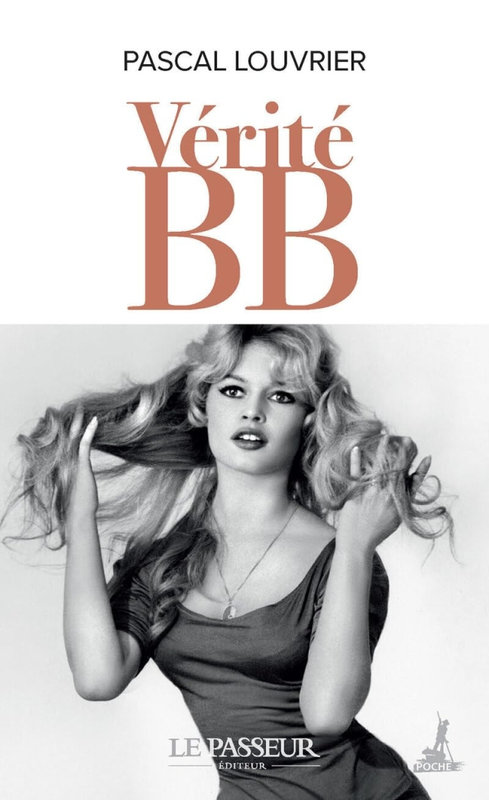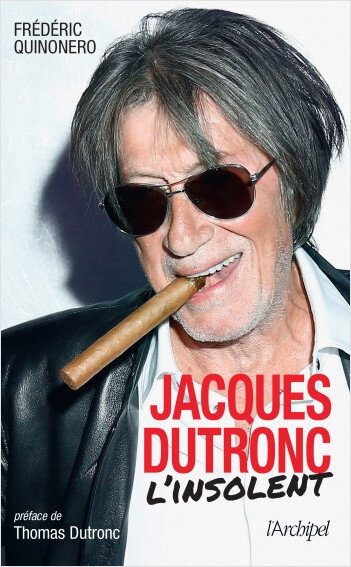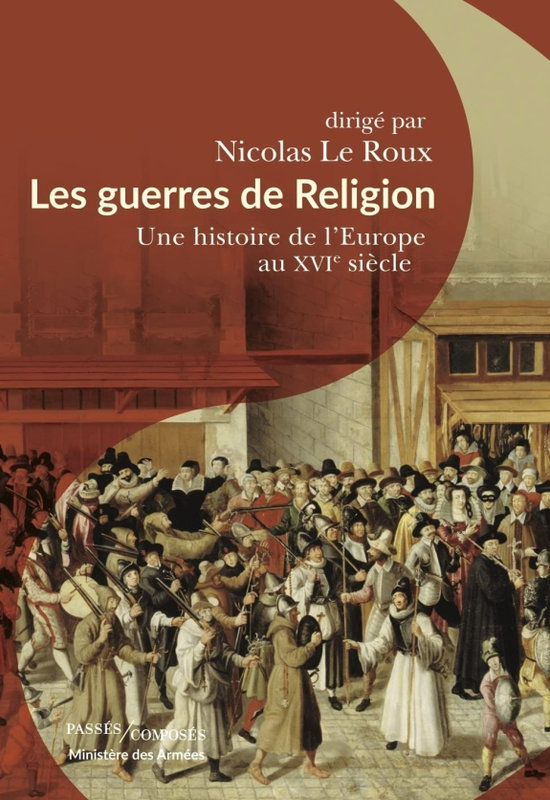J’ai la joie, pour cette première publication de l’année 2018 (que je vous souhaite, à toutes et tous ainsi que pour vos proches, sereine et ambitieuse voire, soyons fous, heureuse), de vous proposer une interview grand format (on pourrait même dire, « épique » !) de Jean-Vincent Holeindre, professeur de science politique à Paris 2 Panthéon-Assas (il est aussi membre du Centre Thucydide) et directeur scientifique de l’IRSEM. Cet échange fait suite à la lecture par votre serviteur de son dernier ouvrage, une relecture passionnante de l’histoire militaire occidentale d’après le prisme de la dualité ruse/force. Je vous engage à vous emparer de ce livre, La ruse et la force, une lecture exigeante (tout comme le présent article), mais qui sans nul doute, vous en apprendra beaucoup. Merci à vous, M. Holeindre. Et merci à vous, lecteurs qui depuis six ans et demi, me suivez avec bienveillance. Une exclu Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.
ENTRETIEN EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU
Q. : 05/09/17 ; R. : 02/01/18.
Jean-Vincent Holeindre: « La ruse est impuissante
sans la force, la force aveugle sans la ruse. »

La ruse et la force, Perrin, 2017.
Jean-Vincent Holeindre bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à mes questions pour Paroles d’Actu. Voulez-vous pour commencer nous dire quelques mots de vous, de votre parcours ?
qui êtes-vous ?
J’ai suivi des études en histoire, philosophie et science politique à la Sorbonne puis à l’École des hautes études en science sociales. Ce parcours pluridisciplinaire s’est achevé par une thèse de doctorat, soutenue en 2010 sous la direction de Pierre Manent, intitulé Le renard et le lion : La ruse et la force dans le discours de la guerre. Cette thèse est devenue, au terme de substantielles modifications, un livre paru en 2017 et intitulé La ruse et la force : Une autre histoire de la stratégie. Après ma thèse, sur le plan professionnel, je suis devenu maître de conférences en science politique à l’Université Paris 2 Panthéon Assas puis professeur à l’Université de Poitiers, à la suite de l’agrégation. En 2017, j’ai retrouvé l’Université Paris 2, tout en continuant à enseigner à l’EHESS et à Sciences Po.

Jean-Vincent Holeindre. DR.
Si je devais indiquer le fil directeur de mes recherches, je dirais que je considère le phénomène guerrier avec les yeux de la philosophie politique et avec le souci de lui restituer toute sa profondeur historique. J’aime l’histoire sur la longue durée et j’apprécie tout particulièrement la période antique. Non parce qu’elle reflèterait nos « origines », mais parce qu’elle offre un cadre de compréhension, à la fois philosophique et historique, de l’expérience occidentale et des relations que « l’Occident » noue avec les autres « cultures ». Je considère également que la guerre est un phénomène total, qui embrasse tous les domaines de l’action humaine. J’étudie l’action militaire non pour elle-même mais pour ce qu’elle révèle sur le plan politique et anthropologique.
L’objet qui, pour l’essentiel, nous réunit aujourd’hui, c’est donc votre ouvrage La ruse et la force (Perrin, 2017), fruit d’une étude sur le temps long visant à déterminer où s’est situé le curseur entre la force et la ruse dans la pratique militaire et la pensée stratégique, à différentes époques de l’histoire occidentale. Deux figures légendaires, issues de la Grèce antique, des épopées homériques, comme fil rouge tout au long de votre livre : Achille (L’Iliade) incarne la force et Ulysse (L’Odyssée) la ruse. Pourquoi cet objet d’étude ? Cet angle-là, mettant en avant et en balance l’apport de la ruse par rapport à la force dans la stratégie, a-t-il été négligé jusqu’à présent, au moins en Occident ? Si oui, la ruse en tant qu’objet de réflexion a-t-elle reçu un traitement différent en d’autres lieux ?
pourquoi ce livre ?
Au départ, ce n’est pas la guerre qui m’intéresse, mais la ruse comme forme d’intelligence pratique que les Anciens Grecs nomment mètis. Le mot désigne à la fois l’épouse de Zeus, divinité de l’intelligence rusée, et une qualité de l’esprit humain, combinant flair, sens de l’adaptation, art du détour, débrouillardise...
« Plus qu’une intelligence théorique, la ruse
est d’abord une intelligence de l’action. »
L’impulsion première de mes recherches a été donnée par le livre magnifique de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, consacré à cette catégorie de la mètis (Les ruses de l’intelligence : La mètis des Grecs, Flammarion, 1974). Detienne et Vernant montrent que la ruse n’est pas une intelligence théorique, mais une intelligence de l’action, particulièrement adaptée aux domaines politique et militaire, frappés du sceau de l’incertitude. En politique et à la guerre, la ruse n’est pas seulement tromperie ou mensonge, ce à quoi on la réduit trop souvent. Elle est aussi invention, imagination, elle suppose un véritable sens de l’anticipation, de la prévision mais aussi de l’adaptation, qualités que l’on trouve chez Ulysse lorsque, dans les épopées d’Homère, il imagine le stratagème du cheval de Troie ou bien lorsqu’il crève l’œil du Cyclope avec un pieu, profitant de son sommeil. À travers ces exemples, la ruse peut, en première analyse, être définie comme un procédé combinant dissimulation et tromperie dans le but de provoquer la surprise. Mais elle constitue également une forme d’intelligence, elle exprime la capacité cognitive de l’esprit humain dans des situations d’action.

Les ruses de l’intelligence : La mètis des Grecs, Flammarion, 1974.
J’ai été d’emblée fasciné par ce sujet qui met en lumière la tension classique entre la théorie et la pratique, l’idée et l’action. L’intention de mon travail est donc d’abord philosophique, mais cela suppose un travail généalogique visant à comprendre pourquoi la ruse a été en quelque sorte l’oubliée de l’histoire politique et militaire. Pour le sens commun, la ruse est bien sûr indispensable en politique et à la guerre, pourtant aucune étude sérieuse ne lui a été consacrée. C’est surprenant, mais cela s’explique probablement par le caractère fuyant d’une notion qui, par définition, a vocation à demeurer dans l’ombre et le secret. La ruse est la part oubliée de la raison humaine.
J’ai choisi d’étudier la ruse dans la guerre, car elle est bien circonscrite sur le plan militaire, à la différence de la ruse spécifiquement politique qui est très difficile à saisir. En effet, les exemples de ruse de guerre dans l’histoire ne manquent pas, du Cheval de Troie mythique à l’opération Fortitude durant la 2e guerre mondiale, où les Britanniques ont fait croire aux Allemands que le Débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, afin de détourner leur attention et de les surprendre en Normandie. De plus, la ruse de guerre a été pensée par les stratèges depuis Thucydide jusqu’à Clausewitz. Je pouvais donc m’appuyer pour mon enquête sur des exemples bien documentés et sur une littérature militaire bien balisée.
« La ruse, c’est aussi un stigmate qu’on appose
sur l’ennemi pour le discréditer, et par
contraste, légitimer sa propre stratégie. »
Enfin, pour répondre à la dernière partie de votre question, j’ai cherché dans mes travaux à déconstruire un poncif de l’historiographie occidentale, consistant à opposer la « force » des Occidentaux à la ruse « perfide » des étrangers et en particulier des Orientaux. Je pense avoir montré que l’opposition entre ruse et force ne relève pas seulement d’une dialectique stratégique, mais aussi d’une rhétorique moralisante visant à souligner la ruse de l’ennemi pour mieux glorifier sa propre force. D’où l’image de l’Oriental « fourbe » doté de moustaches dissimulant ses intentions perfides… La ruse n’est pas seulement un procédé tactique et une forme d’intelligence stratégique, c’est aussi un stigmate qu’on appose sur l’ennemi pour le discréditer et, par contraste, légitimer sa propre stratégie.
N’est-on pas conditionnés justement, en Occident notamment, par le jugement moral porté sur la ruse qui serait nécessairement une perfidie ? Après tout, une des ruses les plus célèbres du récit collectif, et qu’on trouve aux origines de la Bible, c’est la ruse du serpent qui, après avoir poussé Ève à croquer le fruit défendu, provoque l’expulsion de l’Homme du jardin d’Eden. Est-ce que le religieux et son moralisme ont joué un rôle déterminant dans notre manière d’appréhender la ruse (fort éloignée dans l’idée de ce qu’on rattache à la « vertu chevaleresque ») ?
la ruse et la religion
Je ne parlerais pas de « conditionnement », ce terme me paraissant trop déterministe. Mais il existe en effet un cadre moral et normatif du christianisme qui oriente le jugement et l’action. Le chevalier médiéval, « sans peur et sans reproche », est la continuation de l’idéal antique incarné par Achille, le guerrier valeureux, honorable, courageux, auquel se greffent les vertus morales du christianisme. Le rejet de la ruse en Occident est antérieur au christianisme, mais celui-ci amplifie ce rejet. Cela dit, il faut faire la part des choses entre l’idéal moral et la réalité des pratiques. Les guerres médiévales, en particulier les sièges, comportaient de nombreuses ruses, malgré les restrictions morales et normatives.
Dans les Évangiles, la ruse est effectivement associée aux forces du Mal, aux tentations de Satan qui séduit les hommes, par définition faillibles. Le christianisme antique se revendique pacifiste, la guerre étant la manifestation du Mal au cœur de l’âme humaine, exprimant un affrontement intérieur entre le Bien et le Mal. Les vertus chrétiennes exposées dans le Nouveau Testament sont celles de la paix, de la charité, de l’amour du prochain et de l’hospitalité vis-à-vis de l’étranger, mais aussi de la franchise, de la simplicité, de l’esprit de concorde. Surtout, la proposition chrétienne est universaliste, elle s’adresse à l’ensemble de l’humanité considérée comme une communauté unifiée.
« Il faut sur ce point distinguer, aux origines,
la religion des Hébreux, qui est politique
et peut donc recourir à la guerre, et celle
des chrétiens, qui s’est construite
contre la politique et la guerre. »
Sur ce point, la Bible hébraïque se distingue du Nouveau Testament des chrétiens. Si les chrétiens se définissent en fonction de leur foi et non de l’appartenance à une cité particulière, les Hébreux se pensent comme un peuple spécifique et comme une nation qui peut être amenée à faire la guerre pour se défendre. Soutenus, conseillés et dirigés par Dieu, qui se mue en véritable stratège, les Hébreux décrits par la Bible hébraïque font la guerre pour conquérir la terre promise de Canaan. Dans le Livre de Josué, ils usent de force et de ruse pour vaincre des ennemis numériquement et matériellement supérieurs. D’une manière générale, la religion des Hébreux est indissociablement spirituelle et politique, tandis que l’Église chrétienne s’est construite contre la politique et la guerre, en défendant une vision universelle et pacifiée de l’humanité.
La morale chrétienne connaît toutefois des évolutions. Ainsi, les théoriciens chrétiens de la guerre juste, depuis saint Augustin, intègrent l’usage de la ruse dans la guerre. Ils s’appuient sur l’héritage hébraïque et romain pour encadrer l’usage de la force armée, et acceptent jusqu’à un certain point que le soldat chrétien use de ruse, mais uniquement en temps de guerre. La ruse est réprouvée en temps de paix, mais elle peut être acceptée si la guerre est considérée comme juste.
Les concepts de fides (induisant notamment un code d’honneur, y compris entre ennemis) et de guerre juste (qui suppose une juste cause cantonnant la perfidie à la pratique ennemie et une justification morale à pratiquer soi-même la ruse) nous proviennent tous deux de la Rome antique. Doit-on aux Romains une partie importante de ce qui a été établi ensuite comme les usages et le droit de la guerre ?
Rome et l’art de la guerre
Effectivement, l’expérience romaine est fondamentale pour comprendre l’éthique et le droit de la guerre applicables dans l’aire occidentale. La doctrine de la guerre juste naît au IIe siècle avant notre ère, lorsque les Romains affrontent les troupes d’Hannibal durant la 2e guerre punique. Ils sont alors soucieux de justifier l’usage de la force contre un ennemi redoutable et qui menace l’intégrité de Rome. Les sources font ainsi apparaître un mouvement en apparence paradoxal.
D’un côté, Polybe et plus tard Tite-Live indiquent que la ruse n’a rien de romain, que les Romains sont les héritiers d’Achille, qu’ils mènent la guerre de manière « juste », en suivant des règles de l’honneur et du courage impliquant de combattre l’ennemi en face-à-face et sans ruse. La « fides romana » désigne cette supériorité morale supposée, qui s’exprime dans la guerre à travers un comportement exemplaire. Les sources dénoncent en retour la « perfidie » des ennemis de Rome, par exemple le carthaginois Hannibal, qui attaque par derrière et par surprise. À la force vertueuse des Romains est opposée la ruse perfide des « Puniques », le terme « punique » étant d’ailleurs péjoratif et connotant la fourberie. Comme souvent, l’accusation de perfidie est moins descriptive que normative : elle vise à discréditer l’ennemi et à légitimer son propre camp.
« Les Romains ont fait montre d’une forte
capacité d’adaptation en faisant leur la ruse,
auparavant vilipendée comme l’arme lâche
des autres, mettant en avant leur "contre-ruse"
face à la perfidie de l’ennemi. »
D’un autre côté, les sources latines font apparaître le sens de l’adaptation romaine, qu’on voit par exemple chez Scipion l’Africain, qui l’emporte contre Hannibal après avoir retourné contre l’ennemi carthaginois ses propres armes (d’où le surnom dont il est affublé). La contre-ruse romaine vient ainsi à bout de la « perfidie » punique.
Tout se passe donc comme si la « bonne » ruse romaine l’emportait contre la « mauvaise » ruse punique. Les Romains gagnent ainsi sur les deux tableaux : celui de l’efficacité et celui de la légitimité. Ils remportent les guerres, conquièrent de nouveaux territoires, tout en préservant l’idéal moral de la « fides ». Ils combinent les intérêts et les vertus. Cette capacité romaine à lier efficacité et légitimité fascine Machiavel, lequel s’inspire de l’expérience romaine pour forger sa vision de la politique et de la guerre.
Peut-on dire de Rome qu’elle s’est-elle imposée en tant que puissance européenne et méditerranéenne dominante aussi bien par la force (son organisation et sa puissance militaires, ses conquêtes) que par la ruse (la diffusion de sa culture et de son mode de vie) ? Cette question en appelle une autre : le « soft power » est-il assimilable à une ruse, ou bien est-il une façon rusée d’affirmer sa force ?
quid du "soft power" ?
La ruse, telle que je l’étudie dans le livre, ressortit à la guerre, tandis que le soft power relève davantage d’une « grande stratégie » qui intègre des éléments non militaires à des fins de puissance. De plus, la ruse est d’abord un procédé tactique combinant dissimulation et tromperie afin de provoquer la surprise, tandis que le soft power désigne plus largement une stratégie d’attraction (par opposition au hard power, qui repose sur la coercition).
Toutefois, le soft power peut intégrer une forme de ruse dans la manière de diffuser la puissance de manière subtile, indirecte, non coercitive. Ce qui est commun à la ruse et au soft power, ce n’est donc pas la nature du procédé, mais le caractère indirect de la stratégie mise en œuvre. La ruse, qu’elle soit militaire ou non, agit par le détour et en évitant le face-à-face, tandis que le soft power opère par l’influence plutôt que par la contrainte.
« Rome a su étendre sa puissance par
la guerre, en combinant la ruse et la force,
mais aussi par une diplomatie d’influence
qui s’apparente au "soft power". »
Dans le cas de Rome, on peut dire qu’elle a su étendre sa puissance par la guerre, en combinant la force et la ruse, mais aussi par une diplomatie d’influence, qui s’apparente au soft power, en rendant son système politique et culturel attirant pour les autres. La forme impériale romaine fut à la fois une vague militaire et un aimant diplomatique. L’attractivité de Rome ne se réduit pas à la projection habile de son modèle. Elle tient aussi à sa capacité d’intégration des influences extérieures, comme ce fut le cas avec la religion chrétienne. Les Romains étaient convaincus de la supériorité de leur système politique, ce qui les conduisait à accepter sur la durée les éléments étrangers.
La tactique dite de la « terre brûlée » (certains épisodes de la Guerre de Cent ans au 14ème siècle, de la bataille de la Moskowa en 1812, de la seconde Guerre sino-japonaise entre 1937 et 1945, de la "Grande Guerre patriotique" entre 1941 et 1945) est-elle la mère de toutes les ruses/perfidies ? L’utilisation de l’un ou de l’autre terme tient-elle au caractère défensif ou offensif du conflit en question ou bien est-ce plus subtil, plus nuancé que cela ?
la "terre brûlée", une ruse ?
La tactique de la « terre brûlée » vise à rendre un espace inhabitable en le détruisant par le feu, cela afin d’affaiblir l’ennemi et l’empêcher de combattre. On n’est donc pas dans le registre de la ruse, mais dans un procédé tactique destiné à venir à bout de l’ennemi sans avoir à l’affronter. L’objectif tactique de la ruse et de la terre brulée est cependant le même : il s’agit de l’emporter sans prendre de risques inconsidérés. Ce qui est commun à ces deux tactiques, c’est le principe d’économie des forces et, jusqu’à un certain point, le principe stratégique de la surprise.
Lorsque l’officier et théoricien militaire prussien Clausewitz apparaît sur la scène, les Lumières humanistes ont vécu. L’Europe sort tout juste des guerres napoléoniennes, guerres massives qui opposent de moins en moins des professionnels de la guerre et de plus en plus des bataillons populaires. Lui va à rebours de la tendance de son temps et met en avant dans la pensée stratégique la prédominance de la force, obtenue par un usage habile et une concentration de forces humaines et technologiques, reconnaissant néanmoins que la ruse garde sa pertinence, notamment pour le belligérant plus faible en cas de déséquilibre des forces. Quelle influence sa pensée a-t-elle eu sur les guerres de la fin du 19è et de la première moitié du 20è siècle ?
Clausewitz et la pensée stratégique
L’influence de Clausewitz est considérable. Mon intention n’est certainement pas de la minorer ou de réduire les mérites du stratège prussien sur le plan théorique. Je suis par exemple convaincu de la pertinence de sa triple définition de la guerre, considérée comme un phénomène social, militaire et politique.
« Clausewitz a eu une approche
un peu réductrice de la ruse. »
Cependant, j’estime que son approche de la ruse est réductrice. Clausewitz considère que la ruse peut être utile sur le plan tactique, mais qu’elle n’a pas de portée stratégique. Pour lui, dans les guerres de masse, il n’est pas possible de surprendre l’ennemi, eu égard au nombre des troupes engagées. Or, dans les guerres du 20e siècle, la ruse a été employée aussi bien au niveau tactique que stratégique. Durant l’opération Fortitude, les Alliés ont intoxiqué l’état-major allemand et ont mis en place une opération d’envergure qui dépasse le niveau strictement tactique. En réalité, les innovations technologiques, comme la radio, l’aviation ou les techniques de camouflage, ont conféré une « deuxième jeunesse » à la ruse de guerre, en offrant de nouvelles possibilités en matière de manipulation des perceptions. Il est possible d’intoxiquer l’ennemi à grande échelle. Je dirais même que les stratégies d’intoxication, dans les conflits contemporains, n’ont jamais été aussi décisives. Dans un contexte où la force est très contrainte sur le plan politique, juridique, économique, le rôle des perceptions n’a jamais été aussi fort.

Carl von Clausewitz.
Dans le chapitre justement que vous consacrez aux « renards du déserts » des deux guerres mondiales, vous mettez notamment en lumière différentes opérations d’intoxication de l’ennemi, qui souvent ont d’abord été initiées par des gens de terrain avant de devenir de véritables politiques impulsées au niveau central (ce fut le cas du Royaume-Uni de Churchill notamment). On pense évidemment à l’opération Fortitude... Les opérations d’intoxication et de sabotage qui eurent cours au cours de la seconde Guerre mondiale ont-elles eu un impact déterminant en vue de la victoire finale ? L’Allemagne nazie a-t-elle recouru à de tels procédés ou bien a-t-elle tenté de le faire ?
intox et guerre mondiale
La ruse, sous la forme des opérations d’intoxication, a joué un rôle considérable dans le déroulement des deux guerres mondiales et en particulier de la Seconde. C’est durant la première Guerre mondiale que s’invente le camouflage au sens moderne. Avant la Grande Guerre, les troupes revêtaient l’uniforme pour être vues et distinguées de la population ; au cours du premier conflit mondial, les uniformes se veulent de plus en plus discrets, pour éviter d’être touchés par l’ennemi mais aussi pour l’atteindre sans qu’il puisse visualiser l’attaque. Ce principe de dissimulation et de surprise est certes vieux comme la guerre, mais les évolutions du camouflage dans les guerres modernes mettent bien en évidence la part croissante prise par la ruse dans les stratégies, les Britanniques étant de ce point de vue les plus en pointe parmi les Alliés.
« Auparavant l’œuvre individuelle du stratège,
la ruse devient à partir des guerres du 20e siècle
un travail collectif. »
De manière générale, on observe au cours des deux guerres mondiales une véritable institutionnalisation de la ruse. Des services dédiés, comme la Force A, sont créés sous l’impulsion de Churchill dans le but de coordonner les opérations d’intoxication contre les Allemands. Jusqu’au 20e siècle, la ruse était surtout l’œuvre individuelle du stratège, elle devient à présent un travail collectif. Ces « forces spéciales » agissent en petit nombre et dans l’ombre pour que le secret des opérations ne soit pas éventé.
De leur côté, les Allemands ont également utilisé ce type d’intoxication, notamment contre les Soviétiques lors de l’opération Barbarossa en 1941 où les Allemands ont rompu par surprise le pacte de non-agression. Mais les Soviétiques ne sont pas en reste, qui ont intégré depuis les années 20 la notion de maskirovka, qui désigne à la fois le camouflage, la ruse, la surprise… La ruse est donc un élément central du calcul tactique et stratégique durant les deux guerres mondiales, l’enjeu étant d’économiser les forces et d’atteindre moralement l’ennemi.
La propagande, largement facilitée par le développement massif des moyens de communication modernes, est-elle la première des ruses à cibler véritablement des populations en tant que telles ?
la place de la propagande
Les conflits contemporains impliquent de plus en plus les populations civiles, qu’on essaie d’influencer et de manipuler par la propagande afin d’infléchir le résultat de la guerre. Les médias de masse, comme la radio, la télévision et aujourd’hui internet jouent à ce titre un rôle décisif. Comme l’avait bien vu le Britannique Liddell Hart, la stratégie étend son domaine d’action à des domaines non militaires. Les médias occupent une place éminente dans les conflits contemporains, les images et les perceptions étant parties prenantes du conflit.
« La propagande opérée à destination
de l’ennemi, notamment l’intoxication,
s’inscrit dans le registre de la ruse. »
La propagande n’est pas en soi une ruse, dès lors qu’elle consiste à diffuser un message à ses propres populations pour les galvaniser, les rassurer ou encore détourner leur attention. En revanche, la propagande opérée à destination de l’ennemi, notamment l’intoxication, s’inscrit dans le registre de la ruse au sens où il s’agit de dissimuler ses intentions et de tromper l’ennemi en vue de le surprendre. Mon propos se focalise sur les ruses mobilisées entre des ennemis exprimant mutuellement des intentions hostiles, non par sur les ruses organisées par le pouvoir politique pour contrôler les populations.
L’essor durant la période de la guerre froide de la figure de l’espion, amplement popularisée à partir des années 60 par le personnage de James Bond, est-il le signe d’une prise en compte nouvelle par les États de l’importance de la ruse dans leur conduite des affaires extérieures ? Quid, plus récemment encore, du hacking d’État ?
Durant la guerre froide, l’espion joue un rôle d’autant plus important que le conflit armé entre les deux superpuissances, États-Unis et Union soviétique, est contenu militairement par la présence de l’arme nucléaire. Le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945 par les Américains a fait apparaître la dangerosité et la létalité de la bombe. Une fois que les deux « Grands » obtiennent la maîtrise de cette technologie, ceux-ci s’orientent vers des stratégies de dissuasion, c’est-à-dire de non-emploi de la bombe. Mais « l’équilibre de la terreur » n’est possible qu’au prix d’une action prolongée des services de renseignement. Il s’agit pour les États-Unis et l’URSS de s’assurer, par l’espionnage, que l’ennemi ne cherche pas à utiliser la bombe. Il s’agit également de le déstabiliser autrement que sur le champ de bataille. Ce sont les services de renseignement (français) qui ont identifié la présence de missiles atomiques à Cuba en 1962, ce qui a débouché sur la crise la plus grave de la guerre froide. Dans un contexte où l’usage de la force est rendu quasi-impossible au regard des conséquences que cela engendrerait, la ruse de l’espion occupe donc une place significative de l’espace stratégique.
« Les travaux du regretté Nicolas Auray
ont bien montré la convergence entre
le hacking et la mètis grecque. »
Aujourd’hui, la ruse peut prendre les formes du cyber, à travers les attaques informatiques menées par des « chevaux de Troie » modernes. Il est frappant d’observer qu’on emploie un vocabulaire guerrier pour désigner ces attaques contre les systèmes d’information des entreprises, des États ou des partis politiques. La figure du hacker, qu’elle soit étatique ou non, relève de la ruse au sens où le pirate informatique use de son intelligence ingénieuse pour se dissimuler et pénétrer dans les systèmes d’information. Il repère les failles du système et les utilise à son profit. Les travaux du regretté Nicolas Auray ont bien montré cette convergence entre le hacking et la mètis grecque.

Nicolas Auray, sociologue du numérique (1969-2015). DR.
L’affaissement ayant conduit à l’effondrement de l’URSS est-il dû, en partie, à des manœuvres de ruse de la part des Américains ? Je pense notamment au projet de défense anti-missile IDS dit « Star Wars » dans les années 80, irréalisable pour l’époque mais donc certains disent qu’il avait vocation à entraîner l’Union soviétique dans une ultime course aux armements qui l’auraient mise à genoux ? De manière plus générale : est-ce qu’on a des exemples d’empires ou de constructions politiques importantes qui se sont effondrés ou ont été minés à la suite d’un assaut de ruse ?
la ruse et la chute de l’URSS
Le projet de « guerre des étoiles », lancé par Ronald Reagan au début des années 80, avait vocation à souligner les faiblesses soviétiques, sur le plan technologique et économique, sachant que l’URSS n’avait pas su prendre le tournant informatique. On est clairement dans un conflit non-militaire, qui repose sur la perception plus ou moins faussée des capacités militaires, technologiques, économiques de l’adversaire. Dès le début, la guerre froide prend cette dimension à travers la conquête de l’espace et la quête de l’arme nucléaire… La ruse intervient dans le conflit, mais il s’agit d’un affrontement psychologique plus large, où le vaincu est d’abord celui qui se perçoit comme vaincu.
« L’affaire dite Farewell, d’intoxication massive envers
les Soviétiques, a contribué à l’affaiblissement de
l’URSS, qui allait conduire à son implosion. »
Pendant longtemps, les Soviétiques ont compensé leur déficit technologique par l’espionnage industriel. Mais au début des années 80, grâce aux renseignements fournis par les services secrets français (la fameuse affaire Farewell immortalisée au cinéma), le renseignement américain met en place une opération d’intoxication consistant à diffuser de fausses informations aux Soviétiques, quant aux puces informatiques par exemple. Cette opération a affaibli l’URSS et s’est ajoutée aux failles internes qui ont conduit à son implosion sur le plan politique et social.
De manière générale, pour répondre à la deuxième partie de votre question, je ne dirai pas que la ruse, à elle seule, peut faire s’effondrer des États ou des empires. Tout mon propos est de montrer que la ruse est impuissante sans la force et que la force est aveugle sans la ruse. Ruse et force constituent deux données essentielles de la grammaire stratégique.
Alors que cette époque de la guerre froide avait quelque chose de prévisible, de gérable, l’ère actuelle, tristement marquée par le terrorisme globalisé, est celle des conflits asymétriques, où l’ennemi est invisible et la menace diffuse. On essaie au maximum de répondre à la ruse par la ruse, voyant que la force pure est ici parfois inopérante. Comment nos élites stratégiques et militaires sont-elles formées à ces paramètres nouveaux ? Le sont-elles de manière satisfaisante à vos yeux ?
face à la menace terroriste
Attention à l’illusion rétrospective ! Je ne dirai pas que la guerre froide avait quelque chose de plus « gérable » et « prévisible » que le terrorisme djihadiste actuel. Je ne dirai pas non plus que la guerre froide était plus lisible, même si les belligérants étaient nettement caractérisés sur le plan institutionnel et politique.
La menace nucléaire faisait peser une grande incertitude sur les relations internationales, et les risques engendrés par l’usage de la bombe étaient bien plus grands que les conséquences supposées du terrorisme djihadiste. Mais il est toujours plus facile de dire que le monde était autrefois plus compréhensible, voire moins dangereux. Cela fait partie d’une rhétorique qu’on trouve à tous les niveaux de la société et qui est souvent un alibi pour ne pas penser précisément, et regarder en face, les menaces qui nous touchent réellement.
« Dans le cadre du terrorisme, l’attentat est une ruse
du faible, utilisée par nécessité et non par choix,
pour compenser un déficit de force. »
Dans le cadre du terrorisme, on a affaire à une ruse du faible, qui est utilisée par nécessité et non par choix. Les groupes djihadistes vont recourir à la ruse pour compenser leur déficit de force. Le problème des États, notamment occidentaux, réside dans la persistance de sentiments contrastés, à la fois toute-puissance et vulnérabilité. Les responsables politiques ont souvent tendance à sous-estimer le risque terroriste quand celui-ci se profile et à surestimer la menace lorsqu’elle devient réalité.
Par exemple, les États-Unis ont eu beaucoup de mal à prévoir les attentats du 11 septembre, y compris sur le plan du renseignement, d’abord parce qu’ils ne pouvaient pas imaginer que les principaux symboles de leur puissance politique (Maison blanche), militaire (Pentagone), économique (World Trade Center) allaient être touchés. Pourtant, la CIA disposait de professionnels très compétents, de moyens technologiques supérieurs et d’informations sérieuses et recoupées. Mais on peut faire l’hypothèse que les États-Unis, à l’image du Pharaon égyptien contre les Hébreux, sont partis du principe qu’ils étaient invulnérables et qu’une telle attaque était inconcevable. Le risque d’attaque massive de type terroriste a donc été sous-estimé.
Mais d’autre part, à la suite de ces attentats qui ont constitué un énorme traumatisme, le pouvoir politique américain a pratiqué une forme de surenchère sécuritaire et belliqueuse, déclarant « la guerre au terrorisme » globalisé, alors même qu’on ne déclare pas la guerre à un mode d’action, mais à un ennemi au sens politique. Du même coup, les États-Unis ont donné une importance disproportionnée à la menace terroriste, ce qui n’a sans doute pas aidé à la résorption du problème.
« Double travers, détecté en France comme aux
États-Unis : sous-estimation du risque induit
par le terrorisme en amont, et surréaction
"belliciste", souvent contre-productive, en aval. »
On aurait tort toutefois de considérer qu’en Europe et notamment en France, nous sommes épargnés par ces erreurs d’appréciation. Au contraire, les attentats de 2015 et 2016, à Paris et à Nice, ont fait apparaître le même type de réaction des autorités politiques : d’un côté, sous-estimation du risque induit par le terrorisme et, de l’autre côté, surestimation de la menace par une réaction « belliciste » disproportionnée.
S’agissant de la formation des élites à la stratégie militaire, je dirais qu’elle est souhaitable et même essentielle au regard de ce que je viens de décrire, car elle permet d’injecter du rationalisme dans un univers dominé par la panique morale et les perceptions faussées. Je ne dis pas qu’il ne faut pas tenir compte des émotions, mais celles-ci doivent être dominées par la raison politique, quitte à ce que les émotions constituent un ressort de l’action politique elle-même. Les terroristes y parviennent, pourquoi pas nous ?
Pour quelles manifestations historiques de ruse avez-vous la plus grande admiration ? Quels-sont à l’inverse les actes de « perfidie » qui pour vous ne méritent que mépris ?
perfide en guerre
Je dois dire que je ne me suis jamais posé la question ! Évidemment, j’ai une tendresse spontanée pour le Cheval de Troie, mais c’est un sentiment « littéraire » pour un épisode mythologique. Je suis également impressionné par les ruses de Thémistocle à Salamine ou celles d’Hannibal contre les Romains… Mais mon travail n’a pas vocation à compter les bons et les mauvais points. Je m’efforce de sonder l’âme humaine à travers le phénomène guerrier.
« La perfidie en temps de guerre, c’est d’après
la définition actuelle le fait de briser la distinction
entre combattants et non-combattants. »
Quant à la perfidie, je m’en tiendrai à la définition juridique actuelle en droit des conflits armés : elle consiste en une atteinte à la bonne foi élémentaire dans la guerre, brisant la distinction entre combattants et non-combattants. Par exemple, la perfidie est caractérisée lorsque des militaires revêtent les habits humanitaires pour attaquer l’ennemi. Ces actes-là ne relèvent pas de la ruse de guerre licite, mais de la perfidie prohibée au sens où ils ruinent la confiance qu’on maintient, en dépit de l’état de guerre, à l’égard des travailleurs humanitaires. Ces actes, qui ne sont en rien admirables, hypothèquent les chances de la paix.
Le fameux penseur florentin Machiavel, central dans votre ouvrage, avait en son temps (celui de la Renaissance) révolutionné la philosophie politique, apportant notamment dans la réflexion le fait de « politiser la guerre » et de « belliciser la politique ». Où est la force, et où est la ruse, dans l’exercice de la politique interne dans nos démocraties ? La maîtrise de la rhétorique constitue-t-elle un élément déterminant dans l’escarcelle de celui qui, dans ce milieu, entend « ruser » ?
Machiavel, et l’art du politique rusé
Machiavel considère que les qualités du chef de guerre (patience, sang froid, audace…) prévalent dans le domaine politique. La guerre est le modèle d’action à partir duquel Machiavel forge sa vision de la politique. Le gouvernant, tel que Machiavel le décrit, est un stratège qui transpose son savoir-faire militaire dans le domaine politique et qui fait de la guerre la question politique par excellence. C’est ainsi que Machiavel politise la guerre d’un côté et « bellicise » la politique de l’autre. La transgression machiavélienne réside dans ce double mouvement qui rompt avec les perspectives chrétienne et humaniste.
Dans la philosophie politique, héritée de Platon et d’Aristote, le temps ordinaire de la politique est séparé du temps extraordinaire de la guerre. La politique se déroule dans les murs de la cité tandis que la guerre a lieu, dans l’idéal, sur une plaine dégagée à l’écart de la cité. De plus, la science politique grecque, comme le montre Pierre Manent, est une science de la cité, alors que la science politique de Machiavel est tout entière contenue dans l’art de conquérir et de conserver le pouvoir. Pour Machiavel, la question du régime politique, monarchie ou démocratie, importe peu également, tandis que c’est un point central pour Platon et Aristote. En outre, Machiavel renverse la hiérarchie entre l’intérieur et l’extérieur ; pour Platon et Aristote, la politique intérieure l’emporte sur l’action extérieure. C’est l’inverse qui est vrai pour Machiavel, une communauté politique incapable de se défendre militairement des agressions extérieures n’étant pas viable. Enfin, le monde de Machiavel est hostile. Il se caractérise par l’instabilité, la fragilité des situations, l’instabilité de l’âme humaine, le hasard et l’aléa, autant de réalités qu’on ne peut conjurer, tandis que le monde de Platon et Aristote est ordonné par le régime politique.
Dans ce contexte, dit Machiavel au chapitre XVIII du Prince, il faut savoir être lion pour effrayer les loups et renard pour éviter les pièges. Force et ruse sont à la fois les deux qualités du stratège et du gouvernant. Machiavel ne dit pas qu’il faut être rusé en toute occasion. Il estime que le prince ne peut avoir toutes les qualités humaines, mais qu’il doit paraître les avoir. La ruse n’est pas seulement un procédé trompeur, mais une forme d’intelligence qui permet au prince de « colorer sa nature ». Machiavel renoue ici avec le sens antique de la mètis, tout en affirmant la continuité de la guerre et de la politique. Il n’est pas loin d’inverser la formule de Clausewitz (la guerre comme continuation de la politique) avant l’heure. Machiavel est le dernier des Anciens et le premier des Modernes.
« Hors les caricatures, on peut dire que, pour
Machiavel, le bon politique est celui qui sait
composer avec les "humeurs" du peuple. »
Dans le contexte démocratique, marqué par la volatilité et la pluralité des opinions, les qualités identifiées par Machiavel sont très utiles au gouvernant. Elles lui permettent de se montrer sous un visage différent selon les situations, en utilisant la parole bien sûr mais aussi les apparences, les images, les perceptions, les émotions. Il convient cependant de ne pas réduire Machiavel au machiavélisme, au sens d’un cynisme qui consisterait à mépriser le peuple et à le manipuler. Au contraire, Machiavel est plutôt du côté de la République et de la démocratie. Il estime que les gouvernants comme les peuples ont leurs « humeurs » et, comme l’a montré Claude Lefort, Machiavel interprète la politique à partir de la variable du conflit. L’art de gouverner, c’est l’art de dominer les conflits, de les apaiser, de rendre justice autant que possible à chacune des parties et de trancher dans le vif lorsqu’un compromis est impossible. Pour Machiavel, il n’y a rien de pire que la voie moyenne. La politique ne suppose pas de donner à tout le monde mais de décider. Cependant, toute décision arbitraire déclencherait le courroux du peuple, ce qui serait le pire des choix.

Niccolò Machiavelli.
L’actualité internationale est dominée par les inquiétudes autour de l’affaire nucléaire nord-coréenne, et sur ce sujet la surenchère verbale et de menaces à laquelle se livrent Kim Jong-un et Donald Trump n’est pas pour rassurer... Ce qui inquiète aussi, c’est la personnalité de l’un et de l’autre, qui passent pour impulsifs et imprévisibles. Est-ce qu’on est là à votre avis en présence de part et d’autre d’une ruse, de postures rappelant celle de l’ « homme fou" dont parlait Kissinger à propos de Nixon ?
Trump, Kim, jeux de ruse ?
La meilleure manière de dissimuler sa ruse, et ainsi de ne pas attirer l’attention des éventuels concurrents, est de se faire passer pour bête ou pour fou. Bien sûr, simuler la folie est un jeu dangereux auquel on peut se prendre, mais après tout, Machiavel, dans un chapitre des Discours consacré à l’attitude de Brutus avant l’assassinat de César, montre « combien il peut être sage de feindre pour un temps la folie ». Je dirai donc qu’avec Trump et Kim Jong-un, il ne faut pas s’arrêter aux apparences et à leur personnalité impulsive, imprévisible voire pathologique, ne serait-ce que par prudence.
« Trump est d’autant plus dangereux que son
comportement politique est faussement
simple, et qu’il n’est pas dénué de ruse... »
Dans le cas de Trump, il est clair qu’il a été sous-estimé par l’état major républicain et par les commentateurs autorisés, qui ont mis beaucoup de temps à prendre au sérieux l’hypothèse de son élection, le problème étant que tous ont été aveuglés par l’image médiatique qu’il renvoyait. Trump l’a emporté d’autant plus facilement qu’il n’a pas été jugé à sa juste valeur. N’oublions pas qu’il a été choisi par les électeurs républicains dans l’élection primaire, puis par les Américains au niveau national. On peut bien sûr le regretter, refaire l’élection, souligner les faiblesses de sa concurrente Hillary Clinton, mettre la victoire de Trump sur le compte d’un concours de circonstances… Mais on a eu tort, et on aurait tort à nouveau, de négliger son habileté politique. À mes yeux, le personnage est d’autant plus dangereux que son comportement politique est faussement simple, et qu’il n’est pas dénué de ruse, qualité utile dans le monde des affaires dont il est issu.
« La stratégie de Kim est plus prévisible que celle
de Trump, puisque le dictateur nord-coréen est
un pur produit du système dont il est issu. »
Le cas de la Corée du Nord est différent puisqu’on a affaire à un régime totalitaire et héréditaire. Kim Jong-un est au pouvoir parce qu’il est le fils de son père, mais cela n’exclut pas d’être intelligent et malin. Cela dit, il ne faut pas tomber dans l’excès inverse : la grossièreté du personnage n’est pas forcément un gage d’intelligence. Kim est d’abord le produit d’un régime nord-coréen qui, comme tout régime totalitaire, est fondé sur la terreur et l’intoxication. La ruse, au sens tactique de la dissimulation et de la tromperie, constitue une donnée intrinsèque du système politique et non une œuvre individuelle. En ce sens, la stratégie de Kim Jong-Un est plus prévisible que celle de Trump. Le chef d’état nord-coréen développe la bombe avec le souci d’être reconnu sur la scène internationale, estimant qu’en dépit de ses sorties menaçantes, Trump n’ira pas jusqu’à briser l’équilibre de la terreur. C’est étonnant car on retrouve quelque chose de l’incertitude de la guerre froide, mais dans un système international qui n’est plus bipolaire.
Je l’indiquais en ouverture de cet entretien : les deux figures de la mythologie homérique, Achille et Ulysse, incarnent respectivement la ruse et la force, tout au long de votre ouvrage. À titre personnel, Jean-Vincent Holeindre, si vous devez en choisir un, lequel de ces deux personnages respectez-vous et estimez-vous le plus, et pourquoi ?
qui d’Achille ou d’Ulysse... ?
Les deux personnages sont également intéressants par leur ambivalence et les tourments qui les assaillent. Ces tourments sont universels. Homère met en lumière deux figures du guerrier qui sont à la fois antithétiques et complémentaires. Ulysse n’est pas seulement l’antithèse d’Achille, c’est aussi son double, son alter ego.
D’un côté, Achille est un guerrier, fort, courageux, qui dispose de qualités physiques et morales exceptionnelles, mais il est orgueilleux. Il ne cherche pas la victoire, mais la « belle mort » du guerrier, obtenue au combat. Il meurt au champ d’honneur, non pour honorer sa patrie mais pour nourrir sa gloire personnelle. Il veut briller, c’est un élément essentiel de sa gloire héroïque, mais aussi de son hubris, terme grec qu’on pourrait traduire par démesure.
« On a tous quelque chose d’Achille et d’Ulysse
en nous, il est très difficile de les séparer. »
Ulysse, quant à lui, est petit, malingre, menteur, roublard. Il ne possède aucune des qualités physiques et morales du héros grec. Son identité est trouble. Pourtant, c’est lui aussi un héros, qui se distingue par son intelligence, son habilité, sa ruse. Si Achille est la quintessence du soldat, Ulysse est la première figure de stratège. Il mobilise toute son intelligence pour vivre et pour vaincre, car il est plus que tout attaché à sa famille, à sa patrie et à sa propre existence. Je crois qu’on a tous quelque chose d’Achille et d’Ulysse en nous, et qu’il est très difficile de les séparer.
Vous venez d’intégrer l’Université Paris 2 Panthéon-Assas en tant que professeur de science politique, et êtes rattaché au Centre Thucydide. Comment abordez-vous cette nouvelle aventure, et quels sont vos objectifs ?
le Centre Thucydide
Je suis tout d’abord heureux et honoré d’avoir pu réintégrer cette université au sein de laquelle j’ai commencé ma carrière en tant qu’enseignant titulaire. Une des raisons pour lesquelles j’ai rejoint le centre Thucydide, spécialisé en relations internationales, tient à mon souhait de faire dialoguer la science politique et le droit sur les questions internationales. Je n’ai pas de formation juridique mais à force de travailler avec des collègues juristes au sein des facultés de droit, à Poitiers et à Paris, j’ai pris conscience de la centralité de cette discipline pour étudier la politique et notamment l’international.
Au Centre Thucydide, avec son directeur Julian Fernandez qui est professeur de droit public, nous menons des projets en relations internationales, qui croisent les perspectives de juriste et de politiste. C’est une grande richesse. Par ailleurs, je dirige depuis peu le Master de Relations internationales de l’Université Paris 2, qui rattaché au Centre Thucydide. Ce master est co-habilité avec l’Université Paris-Sorbonne, et je l’anime aux cotés de mon collègue historien Olivier Forcade, professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne. Cette collaboration entre droit, science politique et histoire correspond à ma conception de l’Université et à ma manière de faire de la recherche. J’essaie de transmettre tout cela aux étudiants, et c’est un grand bonheur !
Vos ambitions, vos projets (perspectives de recherche mais « pas que ») pour la suite ?
« Une de mes ambitions est de faire dialoguer
le monde universitaire et celui des militaires. »
J’envisage un nouveau livre sur l’Antiquité, mais le projet n’est pas suffisamment avancé pour que je puisse en parler. Je prépare à plus brève échéance un petit manuel sur les études stratégiques, l’idée étant de synthétiser tout ce que je peux apprendre comme directeur scientifique de l’IRSEM, l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire. Composé d’environ 40 agents, dont une trentaine de chercheurs, c’est en quelque sorte le centre de recherches en sciences humaines et sociales du Ministère des Armées. L’une de mes ambitions est de faire dialoguer le monde universitaire et celui des militaires. Mes fonctions à l’IRSEM, que j’occupe depuis fin 2016, y contribuent.
Un dernier mot ?
Merci pour ces questions, nombreuses et pertinentes, qui m’ont conduit à clarifier certains points et m’ont poussé dans mes retranchements !
Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !