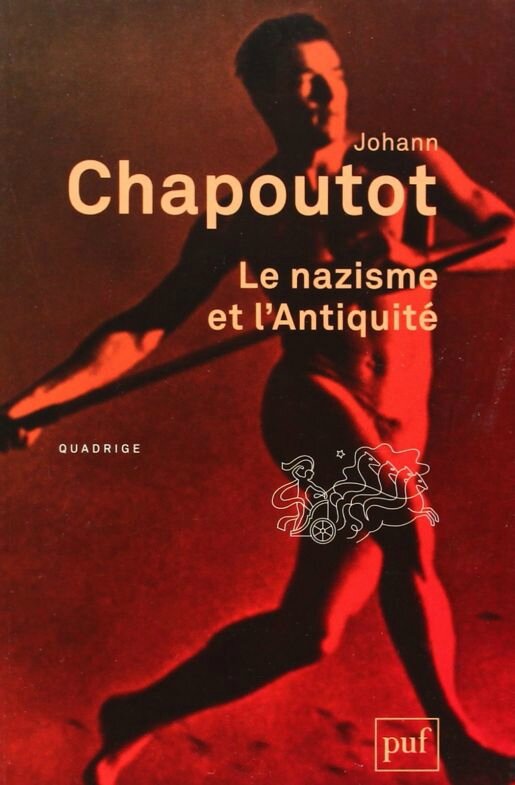« Le citoyen, un acteur à part entière de la sécurité collective », par Frédéric Coste
Frédéric Coste, chargé de recherche auprès de la Fondation pour la Recherche stratégique, est spécialisé dans les questions de défense - celles qui touchent directement aux militaires eux-mêmes bien sûr mais aussi à l’articulation qui peut exister entre ce monde, qu’on imagine plutôt fermé a priori, et la société civile. Alors qu’on semble assister, en la matière, à un rebattement - ou en tout cas à un frémissement - des cartes suite aux attentats de Paris, j’ai souhaité, le 18 novembre, le contacter par internet afin de lui poser quelques questions. Ses réponses, datées du 25, apportent de nombreux éclaircissements, des mises en perspective et pistes de réflexion fort intéressants et utiles face à des problématiques qui d’ordinaire ne touchent pas tellement le grand public mais - malheureusement - d’une actualité ardente en ces temps troublés. Merci à vous M. Coste... Une exclusivité Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.
ENTRETIEN EXCLUSIF - PAROLES D’ACTU
« Le citoyen, un acteur à part entière
de la sécurité collective »
Interview de Frédéric Coste

Illustration évoquant les Journées Défense et Citoyenneté ; source : www.defense.gouv.fr
Paroles d’Actu : Bonjour Frédéric Coste, merci d’avoir accepté de répondre à mes questions. Vous avez écrit il y a deux ans un article intitulé « Le "déni de la mort" dans les sociétés modernes occidentales et ses conséquences sur la vision de la guerre ». Avez-vous le sentiment que la population française viendrait, depuis le 13 novembre au soir (ou plus sûrement le 14 au matin), de se réveiller brutalement après une espèce de torpeur bercée d’illusions quant à, pour faire vite, sa sécurité, sa relative préservation face aux convulsions du monde ? Est-on entré en la matière dans quelque chose de réellement nouveau, même par rapport au traumatisme « Charlie » ?
Frédéric Coste : La France, comme de nombreux pays occidentaux, a été concernée par des changements socioculturels de très long terme, qui ont eu pour conséquence de fortement atténuer la présence sociale de la mort et du mourir. Jusqu’au XIXème siècle, la mort était en effet un événement quasiment omniprésent dans l’existence quotidienne des individus. Elle structurait assez largement les représentations et les pratiques sociales. Avec les progrès de l’hygiène et de la médecine, mais également la baisse du sentiment religieux, elle a été assez largement chassée du paysage cognitif des populations. Les rites funéraires sont, par exemple, beaucoup plus courts ; ils ont lieu dans des espaces relativement peu ouverts au public, presque cachés (comme les funérariums) ; surtout, ils sont largement privatisés.
« La mort a progressivement été écartée, la violence
exclue de nos sociétés occidentales »
Notre pays a également connu un processus de « civilisation des mœurs » - pour reprendre l’expression de Norbert Elias. Depuis la fin du Moyen-âge, les sociétés occidentales se sont progressivement construites à partir d’une dynamique de forclusion de la violence physique. Alors qu’être violent, voire prendre du plaisir à faire souffrir, pouvait être valorisé et valorisant pendant les périodes précédentes, ces comportements ont été progressivement prohibés en Occident. Les individus ont dû apprendre à maîtriser leurs pulsions et ont été obligés de bannir la violence physique du répertoire des interactions sociales qu’ils étaient en droit de mettre en œuvre. Cette intériorisation de nouvelles règles sociales a été concomitante d’un autre mouvement : la construction d’un monopole de l’emploi de la contrainte légitime par l’État. En dehors du cas particulier de la légitime défense, les représentants de l’État sont les seuls à pouvoir légitimement recourir à la contrainte physique, mais au seul bénéfice de l’ensemble de la communauté nationale et généralement en dernier recours.
Le processus de civilisation des mœurs n’est pas une tendance linéaire. Des retours en arrière ont eu lieu. Surtout, la violence n’a jamais disparu. Même si sa forme physique est plus difficile à utiliser, elle continue de s’exprimer par d’autres canaux. On parle, par exemple, de violence psychologique ou de violence symbolique. Par ailleurs, le monopole de l’État est toujours contesté. Mais le constat demeure : les sociétés occidentales sont infiniment plus pacifiées qu’au cours des siècles précédents, et la mort est aujourd’hui presque considérée comme une anomalie, une aberration. Certains auteurs ont même parlé d’une « idéologie de la vie » qui s’exprimerait à l’heure actuelle.
Enfin, ces évolutions ont rencontré une période relativement longue d’absence de conflits armés dans notre pays. Du fait de l’existence de la Destruction mutuelle assurée, la Guerre froide n’a jamais pu s’exprimer par des conflits inter-étatiques en Europe. Elle a pris, entre autres, la forme de conflits armés sur des théâtres stratégiques « périphériques » à l’époque (Afrique et Asie notamment). Depuis la fin des conflits de la décolonisation, la France n’a donc plus connu de conflits armés sur son territoire national.
Les attentats que la France vient de subir entrent en contradiction avec toutes ces tendances. Il est toutefois encore trop tôt pour savoir si les perceptions développées par les Français à l’égard de leur sécurité ont profondément et surtout durablement changé. Il faudra attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, en observant les éventuelles modifications dans leurs comportements, et surtout en analysant les données (issues des sondages et études) sur leur évaluation des risques et menaces.
Toutefois, il convient d’ores et déjà de constater que les réponses ont été nombreuses et extrêmement diversifiées aux attentats que nous venons de connaître : au dépôt de fleurs et autres bougies sur les lieux des attaques - réactions finalement assez classiques - il y a par exemple eu une véritable mobilisation via les réseaux sociaux ou la multiplication des minutes de silence au début des compétitions sportives professionnelles. Ces réactions semblent, parmi d’autres, attester d’une prise de conscience.
Par ailleurs, en dehors du caractère massif des attentats - qui est propre à créer un véritable « choc » - il faut replacer ces événements dans une séquence. Tout d’abord, il ne faut pas oublier que les Français ont redécouvert les opérations de guerre avec la médiatisation de l’intervention en Afghanistan. Ces opérations ont duré plus de dix ans et ont été, d’une certaine manière, prolongées par d’autres interventions : Libye, Mali, Irak, Syrie... Certaines études réalisées sur les perceptions que les jeunes Français développent à l’égard des armées ont des résultats assez clairs : la composante guerrière, coercitive, du métier militaire est parfaitement appréhendée par nos compatriotes les moins âgés.
« Avec ces attentats de novembre, c’est un ensemble
de dénis qui s’effondrent »
Surtout, la France a été frappée à plusieurs reprises sur son territoire ces dernières années. À la répétition, vient s’ajouter le fait que les éventuels mécanismes psychologiques de déni de la menace sont désormais confrontés à la réalité : tous les Français sont potentiellement visés. Mohamed Merah s’était attaqué à des militaires et à un établissement scolaire juif. Sid Ahmed Ghlam avait pour objectif des églises. Amedy Coulibaly a abattu une agent de la police municipale de la ville de Montrouge, avant de s’attaquer à un magasin dont la clientèle est majoritairement de confession juive. Les frères Kouachi se sont pour leur part concentrés sur les membres de la rédaction de Charlie Hebdo. En visant des cibles spécifiques, ces attentats ont pu laisser penser à certains de nos compatriotes qu’ils n’étaient pas réellement concernés. Face à une menace, nier est une réaction psychologique assez classique, qui doit permettre de gérer son angoisse. Certains Français semblaient s’être abrités derrière l’idée que ceux qui étaient visés étaient des représentants de l’État, notamment membres des services impliqués dans la lutte contre les groupes terroristes (policiers, militaires), des journalistes engagés ou des croyants (juifs ou catholiques). Ne faisant pas partie de ces catégories, ils ont pu croire - sans même le formuler explicitement - qu’ils n’étaient pas concernés. Avec les attaques de novembre, ces mécanismes de déni ne peuvent plus fonctionner.
Enfin, à la répétition des attentats et à l’ampleur des derniers, il faut ajouter le fait que certaines étapes ont été franchies : la France n’avait notamment jamais connu d’attentats-suicides. Tous ces éléments sont de nature à marquer durablement les esprits.
PdA : Les décisions dont le président de la République a dressé ces derniers jours les contours, de l’instauration de l’état d’urgence jusqu’aux annonces faites devant le Parlement réuni en Congrès, vous paraissent-elles de nature à rassurer les Français ?
F.C. : L’instauration de l’état d’urgence peut être une décision extrêmement marquante si elle utilisée pour la mise en œuvre de mesures dérogatoires du droit commun perceptibles par tous. En dehors de la fermeture, temporaire, des lieux publics et de l’interdiction des rassemblements et manifestations, elle n’a finalement pas eu véritablement de conséquences directes pour les Français.
Pour les services de police et de renseignement, elle a été particulièrement utile. Elle a notamment permis de s’affranchir de certaines contraintes juridiques lors des enquêtes et des interpellations. Par exemple, la police ou la gendarmerie peut habituellement entrer dans un domicile par la force pour arrêter une personne recherchée. Mais dès lors qu’il s’agit d’une simple fouille, le cadre légal prévoit que les perquisitions ne peuvent être réalisées qu’après six heures du matin. Or, l’état d’urgence a permis d’assouplir le régime des perquisitions administratives. Nombre de celles qui ont été organisées après les attentats l’ont été de nuit et sans en référer préalablement à un magistrat. Il s’agit d’un effet concret de l’état d’urgence qu’en dehors des juristes, peu de Français ont sans doute appréhendé.
De même, l’état d’urgence a permis de faciliter la dissolution des associations. Il s’agit probablement d’un procédé utile pour sanctionner les collectifs problématiques, mais il est peu « voyant » pour le commun des mortels. À l’inverse, instaurer un couvre-feu est, par exemple, une décision qui a un impact beaucoup plus concret dans la vie des citoyens. L’état d’urgence donne cette possibilité au préfet. Si un couvre-feu a bien été décrété par le préfet de l’Yonne, pour une partie de la ville de Sens, aucune application à l’ensemble du territoire n’a été décidée.
Le constat est donc que l’état d’urgence a surtout été utilisé pour renforcer les pouvoirs de la police dans la lutte contre le terrorisme, complétant d’ailleurs les dispositions de la loi sur le renseignement votée en juillet, mais qu’il n’a pas servi de socle pour instaurer des décisions impactant considérablement la vie quotidienne des Français. C’est donc plutôt sa valeur symbolique qui est susceptible d’influencer nos compatriotes. En cela, son instauration est complémentaire de l’annonce d’une réforme de la Constitution.
L’autre décision principale du président de la République est l’accroissement des effectifs militaires de l’opération Sentinelle. Si l’on peut s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif, tel qu’il est actuellement pratiqué, mais également sur sa pérennité (les forces de police et les armées étant « en surchauffe » du fait des déflations d’effectifs), il a le mérite, pour les populations, d’être voyant. Le problème est que les militaires sécurisent depuis maintenant de nombreuses années les lieux publics et les sites sensibles – notamment en Île-de-France. Nos concitoyens ont perçu l’augmentation des effectifs sur le terrain – phénomène qui favorise la réassurance –, mais sont également habitués à cette présence.
Enfin, les annonces en matière d’effectifs (recrutement dans la police, la gendarmerie et les douanes) sont, de nouveau, des décisions qui n’ont pas d’impact direct pour les populations. Surtout, elles n’auront de conséquences que dans quelques mois. Il faut en effet environ un an pour former un fonctionnaire de police, deux pour qu’il devienne spécialiste du renseignement. De même, l’armée de Terre estime qu’il faut environ dix-huit mois pour former un militaire du rang et qu’il soit véritablement opérationnel… Ces décisions sont une nécessité, leur annonce constitue un signal envoyé par les autorités politiques, mais elles n’auront pas d’effets immédiats.
« La population doit ressentir l’effet des mesures prises
dans son quotidien pour voir son angoisse s’atténuer »
Je pense donc que la réassurance viendra probablement de changements plus concrets. Les décisions annoncées ne semblent pas heurter les populations : l’autorisation donnée aux fonctionnaires de police, volontaires, de porter leurs armes en dehors des heures de service, la dissolution facilitée d’associations diffusant des discours problématiques, les assignations à résidence prononcées par le ministre de l’Intérieur et l’augmentation des effectifs militaires affectés à l’opération Sentinelle sont finalement des mesures relativement consensuelles. Elles viennent compléter des choix plus symboliques : déclaration, puis prorogation, de l’état d’urgence et annonce d’une réforme constitutionnelle à venir. Mais pour faciliter la prise de conscience de ceux qui sont encore dans le déni et atténuer l’angoisse de nombre de nos concitoyens, il faut sans doute également : 1/ des progrès rapides dans les enquêtes, assortis d’arrestations – ce qui a été le cas ; 2/ des mesures de sécurité concrètes, comme la multiplication des fouilles de sacs et des détecteurs et autres portiques dans les établissements publics ou accueillant du public, qui s’appliquent dans le quotidien de la population.
PdA : Plaidez-vous en faveur d’une re-sensibilisation active de la population civile à ce qui touche aux problématiques liées à la sécurité et à la défense nationales ? Si oui, comment visualisez-vous cela ?
F.C. : Il faut effectivement sensibiliser bien plus les Français aux problèmes de sécurité et de défense. Tout d’abord parce que nous sommes en démocratie et qu’il faut que les citoyens, qui prennent part à la décision politique, notamment en votant, puissent disposer des informations nécessaires pour comprendre les choix, les arbitrages qui sont faits par les autorités dans ces domaines (et éventuellement les soutenir ou les critiquer).
Ensuite, parce que la menace existe. Pour éviter les phénomènes de sidération et favoriser la mise en œuvre de « bons » comportements au moment où un attentat a lieu, il faut que les individus soient informés. La surprise peut être extrêmement dangereuse, car incapacitante, en situation de stress extrême.
« Donnons aux citoyens les moyens d’être un peu plus
acteurs de leur propre sécurité »
Dans l’absolu, il faudrait donc que la sensibilisation et l’information du public soient complétées par l’apprentissage des comportements à adopter en cas d’attaques. Il a été choquant de voir des personnes se rapprocher du Bataclan, ou de l’Hyper Casher en janvier, alors que l’assaut était donné par les forces de police. Lorsque les cordons de sécurité étaient repoussés, certains cherchaient manifestement à demeurer au plus près – comme pour voir un spectacle. Ces comportements peuvent gêner les forces de sécurité et même représenter un risque. Un certain nombre de réflexes peuvent ainsi être inculqués : savoir comment s’enfermer et se protéger chez soi, connaître les canaux d’information fiables vers lesquels se tourner pour avoir des nouvelles officielles et se tenir au courant des consignes à suivre, disposer des numéros de téléphone officiels pour déclarer un événement inquiétant… Il s’agirait donc de donner les moyens aux citoyens d’être, dans une certaine mesure, un peu plus acteurs de leur propre sécurité. La résilience des individus et des collectifs est d’autant plus élevée que les personnes ont l’impression de détenir et détiennent effectivement des informations et des compétences pour faire face à la situation dangereuse.
L’article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile, qui date de 2004, précise que « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ». Dans une certaine mesure, cette logique devrait être élargie à la sécurité en général.
En dehors des éventuelles informations et analyses fournies par les médias, il existe déjà des médiums pour réaliser cette sensibilisation. La question est de savoir si leur utilisation est optimisée. Le Parcours de citoyenneté, qui a remplacé le Service national obligatoire, comprend par exemple une Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Il s’agit du seul dispositif qui touche l’ensemble d’une même classe d’âge, filles comme garçons. Au cours de cette journée, des présentations sont réalisées, dont certaines portent sur les risques et menaces auxquels la France doit faire face et sur la politique de défense de notre pays. De même, des visites de sites sont parfois organisées, en particulier de bases du ministère de la Défense, de casernes de sapeurs-pompiers ou de commissariats. Il s’agit de faire appréhender plus concrètement aux jeunes Français ce que sont les métiers et les missions des forces armées et des services impliqués dans les missions de sécurité (au sens large).
En dépit d’améliorations indéniables, cette journée demeure insuffisante. En dehors de l’administration du module d’information sur les enjeux de la défense, elle sert également à la détection de l’illettrisme, à une formation sur les responsabilités du citoyen et à une initiation aux gestes de premier secours. Le programme est extrêmement chargé. L’idéal serait que ces différentes composantes soient étalées sur plusieurs journées. Dans le cadre d’un éventuel allongement de la durée, il serait sans doute possible d’accentuer la sensibilisation aux menaces.
Le parcours de citoyenneté comprend également deux modules d’enseignements spécifiques, programmés en classe de 3ème et de 1ère. Cette sensibilisation particulière, qui porte notamment sur les principes et l’organisation de la défense, intègre une présentation sur la diversité des menaces et leurs évolutions. En dehors de ces séquences clairement identifiées, certaines notions liées à la défense et à la sécurité sont également présentes dans les programmes d’histoire-géographie. Ces informations doivent être véritablement considérées comme un complément indispensable à l’enseignement moral et civique (EMC), mis progressivement en place depuis 2013. De nombreuses modifications ont d’ailleurs permis d’améliorer leurs contenus. Les enseignants peuvent désormais s’appuyer sur des fiches pédagogiques très bien construites. Mais à nouveau, nous devons nous demander si cette sensibilisation ne devrait pas faire l’objet d’un nombre d’heures d’enseignement plus important.
Il existe donc déjà des voies pour pratiquer cette sensibilisation aux questions de défense et de sécurité, en particulier chez les plus jeunes. Elles concernent notamment l’Éducation nationale, mais également les armées (en particulier les réservistes) et l’Institut des Hautes études de Défense nationale (IHEDN). Les journées « portes ouvertes » dans les unités militaires, les animations liées au 14 juillet, les interventions de professionnels dans les collèges et les lycées, les différents types de sessions et manifestations (colloques et conférences) organisées par l’IHEDN et ses associations régionales… complètent le Parcours de citoyenneté. Dans chaque établissement d’enseignement supérieur, il existe également un « référent défense et sécurité » (RDS), qui a pour mission d’informer et de sensibiliser les étudiants et les personnels aux questions de défense et de sécurité nationale.
« Il est indispensable de répéter les messages de prévention
et de sensibilisation pour une efficacité optimale »
Nous savons qu’en matières de prévention et de sensibilisation, la répétition des messages est indispensable. Cette répétition est déjà pratiquée à l’heure actuelle. Il ne s’agirait pas donc de créer à partir de rien. Les compétences existent, de même que les formats pédagogiques, adaptés à des publics très différents. Avant même de penser à mettre en place de nouveaux dispositifs, nous pourrions optimiser ceux qui existent, en y consacrant plus de moyens, financiers et humains, et surtout de temps.
PdA : Les civils doivent-ils, pour l’heure, considérer et intégrer dans leur esprit l’idée que la France est en guerre et que cette guerre peut s’immiscer jusque dans leur vie ?
F.C. : Je suis personnellement extrêmement mal à l’aise avec l’emploi du terme « guerre ». Pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que la guerre est un phénomène qui bénéficie d’une définition, certes assez imprécise, en droit international. Le mot est normalement employé pour caractériser les conflits armés entre entités étatiques. À la différence des autres conflits armés internationaux, la guerre fait normalement l’objet d’une déclaration, acte solennel de nature quasi juridique (et généralement précédé d’un ultimatum). Pour qu’il y ait guerre, il faut également que les parties au conflit reconnaissent l’état de guerre. La situation que nous connaissons ne correspond pas véritablement à cette définition. Et il peut être dangereux de brouiller les catégories existantes, en particulier lorsque l’on cherche à analyser et comprendre les phénomènes. Le concept américain de « guerre contre la terreur », né après le 11 septembre 2001, est la preuve que des excès peuvent survenir lorsque les catégories juridiques ne sont plus véritablement respectées.
« Parler de "guerre" revient à reconnaître à Daesh
le caractère étatique auquel il prétend »
Par ailleurs, l’emploi du terme pourrait être compris comme une reconnaissance implicite du caractère étatique de Daesh. Or, notre stratégie est bien de délégitimer cet acteur et ses méthodes, alors même qu’il dispose déjà de certains des caractères d’un État.
L’utilisation du mot est évidemment liée à la volonté de faire prendre conscience de la gravité de la situation aux Français. Elle s’explique également par le fait que, pour lutter contre cet ennemi, nous devons mettre en œuvre des moyens militaires et réaliser des opérations armées similaires à celles que nous pourrions être amenées à employer dans le cadre d’une véritable guerre : acquisition de renseignement à vocation opérationnelle, ciblage et établissement de plans de frappes, bombardements… La lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes qui visent la France se joue en effet autant à l’intérieur de nos frontières que dans les espaces extérieurs dans lesquels interviennent nos forces armées.
La lutte contre ces acteurs nécessite par ailleurs une mobilisation des énergies et un état d’esprit qui se rapproche de celui qui doit prévaloir lors d’une guerre. Les Français vont devoir accepter de vivre avec la menace et, éventuellement, de faire certains sacrifices. L’état d’urgence a été utilisé pour permettre l’application de normes beaucoup moins protectrices pour le citoyen que celles qui prévalaient auparavant. En accroissant le champ d’application des procédures administratives, ces normes amoindrissent notamment les capacités de contrôle du juge – garant des libertés fondamentales. Mais ces modifications doivent permettre un gain d’efficacité pour les forces de police et les services de renseignement.
En dehors de la création de ces normes, les Français vont également devoir accepter des procédures de sécurité plus strictes et plus nombreuses. Les contrôles d’identité, fouilles de sacs, passages au détecteur… vont se multiplier, créant de nouvelles contraintes (notamment une perte de temps). C’est la contrepartie qu’il faudra supporter pour accroître le niveau de notre sécurité.
« Depuis le début de l’année 2015, en moyenne,
un attentat a été déjoué par mois »
La menace malheureusement le justifie. Entre 2001 et 2010, les services de renseignement et de police sont intervenus pour empêcher, en moyenne, un ou deux attentats par an. Depuis le début de l’année 2015, les démantèlements successifs de réseaux et cellules ont permis d’éviter, en moyenne, un attentat par mois. S’y ajoutent ceux que nous ne sommes pas parvenus à empêcher. Cette arithmétique, très simple, est révélatrice de l’accroissement de la menace.
PdA : Un dernier mot ?
F.C. : Les attentats de Charlie Hebdo puis ceux de novembre ont malheureusement confirmé qu’en dépit de très bons services de renseignement, toutes les attaques ne pouvaient être anticipées ni empêchées. Pour élever notre niveau de vigilance et renforcer nos capacités de réponse face à ce type de menaces, il va sans doute falloir que les citoyens soient plus « acteurs » de la sécurité et que nous réfléchissions à une nouvelle répartition des tâches entre les différentes catégories d’acteurs privés et publics impliqués dans ces missions : police nationale et gendarmerie, polices municipales, « para-polices » (forces de sécurité privées dotées, par délégation, de certaines prérogatives de police – comme la sûreté ferroviaire de la SNCF et le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux de la RATP) et sociétés de sécurité privée.

Photo : Fondation pour la Recherche stratégique
Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook et Twitter... MERCI !