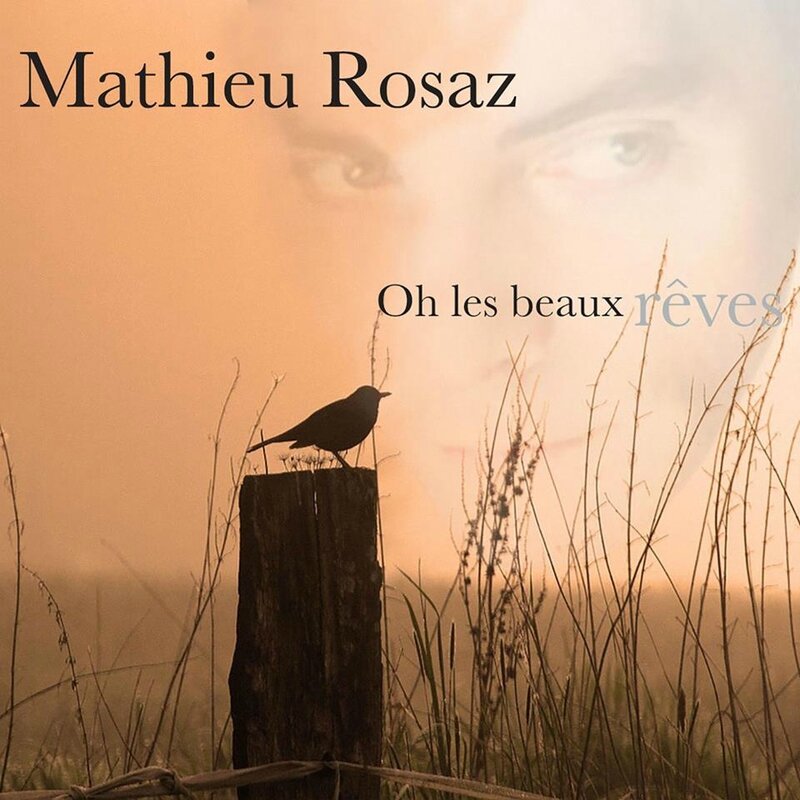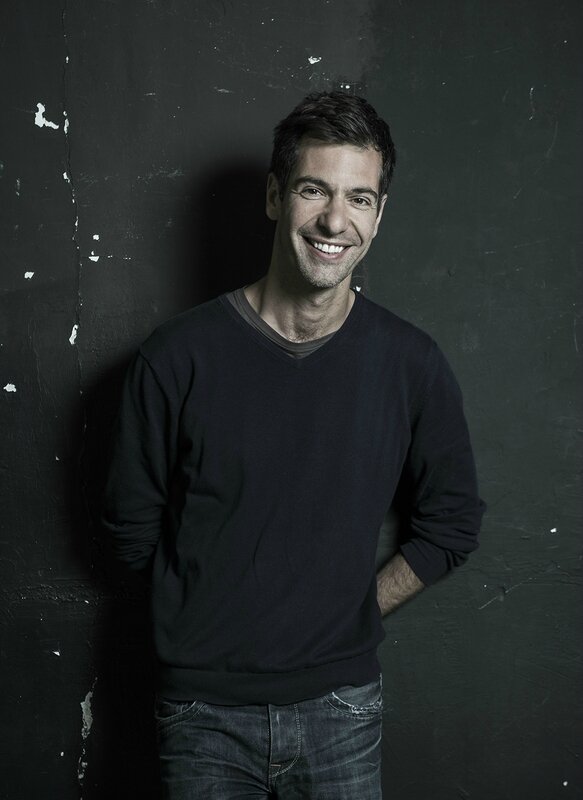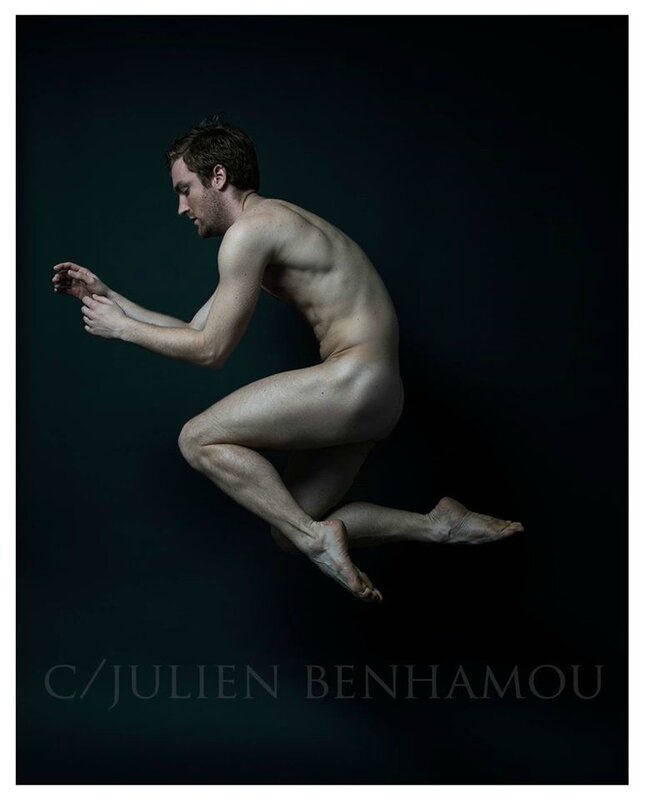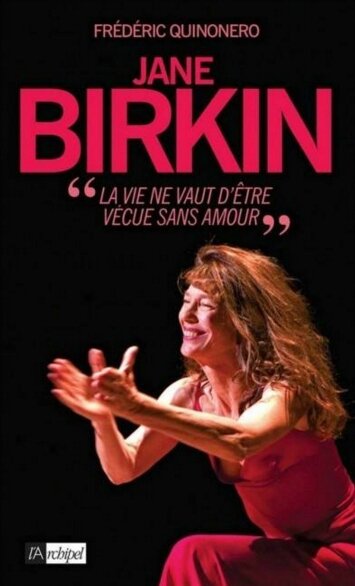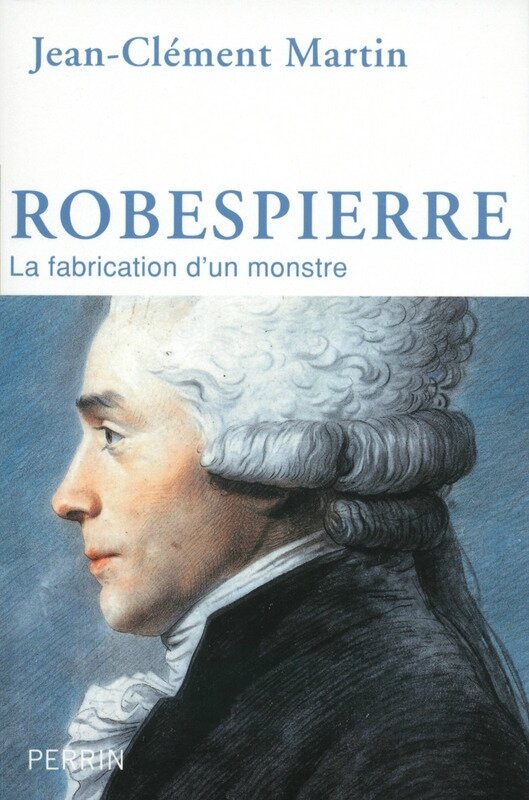« Le référendum, ultime avatar de l'idée démocratique ? », par Bertrand Mathieu
Par cet article sera inaugurée une série que j’espère riche de tribunes et interviews ayant pour thématique la proposition suivante, déjà utilisée lors d’un article récent composé avec des jeunes engagés en politique : Si la Constitution m’était confiée... (Loi fondamentale et lois organiques : réflexions et propositions sur les règles du jeu démocratique et l’organisation des pouvoirs en France).
Pour ce premier texte, c’est un invité de choix qui m’a fait l’honneur d’accepter mon invitation : M. Bertrand Mathieu, professeur à l’École de Droit de la Sorbonne - Université Paris I et l’un des constitutionnalistes - et juristes en général - les plus éminents que compte le pays (auteur de nombreux ouvrages, il est notamment président émérite de l’Association française de droit constitutionnel et a participé au comité de réflexion et de proposition dont les travaux ont abouti à la réforme de la loi fondamentale de 2008). Il s’exprime ici sur une question essentielle, d’après une proposition discutée et amendée avec lui : « Le referendum, ultime avatar de l’idée démocratique ? ». Un document précieux et éclairant quant à un débat d’actualité majeur, je l’en remercie... Une exclusivité Paroles d’Actu. Par Nicolas Roche.
Le référendum, ultime avatar de l’idée démocratique ?
par Bertrand Mathieu, professeur à l’École de Droit
de la Sorbonne - Université Paris I, le 11 avril 2016

Source de l’illustration : article Slate.fr
Le referendum fait un retour notable dans la pratique politique des États européens : référendum grec sur la politique d’austérité, referendum hollandais sur le projet d’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine, referendum britannique sur l’appartenance à l’Union européenne, referendum hongrois sur l’immigration… En France, un certain nombre de candidats à la Primaire de la droite et du centre, dont François Fillon, invoquent la nécessité de recourir au référendum pour ancrer démocratiquement les bases des grandes réformes qui devront être conduites. On peut invoquer également le projet de référendum sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, outil juridique improvisé pour tenter une sortie de crise.
« Les références répétées à l’idée de référendum
témoignent d’une défiance profonde envers le politique »
Cette utilisation, ou ces références, au référendum traduisent en fait une véritable crise de la démocratie représentative. Faute de projet politique et d’enracinement dans une histoire et des valeurs, l’Europe politique est une abstraction. Dotée d’une administration déconnectée des Peuples européens et d’un Parlement dont les membres sont à la fois élus sur des critères politiques nationaux et selon un mode de scrutin proportionnel qui ne crée aucun lien entre représentants et représentés, l’Europe n’offre qu’une image technocratique. Faute de développer un sentiment d’adhésion, les référendums dont le sujet est européen ne font que manifester la défiance des Peuples nationaux. Faut-il s’en inquiéter ? Incontestablement, oui ! Dans une période de troubles économiques et géopolitiques, la dilution de l’Europe ne fait qu’ajouter aux dangers auxquels nous sommes confrontés. Faut-il faire taire les Peuples, à la raison qu’ils sont incapables de comprendre les nécessités d’une Europe forte ? Ce serait renforcer la césure entre le Peuple et les gouvernants, souffler sur les braises d’une révolte latente. Le référendum grec, qui démontre que la voix du Peuple ne suffit pas à surmonter les contraintes économiques d’un pays gouverné par des instituions financières, démontre que la souveraineté d’un État peut ne plus être qu’une fiction juridique. Or, la démocratie implique par nature l’existence d’un souverain dans un cadre géographique déterminé. Le referendum hollandais, qui n’est que consultatif traduit une manifestation de souveraineté qui ne peut être ignorée des dirigeants de ce pays, le referendum britannique constitue une menace pour l’Europe, mais aussi une révolte contre des contraintes mal comprises ou mal acceptées, qu’elles viennent d’ailleurs de l’Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l’Homme.
En France, les votes pour des partis se situant aux extrêmes de l’échiquier politique, s’ajoutant aux abstentionnistes, sont majoritaires. Les raisons en sont multiples, elles tiennent notamment à la déconnection entre le choix électoral et les décisions prises qui résultent en fait de contraintes externes, économiques, financières… Par ailleurs, la démocratie, qui fonctionne dans un cadre national, est concurrencée par des systèmes supranationaux. Or les unes et les autres de ces contraintes n’obéissent pas à une logique démocratique. Les décisions juridictionnelles nationales ou supranationales concurrencent le pouvoir politique. Le jeu, devenu triangulaire des forces politiques, accule les formations politiques traditionnelles à un déni de réalité. L’affrontement entre ceux qui maintiennent la fiction d’une démocratie vivante et ceux qui laissent croire que l’on pourrait, par une simple volonté politique, échapper aux contraintes externes est stérile. Il menace nos systèmes démocratiques qui sont plus fragiles que l’on peut le penser.
Faut-il alors considérer le référendum comme un danger ou comme une solution ? Il peut être l’un et l’autre. Face au déni de démocratie et de souveraineté qui se manifeste partout en Europe, utilisé comme instrument politique, il permet aux gouvernements de canaliser la colère latente des citoyens vers un repli nationaliste qui constitue une impasse. Mais continuer à faire l’impasse sur cette révolte sourde en privant le Peuple de la possibilité de s’exprimer, c’est courir le danger d’une explosion dont personne ne peut prédire les péripéties et les conséquences. Entre une destruction progressive de l’idée européenne et une fracture brutale, la troisième voie semble difficile.
« Prometteuse au niveau local, la démocratie participative
ne saurait être utilisée comme expression de la souveraineté »
Le recours à la démocratie participative développe les communautarismes et ne permet pas de légitimer les décisions au niveau national. Outil prometteur de la gestion des problèmes locaux, elle n’est pas à la dimension de la démocratie en tant qu’expression de la souveraineté. Privilégiant les groupes de pression, elle accroît la distance entre ceux qui ont les outils décisionnels et ceux qui sont privés de moyens d’expression.
Par ailleurs, il est dangereux de considérer que le droit se place au-dessus de la démocratie. La mutation de la conception représentative de la démocratie en un État de droit, impliquant la séparation des pouvoirs, les droits fondamentaux, la transparence… fait du juge un arbitre placé au dessus du Peuple (cf. B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ?, Lextenso, 2015), une sorte d’usurpation oligarchique au sein d’un système qui se veut démocratique.
Revivifier la démocratie c’est revenir à son sens premier, rendre la parole au peuple. Au-delà de la formule, le référendum, prévu par la Constitution est un instrument pertinent. C’est un outil de démocratie directe, dans un système qui par nature éloigne les citoyens des mécanismes de décision. C’est un moment de respiration démocratique dans un monde technicisé. C’est l’occasion d’un débat autour de la détermination des valeurs qui constituent l’identité nationale. Craint, du fait que le Peuple ne répond pas toujours à la question posée, galvaudé, par une utilisation opportuniste, le référendum reste un outil majeur de la démocratie. On dénonce le risque de dérive plébiscitaire, pourtant quoi de plus démocratique pour un responsable politique que d’engager sa responsabilité devant le Peuple qui l’a élu en cours de mandat ? On invoque le risque de dérive populiste, mais priver le peuple de la faculté de s’exprimer ne peut que favoriser les partis populistes.
Il est vrai que dans notre système juridique le principe démocratique est tempéré par un principe libéral de séparation des pouvoirs et de garantie des droits. La question se pose alors de trouver un mécanisme qui permette de redonner la parole au Peuple tout en évitant que ne soit remise en cause cette démocratie tempérée qui est le modèle de nos sociétés occidentales.
Plusieurs pistes peuvent être explorées. D’abord redonner la parole au Peuple sur des questions importantes, parmi lesquelles ces « questions de société », dont justement le Conseil constitutionnel estime qu’elles sont tellement politiques qu’il n’en contrôle pas la constitutionnalité. Faire valider les grandes lignes d’un projet économique et social de redressement… Mais sont aussi concernées les questions qui engagent l’avenir d’une Nation. La construction européenne est de celles-là. Redessiner une Europe politique et des droits et libertés ambitieuse mais respectueuse des identités nationales, économiquement puissante, unie autour de positions géostratégiques communes, d’une monnaie commune soutenue par une politique sociale et fiscale communes constitue une ambition qui pourrait réunir les Peuples européens après un véritable débat.
Mais si le referendum est un outil de la démocratie, il est aussi de par son caractère binaire, sa force et la brutalité de son résultat un outil dangereux. Par exemple, il faut aussi éviter que par la voie référendaire ne soient opérées des violations de droits et libertés, fondamentaux au sens strict du terme. Une méthode simple existe : soumettre les projets (ou les propositions) de loi référendaires au Conseil constitutionnel préalablement à leur vote par le Peuple, le juge constitutionnel pouvant apprécier, tant la clarté du texte, voire de la question, que sa conformité aux dispositions substantielles de la Constitution.
« Une des questions essentielles est celle de l’articulation
entre principe démocratique et principes libéraux »
Il ne faut pas se cacher que cette procédure interdirait au Président de la République de réviser la Constitution en en appelant directement au Peuple sans vote préalable des Assemblées parlementaires. Concernant l’Assemblée nationale, le Président pourrait toujours prononcer une dissolution suivie d’élections dont l’un des enjeux serait la révision constitutionnelle. Cette possibilité n’existe pas pour le Sénat, ainsi le Sénat pourrait s’opposer à lui seul à une révision constitutionnelle, ce qui présente l’avantage d’éviter toute révision ne faisant pas l’objet d’un consensus minimum, mais donne au Sénat un pouvoir considérable et empêcherait incidemment toute révision conduisant à modifier le rôle du Sénat. Reste à savoir si cet inconvénient est dirimant au regard de l’intérêt politique que représenterait une telle novation. Plus grave, cette procédure, si elle ne donne pas le dernier mot au juge, lui permet d’empêcher le Peuple de se prononcer. Peut être conviendrait-il de réfléchir à une intervention du juge constitutionnel, limitée à l’examen de la clarté et de l’intelligibilité de la question posée. Le débat reste ouvert. Il est fondamental, il s’agit de savoir du principe démocratique ou du principe libéral lequel doit l’emporter. En toute hypothèse aujourd’hui ce n’est pas d’excès, mais d’insuffisance de démocratie dont nous souffrons.
S’agissant de la révision de la Constitution, il conviendrait également d’associer le Peuple à toutes les révisions importantes. Aujourd’hui deux procédures peuvent être utilisées, indifféremment, par le Président de la République, en vertu de l’article 89 de la Constitution, à la suite de l’adoption du texte par les deux assemblées : un vote par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes ou un referendum. On pourrait imaginer que soient distinguées, comme c’est le cas par exemple en Espagne, les révisions ne nécessitant que l’intervention des Assemblées, de celles faisant obligatoirement intervenir le Peuple. De ces dernières devraient relever les deux principes qui fondent notre ordre juridictionnel : la souveraineté nationale et les droits de l’Homme. Il conviendrait, peut être, d’y ajouter les principes essentiels relatifs aux compétences et aux nominations des organes de l’État, notamment le président de la République.
Une autre réflexion doit s’engager sur le referendum dit d’« initiative populaire ». Instauré par la réforme constitutionnelle de 2008, ce referendum est en réalité un référendum mixte d’initiative parlementaire (d’abord) puis de confirmation populaire (ensuite). Prudemment, le Constituant a assorti ce recours au referendum d’un contrôle du juge constitutionnel. Dans son principe, ce referendum d’initiative populaire, relève de par son imitative d’une logique de démocratie participative, de par son adoption, d’une logique de démocratie directe. Cette relative confusion des logiques participe peut-être de l’échec de cette procédure. En effet, ce referendum peut également être l’objet de manipulation de la part de groupes de pression.
Enfin, il convient de ne pas confondre le referendum local, qui pourrait être développé, y compris dans le cadre d’une initiative populaire, et qui vise des décisions locales, propices aux mécanismes de démocratie participative et les referendums nationaux, expression de la volonté du peuple.
À instaurer la confusion entre la démocratie et le respect des droits des minorités, entre les expressions communautaristes et l’intérêt général, entre les valeurs communes et les identités particulières et les désirs individuels, à oublier le rôle fondamental des frontières nationales qui ne sont pas signes d’enfermement mais base indispensable au dialogue et aux échanges, à mépriser le Peuple incapable de comprendre les enjeux de nos sociétés, on a gravement altéré le principe et la mécanique démocratiques sans avoir trouve de légitimité de substitution.
« Le niveau d’altération du sentiment démocratique impose
un traitement sérieux de la question du référendum »
Le recours à un usage raisonné du référendum sera peut-être jugé dépassé, c’est pourtant l’un des dernières tentatives permettant de revivifier le sentiment démocratique. Il répond à la nécessité de rendre la parole au peuple, ce qui dans un système qui se veut démocratique n’est pas si archaïque que veulent bien le penser ceux qui sont, de fait, attachés à un système oligarchique et qui exercent, à ce titre, le pouvoir intellectuel ou politique. Faute de quoi, le Peuple risque de reprendre une parcelle du pouvoir qui lui est dénié dans des conditions qui peuvent conduire à tous les débordements.
Mais, de la même manière que l’humanisme n’est peut-être pas l’horizon indépassable de l’Homme, la démocratie n’est peut-être pas l’horizon indépassable de nos sociétés politiques. Mais la société post-démocratique, comme le transhumanisme ouvrent des horizons bien obscurs.
Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook et Twitter... MERCI !