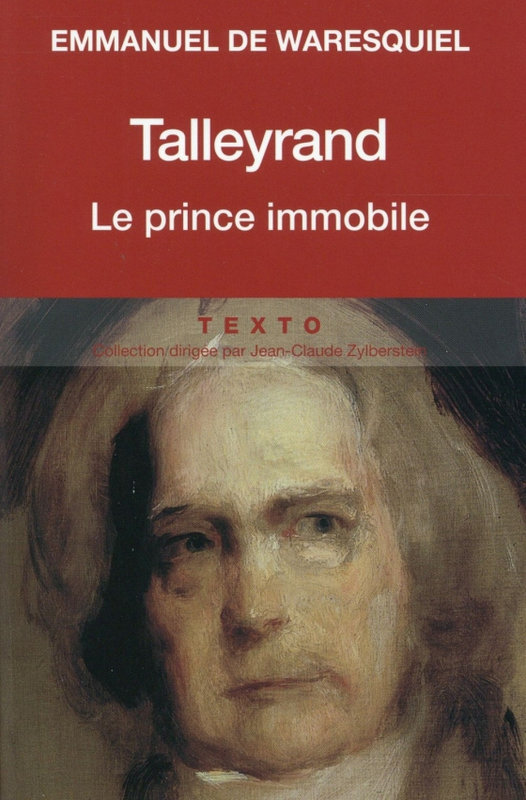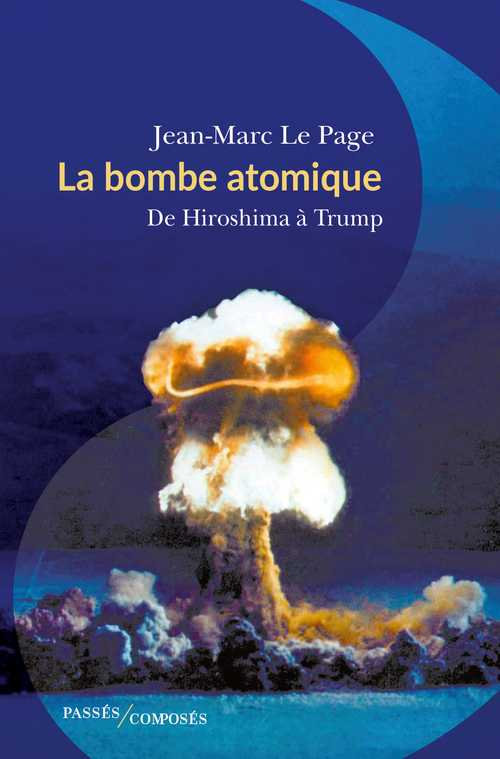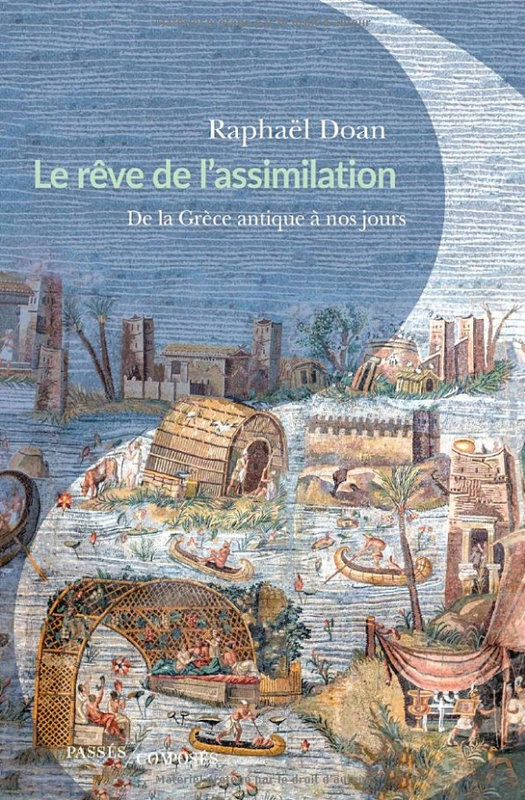Ian Hamel : « Comment Tapie, simple homme de paille, a-t-il pu ainsi briller ? »
La disparition de Bernard Tapie, survenue le 3 octobre dernier dans sa 79ème année, a sans surprise fait la une de l’actualité du jour. De nombreux hommages ont été rendus à ce personnage au charisme certain qui aura eu mille vies, ou pas loin : il fut chef d’entreprise, député, "Boss" de l’OM, ministre, patron de presse, et même chanteur. Les dernières années de son existence furent marquées par la maladie, et sa lutte courageuse (comme tous les malades) et médiatisée contre le cancer lui a attiré de puissants élans de sympathie populaires.
Mais qui était vraiment Bernard Tapie, au-delà de celui qui nous a été vendu, quarante années durant, par un des plus grands communicants de notre temps, à savoir lui-même ? Ian Hamel, journaliste au Point, répond à cette question dans C’était Bernard Tapie (L’Archipel, 2021), une bio fouillée et sans complaisance. Autant le dire cash : les fans de Tapie risquent de ne pas aimer ce qu’ils liront, peut-être aussi de ne pas reconnaître tout à fait celui qu’ils voyaient presque comme un familier. De son vivant, Bernard Tapie aimait contrôler ce qui le concernait : il n’est plus et appartient désormais, sinon aux historiens, en tout cas à ceux qui voudront bien écrire et enquêter sur lui. Il n’y a pas là de vérité définitive mais une pièce supplémentaire apportée au dossier Tapie, pour mieux cerner l’homme, fascinant autant qu’il fut controversé, les dérives de l’argent roi et d’un pouvoir ayant perdu sa boussole, et parfois son âme. Exclu, Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.
EXCLU - PAROLES D’ACTU
Ian Hamel : « Comment Tapie,
simple homme de paille,
a-t-il pu ainsi briller ? »
C’était Bernard Tapie de Ian Hamel (L’Archipel, 2021)
Ian Hamel bonjour. Quelle a été votre réaction à l’annonce de la mort de Bernard Tapie, à propos duquel vous aurez noirci bien des pages dont cet ouvrage, C’était Bernard Tapie (L’Archipel, 2021) ?
À l’annonce de la mort de Bernard Tapie, j’ai eu presque la même réflexion que Tintin dans Le Lotus bleu, concernant la mort de Mitsuhirato : « Dieu ait son âme ! Mais c’était un rude coquin ! » On ne pouvait pas détester complètement Tapie, malgré le mal qu’il a fait tout au long de sa vie.
Attaquons-nous d’entrée à un gros morceau : que faut-il retenir à propos des scandales des comptes de l’OM ? Peut-on parler d’une forêt cachée par l’arbre VA-OM ?
Le procès des comptes de l’OM a beaucoup moins passionné les Français que l’affaire VA-OM, qui est anecdotique. Pourtant, on y apprend que, dès son arrivée à l’OM, Tapie a mis tous les moyens possibles pour gagner, notamment en achetant les arbitres. Au total, plus de 100 millions de francs ont été détournés dans les comptes de l’OM.
Comment expliquer la bienveillance inouïe de la Mitterrandie - et d’un Crédit lyonnais aux ordres - à l’égard de Bernard Tapie ?
À partir de 1983, les socialistes se sont rendus compte qu’il couraient à la catastrophe. Si la France ne voulait pas devenir l’Albanie, il fallait retrouver le système capitaliste. Mais pour cela, ils l’ont habillé en tentant de faire croire que des hommes de gauche, comme Bernard Tapie, pouvaient être aussi de bons capitalistes. Mitterrand a donc mis le Crédit Lyonnais au service de Bernard Tapie. Grâce à cette banque, il a pu acheter Adidas qui représentait quinze fois son chiffre d’affaires d’alors. Tous les analystes financiers vous le confirmeront : dès le départ, on savait que Tapie ne pourrait pas rembourser l’achat d’Adidas.
Vous expliquez bien, à propos de la sempiternelle affaire Adidas, que l’arbitrage voulu par le pouvoir sarkozyen (2008), favorable à Tapie et défavorable à l’État, donc aux contribuables, se fit au mépris d’une justice ordinaire qui allait elle dans un sens contraire. Peut-on clairement parler ici d’un fait du Prince, pour des motifs qui restent flous ?
Comment expliquer que Tapie, qui n’a pas mis un franc dans Adidas, aurait pu être floué par le Crédit lyonnais ? Même si je reconnais que le Crédit lyonnais n’a pas non plus été très honnête dans la reprise d’Adidas... Toutefois, personne n’est capable de dire pourquoi Nicolas Sarkozy a voulu faire gagner 405 millions d’euros à Tapie ? En 2007, ce dernier n’avait pas les moyens de lui apporter des centaines de milliers de voix. Mais on sait que Tapie a bien racheté le quotidien La Provence à la demande de Sarkozy qui voulait être candidat en 2017.
Il est beaucoup question, dans votre livre, de Tapie en tant qu’homme de paille. De quelles forces aurait-il été l’homme de paille ? Dans quelle mesure aura-t-il été à votre avis, aux manettes, et dans quelle mesure aura-t-il été instrumentalisé par plus fort que lui ?
Tapie n’a jamais été un homme d’affaires. J’ai rencontré ses proches : il ne mettait pas les pieds dans ses entreprises (sauf pour des reportages). Il n’a jamais été capable de lire un bilan. En 1981, les socialistes, arrivant au pouvoir, ont cherché des hommes de paille pour reprendre des entreprises, les pomper et détourner de l’argent. Mais à la différence des hommes de paille habituels, sans envergure, Tapie est très intelligent. Il ne s’est pas contenté de ce rôle obscur. Il a voulu briller.
Bernard Tapie fut une figure emblématique des années 80, de ces temps contradictoires où la France élut par deux fois François Mitterrand mais où, sensibles aux vents anglo-saxons, beaucoup s’extasiaient devant les réussites - ou les réussites apparentes - des grands capitaines d’industrie, et même des requins de la finance ("Greed is good"). Qu’est-ce que la starification de Tapie dans ces années-là nous dit des mutations opérées dans la décennie 80 ?
Dès les années 80, l’important n’est plus de « faire » mais de le « faire savoir ». Tapie a notamment déclaré que sa société de pesage Terraillon, en Haute-Savoie, allait faire 1 milliard de chiffre d’affaires et 150 millions de bénéfices, alors que son CA était autour de 2-300 millions et qu’elle accusait 35 millions de pertes. Les journalistes économiques n’ont fait que recopier les chiffres donnés par Tapie qui les invitait, tous frais payés, dans de grands hôtels.
De quelles dérives Bernard Tapie aura-t-il été un symptôme, un symbole durant les 50 dernières années ?
Tapie est le symbole du paraître. Les médias ne s’attachent pas à ce qui est, mais à ce qu’il dit. Et comme tout va très vite, pratiquement plus personne n’enquête.
Vous l’écrivez vous-même : dans bien des milieux, Tapie aura toujours été vu comme un Robin des Bois plutôt que comme un Stavisky. Il jouissait de mouvements de sympathie véritables (je laisse de côté la dernière période, avec son cancer). Qu’est-ce que la popularité Tapie nous dit de nous, et de ce qui nous touche ?
Tapie invitait les journalistes les plus connus, notamment ceux travaillant à la TV, dans son jet privé, sur son yacht. Ces derniers dressaient de lui des portraits qui ne correspondaient absolument pas à la réalité : homme de gauche, près du peuple, alors qu’en privé, il détestait les gens, et défendait des idées d’extrême droite. J’ajoute que Tapie a toujours été très habile, se présentant comme enfant du peuple, victime des riches, des banques...
Qu’est-ce qui sur le fond différencie Tapie d’un Silvio Berlusconi, ou d’un Donald Trump, deux autres grands ambitieux très charismatiques ? Contrairement à eux, lui a-t-il réellement voulu le pouvoir, en-dehors de celui que confère l’argent ?
C’est difficile à dire : voulait-il réellement du pouvoir ? Ministre de la Ville, il n’a absolument rien fait. Député à Marseille, il n’est jamais allé voir ses électeurs. Certain d’être battu en 1993, il s’est ensuite présenté à Gardanne. Il n’a jamais voulu vraiment être maire de Marseille. Il aurait fallu travailler. Or, Tapie, il ne vivait qu’avec son téléphone. Il ne lisait jamais aucun dossier.
Quelles parts d’ombre demeurent à propos de Bernard Tapie ? Quels mystères sont encore élucidables, et quels secrets a-t-il vraisemblablement emporté dans la tombe ?
On ne sait que peu de choses sur ses liens avec la mafia. Son ancien bras droit, Marc Fratani, avec lequel j’ai écrit Le Mystificateur (L’Archipel, 2019), n’a jamais voulu m’en dire beaucoup plus sur les liens, bien réels, entre Tapie et le Milieu. Je sais qu’il y a eu des contacts avec la mafia avant la coupe d’Europe gagnée par l’OM en 1993. Mais comme je n’ai pas eu les preuves promises, je n’ai pas pu écrire sur l’événement le plus important dans la vie de Bernard Tapie.
Si vous aviez pu l’interroger, quelles questions lui auriez-vous posées, les yeux dans les yeux ?
J’ai parlé à plusieurs reprises avec Tapie, notamment en 1992 quand il était candidat pour être président de la région PACA. Et en 2008, quand il savait qu’il allait gagner 405 millions d’euros et cherchait une villa sur les bords du lac Léman à Genève. Je lui ai envoyé une demande d’interview en 2015 lors de la publication de mon livre Notre ami Bernard Tapie (L’Archipel). il m’a fait un procès, m’attaquant sur quinze points. Il a perdu en première instance et en appel sur tous les points.
S’il m’avait reçu, je l’aurai interrogé sur ses liens avec le crime organisé et avec les présidents Mitterrand, Sarkozy et Macron. En revanche, ni Chirac et Hollande n’ont voulu entretenir de relations avec lui.
Comment a-t-on reçu l’information de la mort de Tapie en Suisse, et en quels termes la presse et les milieux d’affaires parlent-ils de lui ?
Bernard Tapie est un personnage connu en Suisse, où il se rendait fréquemment. C’est notamment une société financière genevoise qui lui a prêté de l’argent pour son yacht Le Phocéa. C’est aussi sur les bords du lac Léman qu’il pensait, un temps, s’installer avec les 405 millions d’euros de l’arbitrage. Bernard Tapie a même pensé racheter Servette, le club de foot de Genève.
Le jour même de sa disparition, j’ai été interviewé par la TV suisse. C’est surtout la presse francophone qui a parlé de sa disparition. Je dirais qu’elle est traditionnellement plus réservée que la presse française. Elle n’a donc pas fait de gros titres sur la disparition de l’ancien patron de l’OM. Quand aux milieux d’affaires, ils n’ont jamais pris très au sérieux Bernard Tapie.
Qui était-il finalement, ce Bernard Tapie que vous pensez, désormais, bien cerner ?
Bernard Tapie reste un personnage fascinant. Comment un simple homme de paille a-t-il pu ainsi briller ? Cela montre à la fois la médiocrité et le manque d’honnêteté de la classe politique française, des médias. Pourquoi Madame Macron s’est-elle inclinée sur le cercueil d’un type qui devait depuis 2015 plus de 400 millions aux contribuables français, et qu’il ne remboursera jamais ? Un type qui a mis à la porte des dizaines de milliers de salariés... J’ai écrit il y a quelques années un livre avec François Rouge, un banquier suisse tombé pour blanchiment. Il raconte le rôle des voyous dans notre société. Les grands de ce monde, les politiques, les hommes d’affaires, utilisent les voyous pour leurs basses besognes : menacer, espionner un concurrent, etc. Ensuite les voyous les tiennent. Tapie tenait beaucoup de monde.
À la fin de votre livre, vous évoquez l’affaire Thomas Thévenoud, qui a fait beaucoup de bruit pour beaucoup moins que les affaires Tapie. Vous vous empressez d’ajouter ensuite que cela ne présage pas nécessairement d’une plus grande vertu en politique. Malgré tout, peut-on dire qu’avec les nouvelles règles entrées en vigueur ces dernières années, on s’éloigne au moins un peu de la corruption et de l’affairisme en politique ?
Je pense qu’il est effectivement un peu plus compliqué qu’autrefois pour magouiller. Cela n’éloigne pas pour autant les hommes politiques de la corruption. Ils doivent simplement se montrer plus malins.
Vos projets pour la suite ?
J’ai un projet de livre depuis plusieurs années sur l’arnaque des retraites. Dans certains départements, on arrive jusqu’à 21 % d’erreurs, toujours au détriment des retraités. Mon agenda a été bousculé par d’autres projets, sur Tariq Ramadan, sur Xavier Bertrand, enfin, sur Bernard Tapie.
Un dernier mot ?
Les hommages rendus à Bernard Tapie m’ont sidéré. Je n’avais déjà pas beaucoup d’estime pour la classe politique et les journalistes. Savaient-ils que Bernard Tapie les méprisait ? À peine l’un de ceux rencontrés avait-il franchi sa porte que Tapie le traitait de « merde », de « connard », de « nul », de « pauvre type ».
Un commentaire ? Une réaction ?
Suivez Paroles d’Actu via Facebook, Twitter et Linkedin... MERCI !